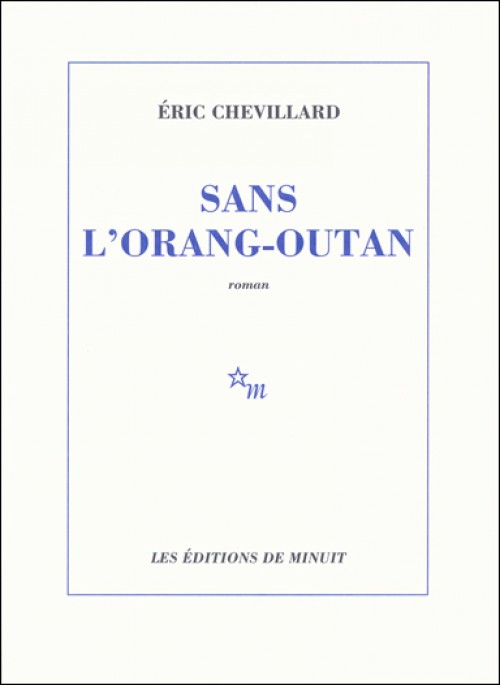
Éric Chevillard
Sans l'orang-outan
2007
192 p.
ISBN : 9782707320063
14.20 €
49 exemplaires numérotés sur Vergé des papeteries de Vizille
Nous ne soupçonnions pas l'importance de l'orang-outan dans l'organisation générale du monde ni que tout tenait ensemble grâce à lui, à son action discrète mais décisive. C'était lui, le subtil rouage. Il a suffi qu'il disparaisse pour que tout flanche. Comment vivre sans lui ? Essayons.
ISBN
PDF : 9782707325235
ePub : 9782707325228
Prix : 9.99 €
En savoir plus
Christophe Kantcheff, Politis, jeudi 6 septembre 2007
Une grimace d'avance
Éric Chevillard imagine les conséquences catastrophiques de la disparition du grand singe roux. « Sans l"orang-outan » est un roman comique et politique.
Sans l’orang-outan est le roman le plus politique de cet automne. Y aurait-il une légère exagération dans ce propos ? Peut-être même une certaine provocation, tant les romans d’Éric Chevillard ne se prêtent guère à ce type d’interprétation ? Les articles qu’ils suscitent, souvent élogieux, les présentent généralement comme de jubilatoires entreprises d’écriture subtile, drolatique et déconcertante, retravaillant des genres littéraires en les pervertissant de l’intérieur, et aux enjeux hautement esthétiques. Des romans savants et poilants, en somme.
Ce qu’ils sont exactement et, de ce point de vue, Sans l’orang-outan ne fait pas exception. Son point de départ ? La disparition sur Terre des orangs-outans. Plus précisément, la mort des deux derniers spécimens de l’espèce, le couple Bagus et Mina, dont un zoo, où travaille le narrateur, avait la charge. Ce dernier, qui répond au nom suggestif d’Albert Moindre, en était pourtant très épris, et les chouchoutait autant qu’il pouvait. Mais voilà. Le « mauvais virus » d’un visiteur, faisant suite à la calcination des forêts où habitaient leurs semblables en liberté, et l’orang-outan n’est plus.
Rien d’exceptionnel, hélas, et à dire vrai tout à fait vraisemblable, même si l’orang-outan n’est pas le « baiji », le dauphin blanc des rivières chinoises, dont la presse annonçait récemment l’extinction. Plus inattendues, en revanche, sont les conséquences imaginées par l’auteur de cette disparition : rien de moins que la déchéance des êtres et du monde. Une descente aux enfers où tous les éléments deviennent hostiles, et où les marques de la civilisation s’amenuisent. Un seul exemple : le sol s’est transformé en une poussière quasi aride où l’on s’enlise jusqu’à l’agonie, et où règne le « hurlant », monstre au « corps mou bourgeonnant de courts tentacules gris et flasques caroncules violacées », « qui prospère sur les terres abandonnées comme un chancre, comme une algue, abolissant toute autre forme de vie ». Mais l’apocalypse selon Chevillard n’est pas sans produire chez le lecteur de nombreux fous rires noirs. L’auteur de Démolir Nisard fait preuve d’une capacité exceptionnelle à pousser la logique d’une situation jusqu’à son terme loufoque, à en exploiter toutes ses possibilités, jusqu’aux plus terrifiantes, en usant de glissades et de décalages stylistiques. Plutôt Keaton que Chaplin : la prose avance à l’instar d’une mécanique précise et folle, pour mettre à nu, toujours, une catastrophe insolite.
En quoi cela fait-il de Sans l’orang-outan un roman politique ? C’est qu’il porte une vision critique incontestable. D’abord du point de vue écologique, l’extinction du singe roux étant le fruit de la « désinvolture » humaine, non compensée par un « plan d’action » in extremis qui aurait pu le sauver. Cela ne rappelle-t-il rien ?
Plus encore : avec l’orang-outan, dont l’auteur cite un certain nombre des vertus dont il faisait profiter l’homme, une certaine sagesse s’est envolée. À la fuite en avant de la modernité, il opposait un autre rapport au temps et aux choses, résumé ainsi : l’orang-outan accueillait « le progrès avec méfiance, une brindille pour pêcher les insectes dans les troncs creux, une large feuille vibrante pour amplifier les vocalises de l’amoureux, voilà pour le XXe siècle ». Même s’il est fort probable qu’Éric Chevillard s’en défendrait, il n’est pas interdit de voir dans la disparition de l’orang-outan un manque plus métaphorique qui réduit l’espèce humaine à une existence primaire et… bestiale. Ce manque peut recouvrir plusieurs termes - idéaux, croyances, humanités… On s’abstiendra ici de trancher. Mais pas de lancer cet urgent mot d’ordre : préservons l’orang-outan !
Isabelle Rüf, Le Temps, samedi 15 septembre 2007
« Sans l'orang-outan » est un conte moral traversé par la colère. La fin des grands singes roux comme symbole des méfaits de l"humanité.
Le voisinage dans cette page du noir roman d’Antoine Volodine et du dernier Chevillard n’est pas fortuit. Sans l’orang-outan est un conte philosophique, Songes de Mevlido, un parcours onirique. Pourtant, ils sont tous deux traversés par la même colère devant l’usage désolant que l’humanité a fait du monde. Ils le traitent chacun avec leur humour propre, mais amer toujours.
Comme l’indique le titre, Chevillard imagine la fin (par ailleurs programmée) des grands singes roux. Il tisse autour de ce « vide aspirant » un vertigineux linceul de mots. L’employé chargé de nourrir Mina et Bagus, les derniers orangs-outans, recense dans une première partie les catastrophes qui ne manqueront pas de s’enchaîner, une fois rompue la chaîne des relais : « […] on cherche partout l’éponge et le sel qui ne sont pas dans la cuisine et ne sont pourtant plus dans la mer. Nous allons payer cher notre désinvolture, je prévois de profonds bouleversements. »
On retrouve dans cette première partie l’alacrité qui électrisait déjà Palafox, Du hérisson, Le Vaillant petit tailleur et bien d’autres. Les enchaînements d’une logique sidérante, les images burlesques. La poésie aussi, haïkus posés dans les blancs du récit : ainsi du « piaf minimal », « trois plumes piquées dans deux notes ». Ce qui désole l’amoureux des orangs-outans, et nous avec lui, c’est qu’avec la chose disparaît aussi le mot, que le langage s’appauvrit à l’aune de l’environnement.
Une deuxième partie peint un monde effondré. Dans un milieu néolithique dont les habitants se souviendraient de jours meilleurs, une humanité déboussolée mène la guerre de tous contre tous. Le ton change, l’ironie est plus dure. Chevillard s’est fait une spécialité des différentes sortes de bêtise prétentieuse, singeant le discours savant (L’Œuvre posthume de Thomas Pilaster), l’art pompier (Démolir Nisard), les récits de voyage (le délicieux Oreille rouge), variant les registres, débusquant les stéréotypes. Ici la satire se fait plus sombre. L’ennui règne : « Nous le cultivons haineusement, nous le sculptons comme du buis. » Pour nourriture, des céréales dures comme de la corne, des coquillages indigestes. Une drogue infâme pour seul dérivatif. De la boue, des monstres. Une autre musique, pas si éloignée des cauchemars de Volodine ! En conclusion, le narrateur propose à l’adoration des humains grégaires, toujours prompts à croire, une idole nouvelle, un grand singe déifié, modèle identificatoire, précurseur modeste.
On trouve largement motif à rire dans cette fable amère. Les parents du narrateur (Albert Moindre et Eléonore Caquet) offrent matière à des digressions burlesques et pertinentes sur l’héritage et la transmission. L’écriture si précise de Chevillard est toujours aussi excitante. Mais le fond en est bien plus grave.
En conclusion, le narrateur laisse espérer le retour de l’orang-outan, grâce aux miracles de la génétique, et à travers lui, notre père à tous, la régénération de l’humanité. Est-ce bien sage, en vertu des expériences du passé ?
Patrick Grainville, Le Figaro, 18 octobre 2007
Et si la mort des deux derniers orangs-outans de la planète annonçait la fin de l'humanité ?
Une fable tendre et cocasse.
Éric Chevillard est peut-être le seul auteur vraiment burlesque et désopilant de notre littérature actuelle. Un cas unique de satire et de loufoquerie pures. Il aime partir d"une hypothèse triviale pour en tirer des conséquences astronomiques. Oui, le comique devient cosmique. Cette jonglerie virtuose, c’est sa lyre et son délire.
Cette fois, le rire frôle le pathétique.
Dès les premières phrases du roman, la messe est dite. Une impression de révolu endeuille la Terre, comme frappée d’inertie, en proie à une terrible pesanteur, prélude elle-même à l’entropie et à la fin de nous-mêmes. Mais quelle est la cause de cette régression de l’opéra vital et de la kermesse darwinienne ? Je vous le donne en mille : c’est la mort des deux derniers orangs-outans de la planète : Bagus, le grand mâle, et Mina, sa compagne élastique, ne sont plus ! Fini, les cabrioles d’arc-en-ciel, les jetés-battus dans les lianes ludiques. L’ère de la grâce débonnaire et de l’épicurisme oisif est close. « Le grand mâle, un système solaire à lui tout seul, avec le disque parfait de sa grosse figure rousse à travers les feuilles, et, en orbite autour d’elle, profusion de caramboles stellaires et de granuleux litchis. » Jadis on pouvait compter sur cette roue, cette farandole perpétuelle inventée par l’homme de la forêt dont le fameux sac laryngien était assez coquet ! Et Chevillard de prophétiser : « Le signe ne survivra pas longtemps au singe ! » Il nous donne à l’appui l’exemple fameux du dronte, ou dindon, ou dodo, de l’île Maurice dont les noms et les signes sont menacés de disparition. Il en sera bientôt pareil de la relique malaise et dorée d’orang ! Notre frère massacré : « De ses soies rousses on a fait des balais d’éboueur pour déblayer le terrain de ses ossements. Pour façonner une queue de billard on a scié le ramin dans lequel il avait son nid… » Ces constats consternés sont faits par Albert Moindre, le narrateur, naturaliste épris des singes géants. L’ascendance Moindre est maigre, amère, mesquine. Albert sacrifierait volontiers toute descendance à la perpétuation des bêtes batifoleuses et des jungles nonchalantes. On empaille les deux icônes du bonheur dans un musée et l’humanité rongée de mélancolie commence de péricliter. Chevillard n’y va pas de main morte : c’est un refroidissement, une dislocation qui rappellent la déconfiture du Roi se meurt, d’Eugène Ionesco. L’espèce prométhéenne a perdu sa promesse tonique, les mâles pratiquent l’automutilation et baladent en rase campagne leurs testicules secs et funèbres. On a définitivement quitté le champ de l’épopée, de l’adversaire castré et du trophée brandi dans l’allégresse !
Comment sortir de la dégénérescence ?
Et si on redevenait orang-outan à force d’exercices d’assouplissement parmi les branches ? À moins que d’autres acrobaties plus scientifiques tirent parti des momies de Bagus et Mina ? Bien sûr, cette fable profonde nous est contée de la manière la plus cocasse et la plus tendre.
Aurélie Djian, Le Monde, vendredi 2 novembre 2007
Eric Chevillard, à quatre mains
L'apport capital de l"orang-outan au genre humain
Peut-être que cela a commencé comme ça : tiens, si j’écrivais un livre sur l’orang-outan. Chiche, se serait dit Eric Chevillard. Comme si « le nom de l’orang-outan », du malais : « homme de la forêt », ainsi qu’une « mystérieuse coïncidence » - dans orang-outan, on entend « orange » – avaient suffi. « Et voici le cher homme debout dans son costume de poils roux. » Et le livre lancé. La première phrase semble d’ailleurs écrite du point de vue de l’orang-outan : « Sur un pied en pivot, je tourne, le cercle de l’horizon tourne avec moi, sur mes hanches, je balaye l’espace du regard, du plus lointain au plus proche… »
Très vite apparaît, derrière cette souplesse rotative, le personnage du soigneur qui veillait sur Bagus et Mina – le dernier couple d’orangs-outans – et qui aujourd’hui déplore leur disparition : « Le point de vue de l’orang-outan qui ne comptait pas pour rien dans l’invention du monde et qui faisait tenir en l’air le globe terraqué, avec ses fruits charnus, ses termites et ses éléphants, (…) ce point de vue n’est plus, vous vous rendez compte. »
On plonge dans la fiction spéculative, une littérature de l’excès qui invente un monde à partir d’une hypothèse divergente. Exemple : au commencement était l’orang-outan. Sans lui, tout est dépeuplé. Que faire ? Là où Démolir Nisard (éd. de Minuit, 2006) s’appuyait sur un critique oublié du XIXe siècle, archétype de la médiocrité pontifiante à fonction de punching-ball, l’orang-outan figure une échappée. C’est l’anti-Nisard, « l’aube de toutes les histoires » : logique de la fiction, principe de plaisir ou tremplin vers la rêverie. Sans l’orang-outan, l’homme esseulé se traîne sur « les terres abandonnées ». Un « pays maudit » à l’oreille ensablée et « à l’imagination malade », doté d’une littérature pleurnicharde : « Nous n’entendons plus que des paroles d’hommes l’éternel débat, le petit dialogue amoureux si niais (…), l’ennui de notre littérature qui parle avec les lèvres de la plaie et ne sait dire que aïe et ouille. »
On retrouve ici la griffe Chevillard pour qui « écrire c’est toujours écrire contre, une position de combat ». Il vise régulièrement l’autofiction et le « bon vieux roman » qui se contentent de dupliquer la vraie vie. En littérature, l’occasion est donnée de tenter autre chose, sinon à quoi bon. D’où un bestiaire fabuleux qui sert à la fois de décor et de métaphore : « le hurlant » empêche de dormir, « le lion des sables » distrait de l’ennui, sans oublier les fameux troupeaux de « yacks blonds ».
L’humanité engourdie, abandonnée par l’orang-outan, est à l’image du narrateur, le bien nommé Albert Moindre : « Quel insensé je suis ! » se désole l’un d’entre eux, « Je perds mon temps dans les bras de Marasma. Cette aventure avec Labyrintha ne me mène nulle part ». Une remise en forme s’impose. L’ex-soigneur s’improvise entraîneur sportif d’une bande de bras cassés, candidats au devenir orang-outan. Contre la fin des idéologies et des croyances, il s’agit de renouer avec l’héroïsme, « la geste magnifique » du grand singe roux. « Tel est notre premier objectif, mes amis », dit le coach d’un ton docte : « devenir essentiellement arboricoles ».
En même temps que cet horizon moral, c’est tout un ordre du corps qui vacille. Tandis que nous autres bipèdes évoluons horizontalement, l’orang-outan, lui, fait la roue dans les arbres, verticalité épanouie dotée de « quatre mains fiables ». « Nos bras étaient plus longs que nos jambes, poursuit le coach, j’en déduis raisonnablement que nous n’avions d’autre relation au monde que l’étreinte. »
« Ecrire c’est l’art d’allonger les bras », disait Diderot à Sophie Volland. La fable des origines imaginée par Chevillard rejoint ce fantasme d’une littérature tactile, où comprendre veut dire aussi embrasser, prendre dans ses bras. Telle est la leçon de l’orang-outan.
Rencontre
Du même auteur
- Mourir m'enrhume, 1987
- Le Démarcheur, 1989
- Palafox, 1990
- Le Caoutchouc, décidément, 1992
- La Nébuleuse du crabe, 1993
- Préhistoire, 1994
- Un fantôme, 1995
- Au plafond, 1997
- L'Oeuvre posthume de Thomas Pilaster, 1999
- Les Absences du capitaine Cook, 2001
- Du hérisson, 2002
- Le Vaillant petit tailleur, 2003
- Oreille rouge, 2005
- Démolir Nisard, 2006
- Sans l'orang-outan, 2007
- Choir, 2010
- Dino Egger, 2011
- L'Auteur et moi, 2012
- Le Désordre azerty, 2014
- Juste ciel, 2015
- Ronce-Rose, 2017
- L'Explosion de la tortue, 2019
- Monotobio, 2020
- La Chambre à brouillard, 2023
- Jaune soleil, 2026
Poche « Double »
- Palafox, 2003
- La Nébuleuse du crabe , 2006
- Oreille rouge , 2007
- Le Vaillant petit tailleur , 2011
- Du hérisson, 2012
- Les Absences du capitaine Cook, 2015
- Ronce-Rose, 2019
- Monotobio, 2026
Livres numériques
- Au plafond
- Choir
- Démolir Nisard
- Dino Egger
- Du hérisson
- L'Auteur et moi
- L'Oeuvre posthume de Thomas Pilaster
- La Nébuleuse du crabe
- Le Caoutchouc, décidément
- Le Démarcheur
- Le Vaillant petit tailleur
- Mourir m'enrhume
- Oreille rouge
- Palafox
- Préhistoire
- Sans l'orang-outan
- Un fantôme
- Le Désordre azerty
- Juste ciel
- Les Absences du capitaine Cook
- L'Explosion de la tortue
- Ronce-Rose
- Monotobio
- La Chambre à brouillard
- Jaune soleil
- Monotobio
