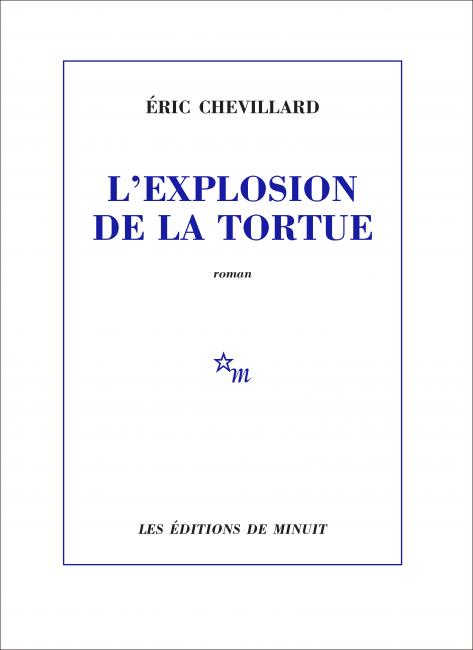
Éric Chevillard
L'Explosion de la tortue
2019
256 pages
ISBN : 9782707345073
18.50 €
44 exemplaires numérotés sur Vergé des papeteries de Vizille
Les tortues de Floride élevées en aquarium ne sont pas tout à fait des cailloux. Elles ont donc besoin d’eau et de nourriture pour vivre. C’est ce que découvre le narrateur de cette histoire, de retour chez lui après un mois d’absence. Il croyait la sienne plus endurante, mais la carapace décalcifiée de la petite Phoebe se fend sous son pouce. Par ailleurs, alors qu’il s’employait à réhabiliter en la signant de son nom l’œuvre de Louis-Constantin Novat, écrivain ignoré du XIXe siècle, cette généreuse initiative se trouve soudain menacée. Or la forêt des mystères n’abrite pas que des crimes : les deux mésaventures pourraient bien être liées.
ISBN
PDF : 9782707345097
ePub : 9782707345080
Prix : 12.99 €
En savoir plus
Le Monde des livres, vendredi 4 janvier 2019
Patrick Kéchichian, La Croix, jeudi 10 janvier 2019
Le Machiniste du réel
Partant de l’histoire d’une tortue domestique, Éric Chevillard réinvente l’œuvre d’un auteur oublié du XIXe siècle, traçant des ponts entre deux sortes d’extinctions.
Eric Chevillard n’a pas l’habitude de bichonner son lecteur, de lui fournir fauteuil confortable et boisson fraîche, cabine de luxe et espaces festifs, dans une croisière haut de gamme. Ce n’est pas non plus un violent, qui cherche à le secouer par toutes les articulations en criant à son oreille des énormités. Mais, il n’empêche : il aime le mouvement plus que le calme, la frénésie plus que la sérénité, les paysages accidentés plus que les plats pays. Avec lui, ce qu’on n’attend pas, ce dont on n’a même pas l’idée, advient. Vous croyez marcher sur un certain chemin, aussitôt il vous fait signe du buisson d’où il surgit, ardent, plein de projets exploratoires. Pour lui, comme il l’écrivait naguère, avec le plus grand sérieux, « tout est matière à plaisanterie » ; « humaniste abstrait », l’humoriste, à ses yeux, « n’est pas un joyeux drille. Pas un gai luron » : c’est un cérébral plus qu’un « voluptueux ».
Le roman, pour Eric Chevillard, n’est assurément pas une forme fixe. A chaque fois, il l’invente, la déforme et réforme à nouveaux frais, tout en ne perdant pas de vue ses usages. En 2017, avec Ronce-Rose, c’était, pour le dire vite, le récit de formation et de quête d’une jeune fille innocente et déjantée. Avec L’Explosion de la tortue, il enrichit son singulier bestiaire, inauguré avec le poussin pas très catholique, de Palafox (1990). Puis il y eut le hérisson, le crabe, l’orang-outang…
Ici, c’est donc d’une tortue qu’il s’agit. Même si, de fait, comme le souligne le titre, de la bête taciturne, dès la première page, il ne reste pas grand-chose ! Inaugurale, l’explosion est l’effet de la pression du pouce du narrateur sur la carapace de l’animal originaire des marais de Floride, devenue du fait de sa négligence, « fine et sèche comme une feuille morte ». Qu’on se le dise, la tortue a besoin d’eau, d’humidité : la sécheresse lui est fatale… « Crac. » Le narrateur l’apprend très vite à ses dépens et surtout à ceux de ladite tortue nommée Phoebe, qui « se contentait d’être, pétrifiée dans l’infinitif, ignorant toute conjugaison ».
Ne demandez surtout pas au critique qui tente ici de faire son travail, de résumer le contenu du roman de Chevillard ! Si par extraordinaire il y parvenait, il vous convaincrait de vous éloigner de cette œuvre insolite, dont l’intrigue passablement saugrenue vous entraîne en des lieux que vous n’auriez jamais eu l’idée de visiter. Dans son essai Le Roman expérimental, Emile Zola opposait l’imagination et le sens du réel, en se prononçant résolument, on s'en doute, en faveur de la seconde instance. D’une certaine façon, Chevillard donne raison à Zola. Non sans introduire un doute, une question, une inquiétude quant à ce réel. Non sans l’égayer, le subvertir par quelques images ou rêveries.
Mais la question demeure : comment le circonscrire, comment le nommer ? Comment l’écrire ? Avec des mots, des phrases autant que des idées ? Avec de courts paragraphes parfois d’une seule ligne en forme d’aphorisme, de plaisanterie ou d’exclamation ? Et est-ce bien cela que Chevillard nomme des « machinations lexicales » ? Avec, aussi, surtout, une constante interrogation sur ce qu’est la littérature, sur ce qu’on appelle écrire, sur ce qu’on nomme : un écrivain. Ronce-Rose tenait un journal intime. Par le passé - comme ici à nouveau - l’auteur de L’Œuvre posthume de Thomas Pilaster (1999) et de L’Auteur et moi (2012), inventa des doubles, des doublures, pour tenter de résoudre ce problème. Fort heureusement, il n’y parvint pas. Comme pour mieux poser l’équation, il fait dire ici à son narrateur : « Je m’étais attribué pour ma part le rôle le plus ingrat, à savoir le personnage de l’auteur… »
L’Explosion de la tortue est un roman à tiroir, écrit par couches successives. Les dernières assez finement pour laisser voir, en transparence, les précédentes. L’exercice de style est tout sauf vain.
Jérôme Garcin, L’Obs, 10 janvier 2019
« Ce qui me semble beau, ce que je voudrais faire, écrivait Flaubert, en 1852, dans une lettre fameuse à Louise Colet, c’est un livre sur rien, un livre sans attache extérieure, qui se tiendrait de lui-même par la force interne de son style, […] un livre qui n’aurait presque pas de sujet ou du moins où le sujet serait presque invisible, si cela se peut. » Mettons que, pour Eric Chevillard, notre meilleur styliste, le rien, ou plutôt le presque-rien, ce soit une tortue. Une insignifiante tortue de Floride d’à peine cinq centimètres, achetée quai de la Mégisserie, à Paris, dont la mort, au début du roman, est décrite avec la même solennité affligée que l’agonie de Louis XIV par le duc de Saint-Simon. La minuscule cistude s’appelait Phoebe. Le narrateur l’avait abandonnée dans un aquarium posé au fond d’une baignoire remplie d’eau, sur laquelle flottait un canard en plastique rose, le temps d’aller prendre le soleil d’été sur une île grecque. A son retour, il avait saisi Phoebe dans sa main et, sans le vouloir, d’une infime pression du pouce, avait crevé sa fine et sèche carapace. Phoebe venait de rendre l’âme. Désormais, malgré l’amertume de toutes choses – « l’endive, la chicorée, le pamplemousse » -, il fallait « rester vivant pour chanter encore la petite tortue morte, édifier un tombeau à sa mesure et inscrire son histoire dans la grande geste de ce monde ». Quelle pompe pour un si dérisoire reptile, même pas domestique et encore moins comestible. Quelle drôlerie, aussi. On découvrira ensuite comment le narrateur, accablé par ce deuil et la mauvaise conscience, trouvera dans l’œuvre de l’oublié Louis-Constantin Novat (1839-1882), dont il est un spécialiste, et notamment dans ses livres « l’Arche fantôme » et « l’Anguille sous roche », un troublant écho à son immense chagrin. Dans ce bestiaire fou, on apprendra également que l’éléphant n’assume pas ses pets, qu’on peut arracher son noyau au caniche abricot, que l’hippopotame aime débarquer sur les plages bretonnes, qu’il arrive au lapin à la moutarde de bondir hors du plat, qu’il est traumatisant de couper la queue d’un lézard, ou dans quelles circonstances il convient de mettre des chapeaux aux orangs-outans et des serpents dans les cercueils. Mais aussi que, sans le trou qu’il obstrue, le bouchon n’a aucun intérêt et que le chardon non seulement se mange, mais encore se transforme en kimono. L’excellent Chevillard a beau suggérer en épilogue que tous les écrivains empruntent à leurs prédécesseurs – quand ils ne les pillent pas -, il ne pourra pas renier ce roman très ressemblant, écrit dans le style cinglant de son journal « l’Autofictif », où il concentre tous ses talents : l’affabulation, l’érudition, la digression, la dérision, la subversion. Jusqu’à l’explosion de la tortue.
Philippe Lançon, Libération, 19 janvier 2019
Carapace carapatée
Eric Chevillard laisse mourir une tortue et navigue entre les blancs de la page
C’est l’histoire d’un mec qui laisse sa petite tortue de Floride, achetée quai de la Mégisserie à Paris, quand il part en vacances avec sa copine. Elle s’appelle Phoebe, ça veut dire «radieuse» en grec. Drôle de nom pour une tortue, mais pourquoi pas. Quand ils reviennent, le système compliqué qu’il avait imaginé pour qu’elle ne meure pas, avec l’aquarium dans la baignoire remplie, n’a pas fonctionné : ça fuyait. Phoebe n’est pas encore morte, mais c’est tout comme. La voilà sèche comme une brindille, et le mec, en voulant la guérir, perce la carapace et la tue. Dans le livre, il y a aussi un caniche qui s’appelle Berlioz, mais celui-là, il survit à tout alors qu’on préférerait le tuer, la mort est injuste. La copine est furieuse, elle engueule le narrateur, il y a du tirage dans le couple entre les phrases. D’autant qu’une fillette appelée Lise a disparu et que les flics sonnent à la porte, il n’en faut pas plus pour se sentir coupable.
Ça, c’est l’histoire principale, mais ce n’est pas la vraie, ou pas la seule histoire. La tortue est là d’un bout à l’autre comme un cheval de Troie. Le lecteur doit la percer, lui aussi. C’est comme ça qu’il entre, de petits paragraphes en petits paragraphes, à pas de tortue, dans l’autre histoire, une histoire d’écrivain mort et de postérité dont je vais bientôt vous parler. Phoebe est ce qu’on appelle une métatortue.
Thoreau. Tout ça est très bien et subtilement expliqué par le narrateur, pages 91 et suivantes. Il cite un passage du journal de l’écrivain américain Henry David Thoreau, en 1850. Celui-ci raconte qu’il a trouvé «dans un champ de seigle hivernal un œuf de tortue, blanc et elliptique comme un caillou, ce pour quoi je l’avais pris, puis je l’ai brisé. La petite tortue était parfaitement formée, jusqu’à la colonne vertébrale que l’on voyait distinctement». Trois petits paragraphes plus loin, le narrateur écrit : «Si la littérature ne s’empare pas de ces histoires de tortues précocement anéanties, tuées par un brave homme qui n’avait pourtant pas l’intention de leur donner la mort, alors on voit mal de quoi elle pourrait se soucier et quelle est sa légitimité.» A ce stade, même si le narrateur n’est pas l’auteur, on peut se demander s’il ne l’est tout de même pas un peu, car c’est bien d’un art poétique, celui de Chevillard, qu’il s’agit. On peut aussi se demander si le livre qu’on est en train de lire n’est pas né de la lecture de ce passage de Thoreau, bien beau en effet. On n’en saura rien, évidemment, car toute affirmation, ici, est vite remise en cause, ou déstabilisée, ou nuancée, par une autre. L’auteur a trop de fantaisie, et trop de poésie, pour s’enliser dans des discours.
Tout est raconté par les petits paragraphes évoqués plus haut, parfois d’une phrase, parfois de trois ou quatre, séparés entre eux par le blanc du vide papier. Ce blanc est très important : le lecteur saute dedans comme une grenouille, ou une petite tortue, et se met à tremper dans un bain merveilleux de figures de style, d’ellipses, d’accélérations, d’effets comiques, tout ça organisé d’une main sûre et même virtuose. Grâce à ce blanc, les vases ne cessent de fuir, comme l’aquarium de la tortue, et de communiquer. L’un des blancs les plus remarquables arrive quand le narrateur décrit Phoebe mourante : «La vie s’acharnait en elle. Phoebe criblée des éclats de sa carapace, de sa carapace enfoncée comme la carrosserie d’une voiture accidentée dont aucun des occupants n’aura pu survivre, ni le conducteur pris de vin ni sa légitime passagère.» Blanc, à la ligne. «Il y eut un rescapé, pourtant.» Blanc, à la ligne. «Le siège enfant à l’arrière s’était détaché sous la violence du choc et retourné entre les deux banquettes, c’est dire si je ressemblais alors - en effet, beaucoup - à une tortue.» Et c’est ainsi, par ce brusque changement de ligne narrative, brusquerie autorisée par le blanc, qu’on apprend que le narrateur a survécu enfant à l’accident dans lequel ses parents sont morts. Dans un roman ordinaire, les métaphores viennent nourrir, éclairer le récit. Dans celui-ci, elles sont à l’origine du récit. La tortue, si vous préférez, tire toute la couverture à elle.
Ce qui nous conduit à la seconde histoire, celle de l’écrivain mort. On apprend vite en effet que le narrateur s’intéresse à la littérature. Dans une maison de retraite, il a piqué les clés de la baraque d’une héritière d’un écrivain du XIXe siècle sans postérité, un certain Louis-Constantin Novat. Il a aussi torturé son grand-père pour trouver ses économies, mais ça, c’est une autre histoire, à peine développée.
Marbre. Ce Novat a écrit des œuvres plus ou moins bonnes, dont Queue coupée, une histoire de lézard qui perd sa queue dans la main d’un enfant, lequel se sent coupable. Le narrateur a lu tous les textes de Novat, il nous les résume à sa façon et décide de leur donner une seconde chance - on n’est pas en Amérique - en les adaptant au nouveau monde, le sien, et en les signant. Bref, il veut remettre l’auteur inconnu dans la vie et se servir de lui pour changer la sienne. Pour ça, il faut bien sûr le réinventer : «Il n’y a qu’un moyen de changer le passé, et c’est de le rêver différent.» Blanc, à la ligne. «N’est-ce pas ce que nous faisons très efficacement de l’avenir ?» C’est d’autant plus simple qu’avec Novat, le terrain semble vierge : «J’en suis arrivé à la conclusion qu’il ne pesait pas assez lourd pour laisser dans la neige, le sable ou la boue l’empreinte de son pas, et donc, une trace dans l’histoire, sur cette dalle de marbre, c’eût été bien étonnant. Au mieux était-il précédé d’un infime nuage de buée et suivi d’un mince sillage d’écume, mais il est plus vraisemblable alors qu’il se confondait avec eux. Le premier se défaisait dans l’autre : Louis-Constantin ne bougeait plus.» La postérité d’un écrivain est aussi fragile que la membrane d’une tortue.
Le 7 janvier, dans son blog «L’Autofictif», Eric Chevillard écrit : «Quand explose une tortue, la sérotonine que contenait son organisme se répand partout alentour et forme une flaque, d’abord, qui enfle jusqu’à se transformer bientôt en raz-de-marée, en tsunami. C’est un phénomène rare, toujours fascinant à observer.» Mais Houellebecq, contrairement à Phoebe et Novat, semble avoir une peau de crocodile.
Isabelle Rüf, Le Temps, 19 janvier 2019
Éric Chevillard se met du côté des animaux
Ce que l’homme inflige aux animaux excite la verve du romancier. « L’explosion de la tortue » est à la fois burlesque et savant
Depuis la parution, il y a deux ans, du merveilleux Ronce-Rose (qui reparaît en poche), Eric Chevillard a donné à ses lecteurs bien des raisons de se réjouir : Détartre et désinfecte (Fata Morgana, 2017), Défense de Prosper Brouillon (Noir sur Blanc, 2017), Feuilleton (La Baconnière, 2018), tous ouvrages issus de son expérience de critique littéraire pour Le Monde des livres, autant de « défenses et illustrations de la langue française » contre ceux qui lui font du mal, amères et hilarantes. A quoi s’ajoute L’autofictif ultraconfidentiel (L’Arbre vengeur, 2018) soit dix ans de son blog quotidien réunis en un volume.
CULPABILITÉ A LA ROUSSEAU
A cette occasion, il disait au Temps, le 27 janvier 2018 : « La mauvaise foi est aussi sincère que l’aveu. » Sincère, il l’est certainement, le narrateur de L’Explosion de la tortue, quand il tente de se défausser de sa culpabilité avec des arguments peu crédibles. A son retour de vacances, il assiste à la mort par dessiccation de sa tortue Phoebe, après que la carapace décalcifiée du reptile s’est brisée – crac – sous son pouce. « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé », on le savait déjà depuis Sans l’orang-outan (Minuit, 2007) : ce que l’homme inflige aux autres animaux excite la colère et ici la verve de Chevillard.
C’est la faute au vendeur de l’animalerie, au concierge effrayant, au fabricant de bouchons de baignoire, à sa compagne qui l’accuse, à la bête elle-même qui s’est laissée aller trop complaisamment. « Moi, je ne l’avais pas tout à fait tuée. Or, elle, elle mourut pour de bon. » Le coupable entonne aussi le grand air de la culpabilité à la Rousseau, depuis les exactions subies par Petit Bab, copain de classe martyr (« ce qu’on a rigolé ! »), jusqu’aux vieilles dames dépouillées de leurs biens. Mais ça, c’était pour la bonne cause : en rendant une visite intéressée à une de ces personnes âgées dont nous nous débarrassons dans des asiles, il découvre les ouvrages trop méconnus de Louis-Constantin Novat, auteur peu novateur du milieu du XIXe siècle.
Voilà un nid pour ce coucou : « Cette œuvre attendait son heure. Elle attendait son auteur. Novat n’avait été qu’un exécutant zélé mais ingénu, un médium. » Au prix de quelques aménagements, il entend donner, sous son nom, une actualité posthume à un auteur sans postérité. Dans Démolir Nisard, Eric Chevillard s’acharnait sur un érudit pompeux contemporain de Novat. Ici, il s’emploie à « remolir » Novat.
A l’instar de Chevillard dans Le Désordre Azerty (Minuit, 2014), le narrateur pourrait déclarer : « J’écris toujours le même livre ; seuls les mots changent. » Mais lui, ce sont ceux d’un autre qu’il réorganise. Hélas, son projet échoue : au profit d’un cuistre – race honnie -, on le dépouille de l’édition critique des œuvres posthumes de ce Louis-Constantin Novat, auteur qui pourtant lui appartient. Bref, tout va mal pour lui, assassin de tortue de Floride, plagiaire empêché. Ainsi va le récit en allers et retours d’une époustouflante précision entre le sort tragique de Phoebe et celui des livres de Novat.
Ce sont la nature et la littérature également maltraitées. L’art des enchaînements implacables est ici porté à l’extrême, lié à un vocabulaire choisi – connaissez-vous l’oribusier, l’alcool de cirse, l’oaristys ? - et à des images prises au pied de la lettre. Les œuvres de Novat celles de Prosper Brouillon, tissées, elles, du pire de la littérature contemporaine : en un siècle et demi, les clichés n’ont pas beaucoup changé.
Le monde, disent les Chinois, « tient en équilibre sur le dos de quatre éléphants, eux-mêmes supportés par une tortue. » On comprend alors que le narrateur, cet alter ego de l’auteur, se hâte de colmater la carapace explosée. Trop tard. Désormais, privés de support, les quatre éléphants « nagent pesamment dans l’éther ». Nous nous agitons, tels des lemmings suicidaires, à la surface d’un monde flottant. Nous ferions mieux de nous occuper de nos éléphants pendant qu’ils sont là. Et des hérissons, des hippopotames, des orangs-outans, des lézards sans queue, des écrivains négligés, des livres non lus.
HUMOUR SALVATEUR
C’est le message pré-apocalyptique de Chevillard. Il le tient depuis longtemps, dans des livres très noirs – Choir, Sans l’orang-outan. Celui-ci est burlesque et savant – on voit passer discrètement Michaux intervenant à Honfleur, Flaubert et Don Quichotte, Thoreau, Pagnol. On rit beaucoup en s’émerveillant de la virtuosité.
Dans un final éblouissant, une Agence vend de la postérité à deux copistes à la Bouvard et Pécuchet, des auteurs en mal de reconnaissance. L’un deux se vante : « il m’en vient en moyenne trois par jour. » Exactement comme à Chevillard qui, jour après jour, dans son blog, « L’autofictif », livre trois courts textes. Chaque année, ils sont réunis en ouvrage. Le onzième vient de paraître. C’est un réservoir de petits bonheurs d’écriture. On y trouve des choses vues ou entendues ; des haïkus ironiques ou poétiques ; des instantanés qui saisissent les absurdités du monde comme il va ; des aphorismes ; de petits feuilletons ; et, rarement, les trouvailles de ses filles. On y retrouve l’obsession de la finitude exorcisée par l’humour, la précision du trait, la finesse du regard, le pessimisme et la colère tempérés par l’ironie.
Rencontre
Du même auteur
- Mourir m'enrhume, 1987
- Le Démarcheur, 1989
- Palafox, 1990
- Le Caoutchouc, décidément, 1992
- La Nébuleuse du crabe, 1993
- Préhistoire, 1994
- Un fantôme, 1995
- Au plafond, 1997
- L'Oeuvre posthume de Thomas Pilaster, 1999
- Les Absences du capitaine Cook, 2001
- Du hérisson, 2002
- Le Vaillant petit tailleur, 2003
- Oreille rouge, 2005
- Démolir Nisard, 2006
- Sans l'orang-outan, 2007
- Choir, 2010
- Dino Egger, 2011
- L'Auteur et moi, 2012
- Le Désordre azerty, 2014
- Juste ciel, 2015
- Ronce-Rose, 2017
- L'Explosion de la tortue, 2019
- Monotobio, 2020
- La Chambre à brouillard, 2023
- Jaune soleil, 2026
Poche « Double »
- Palafox, 2003
- La Nébuleuse du crabe , 2006
- Oreille rouge , 2007
- Le Vaillant petit tailleur , 2011
- Du hérisson, 2012
- Les Absences du capitaine Cook, 2015
- Ronce-Rose, 2019
- Monotobio, 2026
Livres numériques
- Au plafond
- Choir
- Démolir Nisard
- Dino Egger
- Du hérisson
- L'Auteur et moi
- L'Oeuvre posthume de Thomas Pilaster
- La Nébuleuse du crabe
- Le Caoutchouc, décidément
- Le Démarcheur
- Le Vaillant petit tailleur
- Mourir m'enrhume
- Oreille rouge
- Palafox
- Préhistoire
- Sans l'orang-outan
- Un fantôme
- Le Désordre azerty
- Juste ciel
- Les Absences du capitaine Cook
- L'Explosion de la tortue
- Ronce-Rose
- Monotobio
- La Chambre à brouillard
- Jaune soleil
- Monotobio

