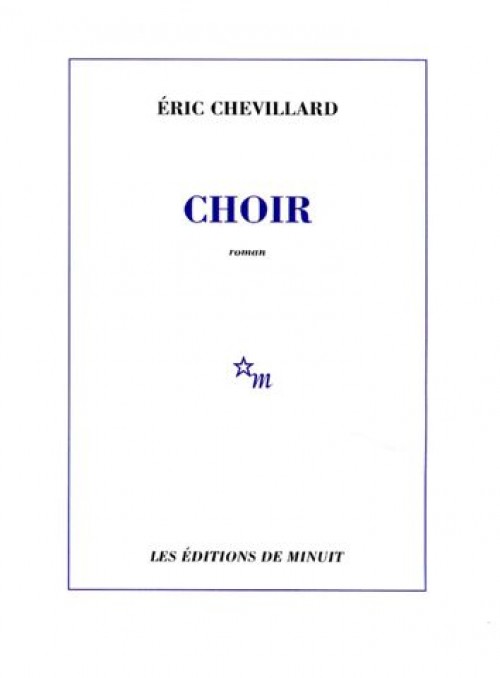
Éric Chevillard
Choir
2010
272 p.
ISBN : 9782707320896
19.25 €
40 exemplaires numérotés sur Vergé des papeteries de Vizille, 60 €
L'île de Choir est un écueil de terre rude, hostile, inclément, et nous, ses habitants infortunés, de toutes nos forces nous le haïssons, nous le honnissons, nous le maudissons. Tous, nous rêvons de partir. Impitoyablement, nous sommes retenus par ses sables et ses boues. Il se raconte pourtant qu'un ancêtre, Ilinuk, né avec une difformité formidable, parvint à s’en arracher pour rejoindre le ciel. Un de ses anciens compagnons vieux comme l’orage et la cendre endort nos douleurs et calme nos plaintes avec le récit de sa vie prodigieuse. Ilinuk a promis de revenir nous chercher. Nous vivons depuis pour cette seule espérance. Et nous guettons son retour, ne cessant de scruter le ciel que pour haïr, honnir et maudire le sol de Choir.
ISBN
PDF : 9782707325112
ePub : 9782707325105
Prix : 13.99 €
En savoir plus
Erwan Desplanques, Télérama, 13 janvier 2010
L'île de la cruauté
Sur Choir, on vit l"enfer. Un texte aussi subtil qu’inconfortable.
On ne peut pas tomber plus bas que Choir. C'est un paquet de boue qu'Eric Chevillard tient entre les mains. Un enfer à la Jérôme Bosch. Une île minuscule et invivable où l'on implore, déplore et tourne en rond. L'écrivain s'est donné la mission de bâtir sur ce socle (de terre et de fiente) un roman inconfortable et puissant, une farce crépusculaire, certainement moins drôle que La Nébuleuse du crabe ou Oreille rouge, mais plus beckettienne que jamais – entendre : plus métaphysique. Choir est donc un livre sur la déréliction. Avec des insulaires qui se racontent des histoires ou qui gémissent, ensablés jusqu'au cou. Incapables d'agir, ils attendent. Invoquent un certain Ilinuk (avatar post-exotique de Godot) et surenchérissent dans l'évocation apocalyptique de leur sort. Car on ne peut pas déchoir de Choir, ni même surseoir à sa loi : on est condamné à y errer, éternellement. Le texte joue de cet enlisement, ressasse, tourne sur lui-même et nous piège. « Le principe même de la répétition nous accable, qui déjà ordonne de bout en bout nos existences. »
Patrick Kéchichian, La Croix, jeudi 14 janvier 2010
Eric Chevillard, démiurge et bricoleur
Avec dextérité, l'auteur de « Palafox » et de « Démolir Nisard » nous conte la vie étrange et douloureuse des habitants de Choir…
Un jour, il faudra bien qu"un théoricien se penche sur cette épineuse question: pourquoi la littérature dite réaliste, attentive aux expériences concrètes de chacun, parvient-elle si mal à nous donner le sentiment de la réalité? Et corrélativement, comment se fait-il qu’un récit fantastique, déconnecté des apparences du réel, puisse nous en rapprocher? Et même dangereusement parfois… Notre enquêteur aura tout intérêt à faire une longue station dans la vaste maison d’écriture d’Éric Chevillard. Là, il pourra inventorier ses objets familiers, observer son visage tandis qu’il agence ses histoires, ouvrage ses phrases avec art. Enfin, lui demander raison de telle ou telle folie dont chacun de ses livres, avec largesse et malice, invente la forme, le contenu, le destin.
La publication de Choir est une occasion rêvée. Avec une souveraine ironie, Chevillard décrit les us et coutumes, la vie, les rêves et les angoisses des citoyens de Choir, une île perdue au milieu de nulle part, au milieu de partout. C’est un peu le Maldoror de l’écrivain. La prose, ici, se fait mythe, chant, incantation, tout en respectant la ligne du récit. Le rire, au lieu de nous distraire, exalte la noirceur du propos. Pour ne rien arranger, chaque proposition est aussitôt contrecarrée, aspirée par un doute systématique: «Le malheur de l’un fait le bonheur de tous les autres, axiome qui se vérifie aussi à l’envers. À Choir, au reste, la réciproque est toujours vraie.» Ah! certes, on perd vite pied dans ces contrées inhospitalières… À la fin, «ce ne sont décidément pas les bonnes raisons de désespérer qui manquent». Il n’empêche, le rythme est là, maintenu, lancinant, avec de brusques accélérations, des embardées, des changements de mode… Si bien qu’en lisant, on a dans la tête une musique étrange, grinçante. Et même, parfois, on se surprend à imaginer une danse adaptée à cette musique - violente, fiévreuse, désarticulée….
Pour aborder les terres inconnues du démiurge Chevillard, pour faire connaissance avec la faune, la flore et l’humanité dont il les a peuplées, il est bon de se laisser guider par un sentiment mélangé, fait d’enchantement et de frayeur, d’admiration inquiète. Parallèlement, il faut récuser l’embarras, les réticences ou les rodomontades de l’esprit fort qui toujours doute, qui toujours sait. Ou croit savoir. Comme à Choir, on ne pose pas de questions. On n’a pas le temps de chercher: il faut trouver, c’est-à-dire survivre.
«BONDIR HORS DE CHOIR!», écrit Chevillard dès la première page de son roman, en capitales, pour restituer le seul vœu, la prière, le hurlement des îliens. Il n’y aurait donc qu’une seule issue pour ces malheureux: partir, «bondir hors», quitter ce lieu de malédiction. Or, ce n’est pas possible. Mais s’agit-il vraiment d’une île, une île classique, avec une mer pour l’enserrer et des terres et des continents à l’horizon? Non, ici, à Choir, cet «anneau de récifs enseveli sous le sable», il y a deux mers immenses, à perte de vue, l’intérieure et «l’autre, l’extérieure, l’environnante». «Nous vivons entourés d’énigmes. Comme un brouillard corrosif, le mystère ronge toute chose à Choir. Point d’angles ici, ni de contours ni d’arêtes, les réalités les plus massives même sont mangées par l’ombre et le doute.»
Pour ajouter à la difficulté, «les enfants de Choir, instables et mouvants comme son sol même», n’ont pas du tout le pied marin. Par conséquent, ce n’est pas de ce côté-là qu’ils peuvent espérer se soustraire à leur sort et gagner des terres plus fermes – celles de Choir étant molles, gluantes, couvertes de «sables gloutons» et de guano. Les rites et les habitudes n’arrangent rien. Ni cette subtile psychologie de masse, qui distingue plusieurs types: «les rechignés, les compassés, les bilieux, les rogues, les malveillants et les revêches, que tout oppose». Une autre catégorie de la population est composée des «rescapés»: ceux-là ont survécu à divers accidents d’avions, venus s’écraser là. Mais peu à peu eux aussi perdent tout espoir, s’assimilent.
Mais surtout, ces infortunés proscrits ont une histoire, c’est-à-dire un passé, et donc, au-delà de leur calamiteux présent – dûment détaillé – un possible avenir. Un rêve, une foi en l’avenir. Le narrateur (comme toute la population dont il fait partie) écoute avec une anxieuse espérance les discours du vieux Yoakam qui, seul, garde mémoire de «la geste d’Ilinuk», fils de Zula et d’Anaphor, dit aussi le Polydactyle, une sorte de Sauveur pourvu d’un orteil en trop, parti un jour de Choir, par le haut, et dont on promet l’imminent, l’urgent retour. « Il nous tendra une main secourable depuis ces hauteurs fabuleuses, il nous habillera d’air et nous hissera jusqu’à lui sans effort. » Mais plus le récit du déclinant Yoakam avance, plus l’espoir décline…
Éric Chevillard procède par accumulation, entassement. Son histoire grossit à vue d’œil. Pour notre plus grand bonheur. À chaque page, elle prend son autonomie, semble se construire toute seule… Grâce à un grand luxe de bizarreries, suivant le flot toujours grossissant des fantasmagories qui s’emboîtent et se répondent, il nous montre, comme dans un miroir, un monde virtuellement réel, et même réaliste. Ce n’est pas le moins réjouissant. Ni le moins inquiétant.
Jean-Baptiste Harang, Le Magazine littéraire, février 2010
Ô Choir,
ô désespoir
Choir est un nom propre, ça tombe bien. Choir est le nom d'une île dont les habitants n"ont qu’une idée en tête : laisser Choir. Comme bien des îles, Choir est une terre entourée d’eau, les presqu’îles ne le sont pas tout à fait, mais que dire de Choir que la mer cerne et décerne à la fois : ses côtes externes sont marines, et elle abrite en son sein une mer intérieure qui n’envie rien à l’autre, car, comme le ruban de Moebius, le dedans et le dehors se confondent. Choir est donc une « presqu’île », mais qui peut le plus peut le moins. Choir peut surtout le moins, et le moins que Choir puisse est d’exercer sur ses habitants une force centripète qui les cloue sur son sol fangeux au point qu’à s’envoler ils y laisseraient leurs bottes. Et pourtant, de cet enfer, ils n’ont d’autres aspirations que de le quitter par les airs comme le fit jadis Ilinuk, qu’ils ne revirent jamais mais qu’ils attendent comme un messie spatial équipé d’une navette plus forte que la pesanteur. C’est le vieil Yoakam qui dit la geste d’Ilinuk, en italique dans le livre et en désespoir de cause sur l’île, jusqu’à devenir inaudible comme la foi sans Dieu.
Le narrateur (un familier de l’auteur, probablement, puisqu’il évoque comme cause de la souffrance de l’île, page 171, l’absence cruelle d’orangs-outans) est natif de Choir, dont on ne sait pas si les habitants s’appellent les Chus. Ils s’efforcent autant qu’ils le peuvent à ne pas se reproduire, ce qui ne suffit pas à contenir la population de l’île, augmentée régulièrement par des crashs d’aéronefs commerciaux qui répandent sur l’île des cohortes de rescapés bientôt gangrenés par la noirceur du lieu, et dont les pièces détachées (contre leur gré) entretiennent vainement l’espérance d’en construire un nouveau qui les délivrerait. Choir est un trou noir où la chute des graves est aggravée par Dieu sait quoi, mais Dieu ne sait rien.
Le sol de Choir est couvert de punaises. À Choir, on cultive la haine des ancêtres. Choir est une mycose sur terre : « Quelques vieux fouineurs connaissent les rares coins sans champignons ; mais ils gardent jalousement leur secret », page 36. À Choir, tout va de travers : « L’état d’ivresse nous est si familier que nous devons plutôt à nos rares moments de sobriété ces visions aberrantes que l’alcool corrige », page 160 ; « Nous maîtrisons les techniques savantes de la porcelaine et de la faïence, mais à quoi bon ? Tous nos autres gestes sont si maladroits », page 170. La laideur fait taire les miroirs au point qu’on cherche à en extraire le mercure pour les réduire à l’état de sable. Ce ne sont pas là que petits malheurs, au regard de la famine, de la violence et de la pourriture qui font Choir. Ces anecdotes par lesquelles Éric Chevillard appâte le lecteur fidèle, par son humour blanc, absurde et sensé, noir, sa poésie, la langue qu’il broie comme un corps qu’on aime et qui intimide, ces anecdotes nous retiennent et nous les retenons, parce que, écrit le narrateur dans sa chronique, « le sens profond de ce récit demeure insaisissable pour notre intelligence de myope ». Il faut nous approcher pour voir le monde qu’Éric Chevillard nous décrit, malgré l’inversion que renvoie le miroir de l’absurde, ce monde est le nôtre, désespéré, vain, sans issue vers le ciel. Et la drôlerie, dont on sait de quoi elle est la politesse, se noue dans nos gorges déployées. Choir est une île, notre île impossible, Choir est une fable comique, philosophique et noire pour un monde déchu.
Sur son blog, le 27 octobre dernier, Éric Chevillard écrivait : « Il existe deux catégories d’écrivains (on me pardonnera, j’adore manier ce sabre tranchant). Ceux qui recherchent l’empathie avec leurs personnages, figures psychologiquement ou socialement circonscrites, découpées dans le monde réel. Et ceux qui affirment une forte singularité, qui haïssent la fausse objectivité gluante et obscène des premiers et qui ont plutôt le souci de donner une forme juste à leur propre conscience du monde. J’ai une préférence, que je laisserai deviner. » Ne donnons pas cette belle langue au chat, nous avons la même préférence, les premiers nous tombent des mains quand nous sommes incapables de laisser Choir. Plus loin (le 7 décembre), alors que ses fidèles ont compris qu’il vient de perdre son père, Éric Chevillard écrit : « La noirceur sans merci de Choir me gênait ; c’est pourtant bien le voile de deuil dont je veux aujourd’hui couvrir le monde. »
Isabelle Rüf, Le Temps, samedi 30 janvier 2010
Une fable aux accents bibliques, d'une noirceur imparable, tel est le dernier roman d"Eric Chevillard, situé sur une île d’où tous les habitants rêvent de choir.
Choir est une île dont les habitants ne songent qu’à fuir, une manière d’atoll hérissé de récifs infranchissables, impossible d’en issir. Même déchoir, descendre plus bas que Choir, se révèle utopique. En des temps immémoriaux, le père fondateur s’est échappé par le haut, sur une fusée. Depuis, le troupeau lamentable attend son retour, comme les indigènes de Papouasie, le cargo qui comblera leurs attentes. Ilinuk le Polydactyle est le nom de ce démiurge. Le vieux Yoakam en perpétue la mémoire par la déclamation d’une épopée que le peuple de Choir écoute avec patience, jusqu’à ce que, page 245, il se fatigue enfin. «Il nous saoule bien un peu, l’ancêtre, avec son infini radotage.» Pour oublier, mieux vaut l’ivresse que procure l’alcool, même si elle risque de déchaîner de regrettables coïts : se reproduire, à Choir, est une faute, un délit, une grave erreur.
On compare souvent l’univers de Chevillard à celui de Beckett : la noirceur, l’humour. Ce serait alors ici le Beckett du Dépeupleur, ce cylindre sans portes ni fenêtres où se meuvent des corps à la limite de l’humain. Ou celui de Cap au pire : «Rater. Essayer encore. Rater encore. Rater mieux.» En une vingtaine de livres, Chevillard a élaboré un champ de ruines, s’attaquant à l’imposture sous ses épiphanies les plus solennelles, déconstruisant les codes avec beaucoup de méthode et de rigueur. Le discours universitaire pontifiant (L’Œuvre posthume de Thomas Pilaster), l’académisme accablant (Démolir Nisard), le récit de voyage gonflé de prétention (Oreille rouge). Comme Michaux, il n’hésite pas à intervenir, à modifier le réel pour corriger les erreurs de la nature et de la culture. Le monde animal est très présent dans cette œuvre, on lui doit la plus jolie métaphore de l’écriture, un hérisson «naïf et globuleux» qui squatte le bureau de l’auteur. Dans Choir aussi, les animaux sont part du paysage, mais ce sont de puantes punaises, et tout un zoo d’inamicales créatures que l’homme s’occupe à détruire avant qu’elles ne l’anéantissent.
Les livres de Chevillard sont toujours portés par une colère entraînante. L’ironie est affûtée, le langage travaille les stéréotypes avec une adresse d’horloger de précision. Sous sa plume, les choses et les êtres sont pris au pied de la lettre, saisis, retournés, vidés, mis à nu. Ils subissent des transformations, des mutations, toujours dans un mouvement de course vers l’abîme. On rit beaucoup avec Chevillard. Mais depuis Sans l’orang-outan, en 2007, une tonalité plus noire, un son plus grave battent une basse continue. Dans ce roman, la disparition des grands singes devenait le signe d’une décadence de l’humanité, prostrée dans l’attente d’un sauveur, dans une régression dégradante. Cette angoisse imprègne aussi Choir, en rend même la lecture éprouvante, en dépit de la drôlerie et de la virtuosité. Cette humanité méchante, stupide, aveugle, aussi démunie qu’un oiseau tombé du nid, soumise à d’ineptes idoles, est beaucoup trop ressemblante.
«J’écris toujours le même livre ; seuls les mots changent», écrit l’auteur le 17 mai 2009, sur le site de l’Autofictif (http://l-autofictif.over-blog.com), ce journal en ligne dont son cénacle d’admirateurs connaît l’adresse. Chevillard y entre tous les jours trois pensées : réflexions, choses vues, pirouettes, hommages à Agathe, petite fille de quelques mois. Les Editions de l’Arbre vengeur en ont publié deux volumes. Le deuxième vient de sortir, qui court du 18 septembre 2008 au 17 septembre 2009, L’Autofictif voit une loutre (ce qu’il fait le 1er mars 2009). Parodie du genre de l’autofiction, c’est une mise en pièces de la figure de l’écrivain, un recueil de perles absurdes ou acides, jonché d’éclats de poésie pure, une vraie composante de l’œuvre. «Tout journal relate la lutte d’un homme seul contre tous. Il est par conséquent destiné à séduire, circonvenir ou intoxiquer l’ennemi »: le lecteur reste donc séduit, circonvenu, intoxiqué.
Maurice Mourier, La Quinzaine littéraire, 1er au 15 février 2010
L'argument de Choir, cela ne surprendra pas l"amateur, se résumerait en peu de lignes. Sur une île en forme d’atoll balayé par les vents, pourrie de marécages, envahie de punaises et de mouches, une humanité misérable se traîne, ne trouvant la force de survivre qu’en écoutant, jour après jour, l’histoire de l’un des siens, racontée en boucle par une espèce de prophète hirsute qui prédit le proche retour de l’évadé. Car celui-ci, né monstrueux (six orteils à chaque pied), est le seul îlien à avoir su quitter ce séjour infernal, en construisant une fusée à partir des débris de récurrentes catastrophes aériennes. Ilinuk, c’était son nom, dès sa disparition, s’est changé en un dieu, au moins dans les éructations de Yoakam. Nul doute qu’il ne doive revenir en son vaisseau splendide pour sauver ses anciens compagnons d’infortune.
Et c’est bien ce qui se passe. Sauf que l’apparition finale de l’OVNI constitue une apocalypse, au deux sens du terme, une révélation effroyable (Ilinuk était une pure invention de son rhapsode, le monstre polydactyle se confondant avec Yoakam), une catastrophe sans nom (le serpent extraterrestre aux mille têtes n’embarque que les punaises).
Entre l’invocation initiale à Ilinuk le grand le miséricordieux et cette fin abruptement déceptive, deux cent cinquante pages où rien ne se passe, sinon, au plan anecdotique, un aperçu des occupations et coutumes d’un peuple terrassé, une sorte de Voyage en Grande Garabagne mais horriblement circulaire, clos sur lui-même et, nous le comprenons à la fin, pour l’éternité, une éternité sans rédemption ni remède. Or, de rédemption il serait grand besoin, car ces hommes-là sont méchants comme la gale, ils haïssent leur terre, ils se haïssent entre eux, ils se haïssent eux-mêmes, tourmentent les enfants qu’il leur arrive de procréer par une négligence coupable, désolent leurs bêtes de somme, salopent leurs productions vivrières, bouffent des ordures, abritent cependant en marge de leurs hideuses cohortes des artistes qu’ils persécutent et méprisent.
En tout cela, bien sûr, c’est à nous qu’ils ressemblent avec fureur et nous ne sommes guère étonnés d’apprendre, sous la plume du scribe anonyme qui depuis le début consigne les horreurs dont il est témoin - il ne le fait que par devoir et dans l’espoir d’assister en pécheur repentant à la parousie d’Ilinuk –, que l’épouvantail censé se dresser au centre de l’île, ce mannequin que tous redoutent même d’entrevoir, en réalité n’est lui aussi qu’un fantasme suscité par la rencontre de chacun avec chacun à quelques croisement des routes de leur commune prison.
Le jeu de Flaubert avec la lettre du texte biblique dans Hérodias laisse subsister tout entière la possibilité que la décapitation de son Ioakanann (Jean-Baptiste) et l’énigmatique formule « Pour qu’il croisse, il faut que je diminue » annonce effectivement la venue du Christ sauveur.
Beckett laisse tout entière subsister la possibilité que l’attente de Wladimir et Estragon, qui espère Godot et voient arriver Pozzo le tyran, finisse un jour par être récompensée, l’imposteur Pozzo une fois rentré dans le néant.
Chevillard, qui se souvient de l’un et de l’autre, fait de ses piètres héros des vaincus définitifs. Ne subsiste plus en Yoakam qu’un écho tronqué de Iaokanann. Quant au scribe de Choir – c’est le nom même de la terre qui le porte –, impossible à lui de conserver la moindre illusion sur la venue ultérieure d’Ilinuk, puisqu’il a vu de ses yeux que Yoakam (pendu et non décapité, tandis qu’autour de lui fluctue la farandole obscène des têtes, qui dégouline du vaisseau spatial) et Ilinuk, en somme que Godot et Pozzo, ne font qu’un, la foi du charbonnier s’étant effondrée d’elle-même sur elle-même. La brutalité avec laquelle Chevillard répond au « retour du religieux » dont on nous rebat les oreilles serait donc rafraîchissante.
Mais le tragique de Choir réside en cela : que son attaque frontale contre tout mythe religieux aboutit à un mur. Les sinistres habitants de Choir s’entêtent stupidement à rêver d’un au-delà de leur séjour funèbre. Ils pataugent dans le cloaque où ils ont chu de naissance et tout prouve – tout a prouvé depuis le commencement du livre, et du monde – que leur chance de s’en tirer est inexistante. Il faut se rappeler les moments de plus intense désespoir de Michaux, celui de Mes propriétés ou de certaines des Tranches de savoir (« Qui laisse une trace laisse une plaie », et surtout peut-être « La fenêtre de la perruche ouvre sur une perruche ») ou de L’Espace aux ombres qui ferme Face aux verrous (« Le cri de la douleur intime est notre cri. Mais personne ne bouge. Qui, dans un hôpital, se retourne pour un gémissement ? »), si l’on veut aborder au rivage affreux de Choir, à notre rivage.
Ici, contrairement à ce qui se joue, au moins entre les lignes, dans maints autres livres, aucune présence de la créature féminine qui vient hanter, ou émoustiller à distance, la dérive en forme de monologue du narrateur habituel de Chevillard, si bien que, comme le dit La Fontaine dans Les Animaux malades de la peste, « Plus d’amour, partant plus de joie ». On note bien, de loin en loin, le passage fuligineux d’une certaine Zee, mais son ami ne la mentionne que pour la fuir, se prémunissant avec une sorte de terreur contre le risque de la rencontrer, et mesurant paradoxalement les progrès de leur passion réciproque au succès des ruses qu’ils déploient l’un et l’autre pour s’éviter. Peur des conséquence possibles et dégoût de la perpétuation de la maudite espèce qui perdure pour son malheur sur un sol ingrat doté de tous les attributs du réel : on y croise des animaux (chiens, chats et des carnassiers plus considérables, ours, lion, panthère, loup ; les insectes piqueurs y pullulent), des « ateliers » y fonctionnent, on y cultive des légumes, même s’ils n’entrent en composition que de brouets infâmes.
Qu’y a-t-il donc qui séduise si fort dans Choir, auquel manque assez singulièrement l’ingrédient de comique décalé et faussement maladroit (à la Harry Langdon) sur lequel reposait en partie le succès de Chevillard, auprès toutefois des seuls lecteurs capables d’apprécier le charme du second degré ? La réponse est aisée : Choir, c’est deux cent cinquante pages de vraie littérature, où le style unique de l’écrivain se déploie avec une virtuosité qui n’a jamais été aussi grande.
C’est d’ailleurs en examinant d’un peu près cette virtuosité que l’on comprend, malgré la différence frappante des tons (plus folâtre jadis et même naguère, plus assombri et, si l’on veut, « sérieux » dans Choir), l’unité d’une écriture foncièrement répétitive – au sens où l’est, par exemple, la musique de Phil Glass, ou celle de Bach. Tout, dans ce dernier livre, si construit, si écrit, n’est en effet que variation, selon le principe du poème à forme fixe tel qu’il a été inventé par le Moyen Âge, transformé et autrement codifié par Pétrarque, continué par les Grands Rhétoriqueurs puis la Pléiade. Il s’agit d’un travail au petit point d’une extrême difficulté (dans les dizains de Maurice Scève par exemple), qui consiste à produire « n » textes à partir d’un seul thème (la rencontre amoureuse dans la Délie de Scève, le pourrissement du monde, dans Choir), et par conséquent, dans ce dernier texte, de trouver d’infinies variations autour du noir ou du gris, de l’attente du Messie, de la tristesse et de la déréliction, de l’ennui des jours, du rien des paysages, etc.
Ainsi la matière même dont Choir sera tissé est-elle donnée au lecteur (en trois volets : évocation d’une terre immonde, imprécation des condamnés à y vivre, récit en italiques de la saga d’Ilinuk, vociférée par Yoakam) dès les trois premières pages du livre, chacun des paragraphes qui le composent constituant une variation savante, retorse, inventive, à partir de cette immuable donnée triple. Or ce type d’écriture était à l’œuvre dès les débuts de Chevillard.
Mais l’auteur écrit aujourd’hui en s’imposant une contrainte supplémentaire, qui était déjà celle de l’antique forme fixe et notamment du sonnet. Chaque variation, ou paragraphe, doit s’achever sur ce que Pétrarque nommait un concetto, une « pointe », image frappante, chute inattendue, trait d’esprit. Et comme Chevillard n’en est pas à une gageure près, il faut que le livre, pris cette fois dans son ensemble, ne soit en fin de compte qu’une manière de sonnet démesuré, dont l’ultime variation offre la plus surprenante, la plus haute, la meilleure « pointe » possible, ramassant la totalité du texte en cette fulgurante et néanmoins simple équation : Yoakam = Ilinuk.
Pour qui aime la perfection formelle, et que l’exercice de style en sa splendeur (celle, mettons, d’un Ponge) épanouit pleinement, la lecture de Choir s’impose.
Amaury da Cunha, Le Monde, vendredi 26 février 2010
Une île à contre-courant
Eric Chevillard élabore avec « Choir » un cauchemar rendu irrésistible par la virtuosité de son écriture
La lecture d'un livre remarquable donne cette impression jouissive qu'il n'y a rien eu de vraiment semblable avant lui, et qu'on ne voit ce qui pourrait l'égaler. C'est ce qu'on ressent en découvrant Choir, le nouveau texte d'Eric Chevillard, né en 1964. Depuis son premier livre (Mourir m'enrhume, Minuit, 1987), son œuvre est réputée pour son mélange habile de désinvolture et de haute précision stylistique : romans loufoques, virtuoses (citons La Nébuleuse du crabe, ou Démolir Nisard, Minuit, 1993 et 2006), tous ses récits sont traversés par un vent de folie, une énergie joyeuse qui, à chaque récidive, les emporte un peu plus loin.
Choir est un livre qui fascine en même temps qu'il échappe à l'entendement. Il fait partie de ces textes exigeants qui s'écartent des genres tolérés par l'époque, embarrassent et désarment. Certains auteurs réputés audacieux, mais bloqués dans une image hermétique, restent dans l'ombre. Il y en a qui s'en félicitent en misant une justice tardive de l'histoire ; d'autres, comme Eric Chevillard, en ricanent : "J'ai parfois l'impression que le cercle de mes non-lecteurs ne cesse de s'élargir."
De quoi est-il question, dans ce livre, pour qu'il suscite une telle admiration ? C'est l'éternelle affaire du genre, qui, dans ce cas précis, est difficile à identifier : on ne va pas s'en plaindre. Il y a bien écrit "roman" sur la couverture, mais quand on referme Choir, on ne sait plus trop ce que roman veut dire, tant il a déjoué nos attentes et suscité de la réjouissance là où ne l'attendait pas.
"Bondir hors de Choir"
Car Choir est un enfer couché sur le papier. Situation romanesque peu compatible avec la joie, semble-t-il. C'est une île au milieu de nulle part, que ses habitants cherchent à tout prix à fuir. Lande de terre visqueuse, spongieuse. Cloaque que la vie semble avoir déserté. "Bondir hors de Choir", éructe le narrateur, en porte-parole de sa communauté maudite. Page après page, il répète ce motif lancinant qui accapare bientôt le roman tout entier : "HORS DE CHOIR BONDIR ! ISSIR ! m'arracher à ses glus, à ses boues, élargir les huit trous de mon corps afin que s'écoule au travers tout le sable de Choir !"
Quand cette clameur s'atténue, la description de Choir se précise et justifie l'urgence du départ : c'est bien le désastre qui a pris possession de l'île. La plupart de ses habitants sont en effet les rescapés de catastrophes aériennes. Quant à leurs enfants, ils sont nés "des suites fâcheuses d'un moment d'égarement dû à l'alcool". Comme ils redoutent la reproduction de leur espèce maudite, ces insulaires font croire aux jeunes gens que la sodomie est le seul acte reproducteur. Mais à Choir, tout est vicieux, et de cette "jouissance stérile" les nourrissons naissent quand même, "exactement semblables aux autres, un peu plus joufflus peut-être".
Si le cauchemar menace la vie d'être noyée dans la boue de Choir, un espoir persiste cependant dans le cœur de chacun : il s'appelle Illinuck, dit le Polydactyle, a six orteils à chaque pied, est parvenu à quitter l'île dans sa fusée stellaire, et c'est un dieu vénéré. Pourra-t-il seulement revenir à Choir et sauver ces "éternels gisants" ? Tel est l'argument de ce livre inspiré, comme le confie Eric Chevillard, par un tableau de Jérôme Bosch, Le Jardin des Délices, et plus précisément par le troisième panneau du triptyque, qui représente les tourments de l'enfer. On retrouve dans le texte ce qui saute aux yeux dans la peinture du Flamand : la débauche de détails sordides, leur rendu proprement hallucinatoire et les rires embarrassés qu'ils suscitent.
Mais l'écrivain ne se contente pas du simple décalque d'une image : le tableau de Bosch n'est qu'un moteur d'écriture. Les phrases, puissantes et lyriques, le dépassent, fidèles à ce programme : anéantir verbalement l'île.
Eric Chevillard réussit ce tour de force que l'on rencontre aussi dans les livres de Thomas Bernhard : mettre en place une mécanique qui repose sur le développement d'un seul sujet contre lequel la langue bute sans cesse, mais qui provoque le jaillissement perpétuel des mots. Choir est bien ce motif inépuisable qui défie le langage, mais dont il n'arrive jamais à bout : les mots sont impuissants face à la pesanteur du monde, mais ils ont le pouvoir de se substituer à lui par une action qui s'appelle poésie.
Farce noire
Ce roman appartient-il à la folie d'un esthète ? Choir fête-t-il le triomphe du grand n'importe quoi ? On peut être tenté de le penser, car Chevillard est en droit de se moquer de nous. Mais le lecteur, entre les lignes de cette farce noire, réussit à faufiler son rire. Peut-être pour dissiper le spleen de cet endroit maudit. La grande qualité de ce texte est qu'il laisse la liberté de choisir sa propre distance par rapport à lui. Exactement comme un tableau qui autorise le spectateur à se placer où il veut : le nez dessus, ou dix pas en arrière.
Dans un livre qu'il publie en même temps que Choir (L'Autofictif voit une loutre. Journal 2008-2009, L"Arbre vengeur, 252 p., 15 €), Eric Chevillard semble finalement bien embarrassé par ce qu'il a commis : "Voici un livre bien peu aimable, peu plaisant. Non, mais qu'est-ce que c'est ce monstre ? D'où sort-il ? Où va-t-il ?" Mais après tout, ce n'est plus son problème. Qu'il laisse alors au lecteur la permission joyeuse de répondre aux questions : avec Choir, il en prend pour longtemps.
Pierre Jourde, Le Nouvel Observateur, 18 mars 2010
L'art de la chute
En inventant l"île de Choir, l’auteur de « Démolir Nisard » ne tombe pas au fond du trou. Au contraire !
Eric Chevillard, depuis vingt ans, refait notre monde avec des mots. La condition humaine n’est pas toujours désopilante. Nous y ajoutons la banalité. Nous ne pouvons pas nous en empêcher : nous produisons du cliché. Certains, qui veulent être différents, comme toute le monde, essaient d’y échapper par l’originalité à tout prix. En général, le résultat est accablant. Avec du cliché, Chevillard vous bricole de petites merveilles verbales, comme ces peintres qui fabriquent des chefs-d’œuvre avec des rebuts. On les admire, on tourne autour, ainsi que devant certains appareils ingénieux dont on se demande comment ils fonctionnent.
A force de refaire le monde, Chevillard a fini par en inventer un : l’île de Choir. Difficile de tomber plus bas. Un trou perdu. On n’y partirait pas en vacances. Ici-bas, quoi. Le livre, dans sa méthode, prolonge l’extraordinaire « Démolir Nisard ». Le principe est simple : on s’équipe d’un objet quelconque et de beaucoup d’énergie négative. A partir de là, on détruit. En principe, on ne devrait pas aller bien loin. Or c’est le contraire qui se produit, et l’on pourrait appliquer à Chevillard ce que Breton disait de Huysmans : « Par l’excès des couleurs sombres de sa peinture, par l’atteinte et le dépassement dont il est coutumier d’un certain point critique dans les situations désolantes […], il parvient à ce résultat paradoxal de libérer en nous le principe de plaisir. » A force d’inventivité dans la détestation ou la catastrophe, l’auteur de « Choir » réussi l’exploit de retourner le négatif en positif, de créer un univers réjouissant en décrivant le patelin le plus désastreux. Avec presque rien, il déclenche un big bang littéraire d’où surgissent des mondes inconnus.
La densité de ces corps célestes est plus grande que celle de notre planète. Le rêve de Chevillard, ce serait d’écrire un roman qui ait la compacité d’une maxime. Ici, chaque phrase est calculée, chaque mot pèse de tout son poids. Il faut, pour l’explorer, se munir d’un instrument qui se fait rare : l’attention. Qui accepte de se laisser entraîner dans « Choir » fera des trouvailles fabuleuses. Il découvrira l’utilité du nuage portatif, pour disparaître enfin dans la grisaille ; il observera les autochtones se croiser en courant, et tenter de deviner quel est le prédateur lancé à la poursuite de l’autre ; ou se faire torturer pour trouver un peu de distraction ; ou encore chercher de petits travaux à faire exécuter aux fœtus inoccupés dans le ventre maternel. Clou de cet affligeant défilé : le retour du Sauveur, de l’être légendaire qui a seul réussi jadis à échapper à Choir. Scène hallucinante, entre l’abominable et le burlesque. « Choir » : un concentré d’humour noir et de succulente amertume, à déguster en connaisseur.
Du même auteur
- Mourir m'enrhume, 1987
- Le Démarcheur, 1989
- Palafox, 1990
- Le Caoutchouc, décidément, 1992
- La Nébuleuse du crabe, 1993
- Préhistoire, 1994
- Un fantôme, 1995
- Au plafond, 1997
- L'Oeuvre posthume de Thomas Pilaster, 1999
- Les Absences du capitaine Cook, 2001
- Du hérisson, 2002
- Le Vaillant petit tailleur, 2003
- Oreille rouge, 2005
- Démolir Nisard, 2006
- Sans l'orang-outan, 2007
- Choir, 2010
- Dino Egger, 2011
- L'Auteur et moi, 2012
- Le Désordre azerty, 2014
- Juste ciel, 2015
- Ronce-Rose, 2017
- L'Explosion de la tortue, 2019
- Monotobio, 2020
- La Chambre à brouillard, 2023
Poche « Double »
- Palafox, 2003
- La Nébuleuse du crabe , 2006
- Oreille rouge , 2007
- Le Vaillant petit tailleur , 2011
- Du hérisson, 2012
- Les Absences du capitaine Cook, 2015
- Ronce-Rose, 2019
Livres numériques
- Au plafond
- Choir
- Démolir Nisard
- Dino Egger
- Du hérisson
- L'Auteur et moi
- L'Oeuvre posthume de Thomas Pilaster
- La Nébuleuse du crabe
- Le Caoutchouc, décidément
- Le Démarcheur
- Le Vaillant petit tailleur
- Mourir m'enrhume
- Oreille rouge
- Palafox
- Préhistoire
- Sans l'orang-outan
- Un fantôme
- Le Désordre azerty
- Juste ciel
- Les Absences du capitaine Cook
- L'Explosion de la tortue
- Ronce-Rose
- Monotobio
- La Chambre à brouillard
