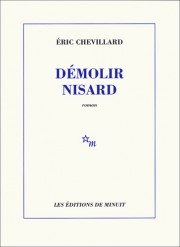
Éric Chevillard
Démolir Nisard
2006
176 p.
ISBN : 9782707319654
14.20 €
40 exemplaires numérotés sur Vergé des papeteries de Vizille
Pour se connaître enfin soi-même, il n'est pas de meilleur moyen que de connaître bien son ennemi. Ordinairement, celui-ci ne fait pas mystère de sa personne : on ne voit et on n'entend que lui partout. Mais le narrateur de ce livre va devoir s'employer à débusquer le sien, mort en 1888 et oublié presque aussitôt. Désiré Nisard, critique littéraire académique et compassé, sermonneur versatile, n'en a pour autant pas fini de nuire. Il a pesé de tout son poids sur la trame légère des jours comptés à l'humanité. Il a contribué au malheur de celle-ci, aujourd'hui encore accru par les fatales conséquences de ses moindres opinions et petits gestes mesquins. Tout cela appelle une juste vengeance. Désiré Nisard doit disparaître. L'idéal serait qu'il n'ait jamais vécu. La plus infime trace de son existence sera effacée. Ce livre entend lui régler son compte une bonne fois.
ISBN
PDF : 9782707325150
ePub : 9782707325143
Prix : 9.99 €
En savoir plus
Démolir Nisard ? Voilà un programme contenant bien de la brutalité et de la négativité, diront les âmes sensibles. Chouette, se diront les autres, qui connaissent peut-être l’ironie de l’auteur, et qui tireront de leur lecture un effet euphorisant peu commun. Le quatorzième roman d’Éric Chevillard est un bain de jouvence, une délectation.
Qui s’agit-il de « démolir » ? Nisard, Jean Marie Napoléon Désiré Nisard, né en 1806, homme politique, écrivain, critique littéraire, mort en 1888, sitôt oublié. Pourquoi, dans ces conditions, s’en prendre à lui ? C’est qu’aux yeux du narrateur, ce Nisard académique existe encore, son fantôme maléfique hante toujours notre monde, son pouvoir de nuisance n’a jamais cessé.
On serait, en effet, très tenté de le croire, si l’on veut bien considérer cet individu comme emblématique. Voilà un personnage dont la carrière politique n’est faite que de palinodies et de retournements de veste. Monarchiste pour commencer, républicain quand il l’a fallu, bonapartiste à l’avènement de Napoléon III, sous le règne duquel Nisard obtient hautes fonctions et distinctions. Son vrai parti fut celui de l’opportunisme et de la soumission aux pouvoirs. Un jour, il s’attira l’antipathie de ses jeunes auditeurs pour avoir déclaré, au pupitre de l’Université, qu’il existait deux morales : celle d’en bas, qui se devait d’être impitoyable, celle d’en haut, qui admettait quelques licences… Son point de vue sur la littérature de son temps ne le sauve pas. Selon lui, rien n’a été écrit depuis le XVIIe siècle. Le credo du déclin permanent depuis deux siècles. Un bonheur.
On se dit qu’effectivement, Nisard est très actuel. Ne citons pas les noms de nos Nisard, qui reçoivent prébendes, jugent fichue la littérature française : on mourrait d’ennui tant la liste serait longue. Démolir Nisard, oui, quel programme enthousiasmant ! On est de tout cœur avec Éric Chevillard. Et celui-ci y va sans compter : « Le gaver de cailloux. Planter dans son œil un clou. Effranger la peau de ses chevilles. Polir sur son crâne les six faces du pavé. Lui promettre et ne pas tenir. Le pousser de l’avion. Désherber son golf. Le vendre pour sa fourrure à un taxidermiste aveugle. Couler sa barque. Saigner dans son lait. Rire de ses deuils. Farcir de grelots sa panse… » Etc. Dans son exercice de détestation, Éric Chevillard fait preuve d’une fantaisie d’inspiration qui n’a d’égale que la rigueur inventive de sa syntaxe. Il cogne sec et comiquement : on pense à Thomas Bernhard interprété par Mel Brooks. Le titre du seul texte de fiction signé par Nisard – Le Convoi de la laitière – donne lieu à une fine analyse marxisto-lacanienne… Bref, ça fait feu de tout bois.
Quand, tout de même, un doute vient. À force de voir Nisard partout – jusque dans des dépêches d’agences de presse, où son nom remplace celui de Bush ou du baron Seillière : l’horreur absolue ! – et de ne pas se départir d’une colère démesurée toujours plus obsédante, délirante, le narrateur ne serait-il pas en train de perdre la raison ? C’est là, précisément, que Démolir Nisard réhausse son ambition. S’il ne s’était agi que d’un brûlot romanesque, s’attaquant aux esprits paillassons et réactionnaires, l’ouvrage eût été goûteux mais d’une visée raisonnable. Au contraire, avec ce Nisard indestructible et omniprésent, le narrateur finit par prendre conscience qu’un livre sans Nisard, qu’un monde sans Nisard – l’autre mot qui désigne le mal – sont impossibles à concevoir. Il en tire toutes les conséquences.
Dès lors, le roman prend une dimension infiniment sérieuse et, d’un premier abord, inquiétante. Cette impossibilité de renvoyer le monstre au-delà de l’horizon invite à cette position existentielle : s’il est irréductiblement présent partout, le monstre est aussi en moi. Autrement dit, l’inhumain Nisard serait donc dans l’humain Chevillard (tiens, tiens, la rime…). Point de relativisme ici, mais une éthique de la responsabilité. Dans Démolir Nisard, elle est simplement un peu plus rigolote qu’ailleurs.
Christophe Kantcheff, Politis, jeudi 14 septembre 2006
Autant le dire tout de suite : le quatorzième roman d’Éric Chevillard se présente comme la réponse la plus cinglante, la plus inattendue, la plus complète et la plus drôle aux prophètes du déclin littéraire français. Ceux-là mêmes qui ont repris à leur compte l’entreprise du « fossoyeur » Désiré Nisard. Né en 1806 en Côte-d’Or, dans la petite ville de Châtillon-sur-Seine qui – simple hasard ou manifestation d’un climat ? – se fera plus tard connaître par la richesse de ses sites archéologiques, ce critique très en vue, directeur de l’École normale supérieure et doyen de l’Académie française, se distingua en effet par une vipérine détestation de la littérature de son temps, illustration pour lui d’un irrémissible déclin dont il faisait remonter l’origine à la fin du… XVIIe siècle.
Éric Chevillard précise ici une réflexion qui s’est affirmée au fil de ses livres. Sur la liberté de création face au poids de l’héritage. Sur le droit à l’imaginaire face à la sacralisation des textes. Sur le devoir d’excès face à la norme linguistique. Comment faire œuvre littéraire quand prédomine encore une dévastatrice idéologie passéiste, y compris sous quelques astucieux habillages « modernes » ? À cette question, l’écrivain répond de façon concrète, par l’écriture. Faisant de Nisard la figure allégorique de toutes les conventions, de tous les renoncements, de toutes les tricheries, de tous les opportunismes. Allant jusqu’à identifier sa présence dans de pitoyables faits divers pour romans à quatre sous, le débusquant partout où triomphe le convenu et le prosaïque, flairant son passage quand se trament des accommodements sans gloire. On le voit ainsi buter à chaque instant sur le vieux donneur de leçons, en tous lieux reconnaître son héritage, tout ensemble prudhommesque et atrabilaire. Littéralement réactionnaire. On n’a guère de peine à suivre son regard. Il lui invente une foule d’avatars contemporains, imagine avec eux de furieuses empoignades dans des scènes délirantes. Et cite par extraits, tout du long, l’article au vitriol qu’un autre Bourguignon, Pierre Larousse, consacra à la sommité châtillonnaise dans son Dictionnaire universel. Il termine par le prétendu hommage que lui rendit, à sa mort en avril 1888, Charles Bigot, ancien élève de Normale sup, lui-même grand spécialiste des éreintages : en fait une mise au tombeau d’une fielleuse férocité. Être ou devenir Nisard, hier ou aujourd’hui, ne serait-ce pas l’apparition d’un « premier signe de la vieillesse » ?
Il se trouve que Nisard, en parfait pionnier d’une critique obsédée par le passage à l’acte, se crut autorisé à commettre un jour un récit, Le Convoi de la laitière. Un texte qu’il parut ensuite s’attacher à vouloir dissimuler, le titre laissant légitimement penser à quelque polissonnerie. Quand Éric Chevillard le retrouva, caché dans la touffeur d’une revue, il découvrit une oeuvrette sidérante de platitude et de moralisme pontifiant. Celui qui donnait des leçons de grandeur littéraire aux écrivains de son temps et ne cessait de leur opposer les géants du passé avait accouché lui-même d’une poignée de pages misérables. Là encore, il n’est pas difficile de suivre le regard de l’auteur. Mais celui-ci n’en reste pas là. En présentant ce portrait à l’acide, en dénonçant plus généralement une vision fixiste et réductrice du littéraire, il trace aussi le champ de sa propre ambition : écrire ses romans de telle sorte que rien « ne se produirait comme dans les autres livres. » Très exactement ce que l’on peut observer depuis Mourir m’enrhume (1978). Car Éric Chevillard possède à la perfection l’art de rendre essentiels les détours de ses récits, en choisissant des cheminements improbables et déroutants.
Si dans un roman, hormis les productions rigoureusement calibrées, rien ne tombe jamais vraiment d’aplomb, lui-même pousse à l’extrême ce décadrage des lignes. Qu’on se rappelle Le Vaillant Petit Tailleur (2003), dans lequel il suggérait le foisonnement des pistes d’écriture possibles, à chaque page du conte des frères Grimm. Démolir l’esprit nisardien, décontenancer, oser, choquer, inventer ses voies propres, le meilleur de la littérature s’y emploie. Mais l’attaque est aujourd’hui frontale. Et c’est un régal.
Jean-Claude Lebrun, L’Humanité, 7 septembre 2006
En vingt ans, quinze livres, une constante liberté de ton, un sens de l’autodérision et du jeu, du brio et de l’humour : voilà les qualités d’Éric Chevillard, 42 ans. Terribles défauts en un temps où la lourdeur passe pour le sérieux et le ton lugubre pour de la profondeur.
Déjà, en 1987, commentant le premier roman de Chevillard, Mourir m’enrhume, Bertrand Poirot-Delpech déplorait une époque malade de « la solennité. Que dis-je ? La componction, laquelle est à la gravité ce que sont, au caviar, les lentilles. Tant d’empois au pays d’Aymé, Audiberti, Queneau, Vialatte et Perec : quelque chose ne va plus. » Depuis, la situation s’est fortement aggravée.
Après l’invention d’un critique hargneux (L’Œuvre posthume de Thomas Pilaster, 1999), après un autoportrait de l’artiste en hérisson (Du hérisson, 2002), ce n’est certainement pas ce Démolir Nisard, où l’on rit à chaque page, qui va donner à Chevillard le fameux empois nécessaire au succès.
Pourtant, quoi de plus grave et de plus sérieux pour un artiste que le désir d’en finir, pour les siècles des siècles, avec une critique nourrie de grandiloquence et de ressentiment ? Chevillard a choisi comme emblème de sa passion destructrice Jean Napoléon Désiré Nisard (1806-1888), élu à l’Académie française en 1850 contre Alfred de Musset, mais il vise tous ses avatars, ceux dont on peut aujourd’hui encore écrire : « Par ses idées étroites et arriérées, par sa morgue pédantesque, Nisard était naturellement désigné aux suffrages de l’Académie » (pour la liste, voir le site www.académie-francaise.fr).
Car Nisard « ne s’est déjà que trop prolifiquement reproduit, l’animal. Il est temps d’interrompre cette descendance, de tarir cette sève où grouillent comme têtards dans une vasière les agents morbides de la propagation du Nisard et qui s’écoule hors de lui par saccades comme une hémorragie ». Vaste programme.
Encore faut-il se prémunir contre la tentation nisardienne de se faire le champion du passé, de diviser la littérature en deux camps, la littérature facile et la littérature difficile. Ou bien, à l’inverse, s’imaginer tuer Nisard en vantant une supposée modernité conduisant à dire : « Oui, je peux aimer Corneille, quand il s’y met, même si la littérature a évolué depuis, progressé peut-être. »
Le narrateur sait tout cela, et ne fait pas de triomphalisme : « C’est une grande douleur de savoir que Nisard a pesé de tout son poids sur le cours des choses, qu’il fut à l’origine d’une chaîne infinie de conséquences dont les roues tournent encore. » Quelle est la part du masochisme dans la volonté frénétique de démolir Nisard ? Heureusement, Chevillard sait subvertir cette obsession en inflation comique. Nisard est partout. Ses réincarnations contemporaines sont parfois compromises dans des faits divers plus ou moins glauques.
La démonstration par l’absurde est un art auquel Chevillard est rompu. Il se fait aider ici de Pierre Larousse, qui, dans son premier dictionnaire, consacra une longue notice à Nisard, encore vivant. Toutefois, certaines phrases de Larousse ont un furieux air de Chevillard…
La compagne du narrateur, Métilde, une femme qui a, elle, les pieds sur terre, tente de comprendre, voire de modérer les pulsions meurtrières d’un homme qu’elle aimait pour ses « baumes », ses « onguents », ses « caresses ».
On a le choix entre prendre son parti, et, au contraire, décider de s’enrôler pour démolir Nisard, car le narrateur sollicite assistance : « Je ne cracherais pas sur un peu d’aide. Rejoignez-moi. Mettons-nous à plusieurs », contre tous les Nisard de la terre pour qui « la littérature est un bien triste missel, une école de résignation. Le lecteur y vient tête basse entendre des sermons et des réprimandes.(…) La folie, la fantaisie, la satire, la hargne et le défi, la mélancolie et tous les autres soleils noirs de la poésie ont roulé dans le fossé. »
Ensuite, et enfin, grâce au geste salutaire de Chevillard et de tous ceux qu’il a gagnés à sa cause, les artistes pourront passer à la phase suivante : ignorer Nisard.
Josyane Savigneau, Le Monde, vendredi 22 septembre 2006
Du même auteur
- Mourir m'enrhume, 1987
- Le Démarcheur, 1989
- Palafox, 1990
- Le Caoutchouc, décidément, 1992
- La Nébuleuse du crabe, 1993
- Préhistoire, 1994
- Un fantôme, 1995
- Au plafond, 1997
- L'Oeuvre posthume de Thomas Pilaster, 1999
- Les Absences du capitaine Cook, 2001
- Du hérisson, 2002
- Le Vaillant petit tailleur, 2003
- Oreille rouge, 2005
- Démolir Nisard, 2006
- Sans l'orang-outan, 2007
- Choir, 2010
- Dino Egger, 2011
- L'Auteur et moi, 2012
- Le Désordre azerty, 2014
- Juste ciel, 2015
- Ronce-Rose, 2017
- L'Explosion de la tortue, 2019
- Monotobio, 2020
- La Chambre à brouillard, 2023
Poche « Double »
- Palafox, 2003
- La Nébuleuse du crabe , 2006
- Oreille rouge , 2007
- Le Vaillant petit tailleur , 2011
- Du hérisson, 2012
- Les Absences du capitaine Cook, 2015
- Ronce-Rose, 2019
Livres numériques
- Au plafond
- Choir
- Démolir Nisard
- Dino Egger
- Du hérisson
- L'Auteur et moi
- L'Oeuvre posthume de Thomas Pilaster
- La Nébuleuse du crabe
- Le Caoutchouc, décidément
- Le Démarcheur
- Le Vaillant petit tailleur
- Mourir m'enrhume
- Oreille rouge
- Palafox
- Préhistoire
- Sans l'orang-outan
- Un fantôme
- Le Désordre azerty
- Juste ciel
- Les Absences du capitaine Cook
- L'Explosion de la tortue
- Ronce-Rose
- Monotobio
- La Chambre à brouillard
