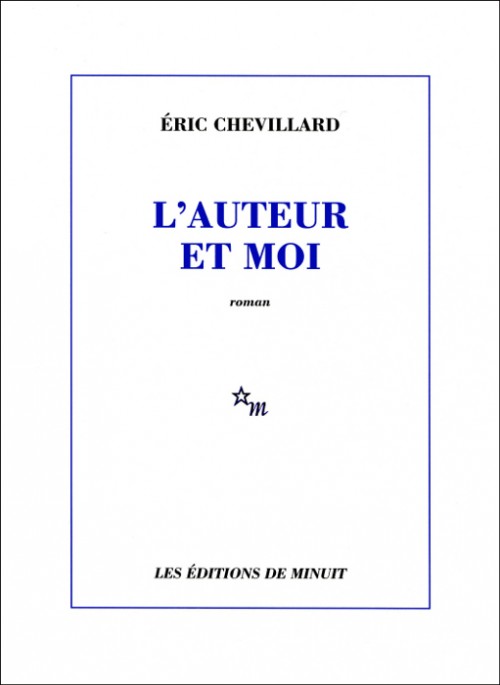
Éric Chevillard
L'Auteur et moi
2012
304 p.
ISBN : 9782707322524
19.50 €
47 exemplaires numérotés sur Vergé des papeteries de Vizille, 74 €
Pour quelques damnés heureux ou malheureux, la littérature décide de tout. Chaque chose sera vue à travers son prisme et rien ne sera vraiment vécu avant d'être formulé. Ce livre est-il un récit humoristique délirant, une confession autobiographique désarmante, un essai polémique agressif, ou bien plutôt, outrepassant ces catégories qui se télescopent ici, tantôt joyeusement, tantôt brutalement, une mise à l'épreuve de la vie de l"auteur dans le champ de la littérature où il s’est établi au saut du berceau ? Nous y lirons donc un roman bien dans sa manière (un peu trop sans doute), et même deux romans puisqu’un second (l’histoire d’un homme qui suit une fourmi) vient soudain interrompre le premier. Mais nous y lirons aussi les interventions et commentaires de l’auteur, soucieux de garder la main sur sa création et d’élucider ce qui se trame peut-être à son insu dans ses fictions.
ISBN
PDF : 9782707324498
ePub : 9782707324481
Prix : 13.99 €
En savoir plus
Philippe Lançon, Libération, jeudi 6 septembre 2012
Eric Chevillard, auteur de vue
Confessions de bas de pages sous le gratin de chou-fleur
C'est l"histoire d’un type qui commande une truite aux amandes et à qui on sert un gratin de chou-fleur. La truite aux amandes est son plat préféré, il déteste le gratin de chou-fleur. Il en parle à une jeune femme, qu’il appelle Mademoiselle. Il proteste, divague, crie, enfle, digresse, suit le lapin d’Alice et la fourmi solitaire. Il a toute la colère de l’imagination. A quoi correspond-elle ? Au «désir le plus constant de l’auteur : être ailleurs, loin d’ici.» Même quand on parle de soi, c’est pour s’en aller qu’on écrit.
Moi, c’est le type, qui s’appelle Blaise. L’Auteur, c’est Eric Chevillard. Lui non plus n’aime pas le gratin de chou-fleur, il nous le confesse, mais sa détestation est, si l’on ose dire, moindre. (Moindre est le nom du personnage d’un livre précédent, que l’on retrouve ici au détour d’une page, comme une fleur des pages ou des champs.) «La qualité première d’un prétexte est d’être indifférent», lit-on dans l’avertissement. La lutte entre la truite aux amandes et le gratin de chou-fleur en est un, même s’il n’est pas tout à fait indifférent. Sous cette lutte, s’en déroulent d’autres, mises en scène et plus sensibles : entre l’auteur et le personnage, entre l’auteur et le lecteur, entre le personnage et le lecteur, entre l’auteur et son époque, entre l’imagination et la réalité, entre la mort et la vie.
Chagrin joyeux. L’Auteur et moi réfracte ces luttes à l’infini. Chemin faisant, il est question d’otarie, d’asperges, de gelée d’oie, de sieste champêtre, de vitesse de lecture, de Bouddha, de l’amour, de foules ressentimentales allant au musée, et même d’amour : «Puis le ciel se troubla et je rencontrai l’amour. Il s’annonça avec un bruit de claquettes, talons pointus frappant les dalles de façon si précipitée que je songeai d’abord qu’il ne fallait pas moins de six pattes pour produire ce crépitement.» A mi-chemin, un autre roman s’invite dans le roman, l’histoire d’un assassin en fuite qui devient le compagnon d’une fourmi. Puis ce roman s’éteint comme il est venu, par les phrases. Le tout est ludique et épique, anecdotique et intime, c’est un chagrin joyeux. Si on secoue le prétexte, il en sort des larmes d’encre. Un principe de politesse guide leurs coulées. Il est défini par une fausse question de l’auteur : «Le savoir-vivre est-il autre chose qu’un savoir éviter ?» Même quand on parle de soi, c’est pour s’éviter qu’on écrit.
Quarante notes de bas de pages, parfois plus longues que la page elle-même, permettent à l’auteur de recadrer son personnage, de s’en détacher tout en parlant de lui-même. Elles tressent une confession profonde, légère, traversière : l’auteur émoi. On apprend, comme en passant, bien des choses sur la vie ou les opinions d’Eric Chevillard ; sur son père et sa mort ; sur un oncle prêtre, assassiné en 1994 par les islamistes ; sur le fait qu’il n’a ni permis de conduire ni téléphone portable ; sur les veines qu’il s’ouvrit au service militaire, suite à quoi il fut réformé ; sur son rapport aux autres, au monde ; sur l’échec de la littérature : «La littérature ne mord plus, elle n’agrippe plus, n’accroche plus - encore un peu s’agrippe, s’accroche, comme une naufragée au bastingage ; mais elle pèse trop, on ne veut plus d’elle à bord, des pieds lui écrasent les doigts. Elle ne s’enfonce plus comme un coin dans le réel ; elle supplie plutôt pour y garder sa place, elle se fait toute petite.»
Petit chasseur. On lit enfin ces phrases si justes, si tristes, sur l’amitié : l’auteur «veut des âmes tout acquises, des alliés subjectifs ; il veut être accompagné sur la mauvaise pente s’il s’y engage joyeusement, et la dévaler en riant, sa main dans la main de l’ami. Mais toi qui viens vers lui avec un miroir grossissant et un seau d’eau froide, ne t’attends pas à sa reconnaissance ; apporte-lui plutôt des fleurs, des gâteaux, ne ménage pas tes encouragements. Car voilà comme il conçoit l’amitié ; et pour les heurts, il compte sur le trot de son âne bourru et le sol inégal qui ne lui ont jamais manqué.» L’auteur est une âme sensible et un pessimiste au grand cœur. Il est assez misanthrope pour se passer d’Alceste.
On pense souvent à Nabokov en lisant l’Auteur et moi. Dans son autobiographie, Autres rivages, il écrivait : «L’imagination, souverain délice de l’être immortel et aussi de l’immature, doit être limitée. Afin d’aimer la vie, il nous faut ne pas trop l’aimer. Je me révolte contre cet état de choses. J’éprouve le désir d’extérioriser ma révolte et de circonscrire ma nature.» Chevillard continue le combat, vaillant petit chasseur, écrivant comme on va aux papillons. Leur vol et leurs couleurs sont des armes de guerre, des prétextes à beauté, et une condition de survie.
Patrick Kéchichian, La Croix, jeudi 6 septembre 2012
La Méthode Chevillard
Le dernier roman d'Éric Chevillard constitue une sorte de défi lancé à la critique littéraire. Défi que l'on rêverait de demander à l’écrivain en personne de relever, lui qui tient désormais une chronique littéraire hebdomadaire dans le journal Le Monde. La méthode ordinaire et implicitement admise, qui consiste à raconter le livre de A jusqu’à Z, de la présentation des personnages à leur triomphe glorieux ou à leur piteux déclin, il ne faut pas songer une seconde à y recourir ici… Au bout de quelques lignes, tous les lecteurs potentiels, même de bonne volonté, fuiraient, irrités, cet objet non identifiable. En cette rentrée littéraire, il faut donc, pour les inciter à faire ce surprenant détour par la case Chevillard, trouver de meilleurs arguments.
On connaît depuis longtemps, chez l’auteur de Mourir m’enrhume, premier coup de cymbales de l’œuvre en 1987, cette capacité singulière de retourner le roman comme un gant et contre lui-même, de montrer les coutures du vêtement au lieu de s’en revêtir pour faire le beau. Notre auteur – ce possessif n’étant qu’une tentative maladroite de l’apprivoiser – a ce don de renverser les tendances, de brouiller les pistes au lieu de les tracer, de perturber le cours du temps, de subvertir dangereusement toute identité. Ce don, il ne le cultive pas avec délicatesse et parcimonie, il en fait son luxe, sa méthode globale, sa philosophie. Parfois même, comme il le reconnaît lui-même, il en fait « un peu trop ».
Que le lecteur se le tienne pour dit : ce n’est pas dans le secret de son atelier que l’écrivain va composer son œuvre et la lui donner à lire, après s’être effacé derrière. Sur la scène de L’Auteur et moi, il tient lui-même son rôle, qui – le titre le manifeste – n’est pas du tout secondaire. Certes, comme dans tout roman qui se respecte, il y a des personnages… Ici, il n’y en a qu’un, et quelques figurants : n’oublions pas que nous sommes en temps de pénurie et de minimalisme. Pour peupler sa solitude, ce héros au sourire crispé se fait disert, et même intarissable. Pourtant, sa vie de papier se résume à une idée fixe, mais sur laquelle il glose sans fin ; parfois il pique même des colères homériques, invective la terre entière. Cela tourne autour de son amour de la truite aux amandes et de sa détestation du gratin de chou-fleur. Pas de quoi fouetter un chat, n’est-ce pas ? « Râleur monomaniaque obsédé par sa folie » , il pérore donc incessamment, tourne en rond face à une jeune fille muette à la terrasse d’un café. Mais très vite, ce bavard impénitent va se voir voler la vedette par son créateur même…
En notes de bas de page de plus en plus envahissantes, l’auteur impose sa présence. Après tout, il sait de quoi et de qui il parle. Et puis si l’on accorde une âme à un personnage, on ne peut décemment contester ce même privilège à l’auteur ! Ainsi, sans ménagement, il va se montrer de plus en plus sévère avec sa créature et en même temps développer une sorte de théorie du roman, donner son avis sur tout et sur rien – la pornographie, Michel Houellebecq, etc. « Pourquoi, en effet, interroge-t-il (note 26, véritable tournant du livre) serait-il interdit d’écrire un roman en bas de page ? Tant qu’il s’agit de papier, l’auteur n’a-t-il pas pour vocation de le noircir ? » Certaines données autobiographiques démontrent que « l’Auteur » qui s’exprime, qui se « miniaturise pour donner la réplique à son personnage » , n’est pas une créature romanesque volatile, mais Chevillard en personne. Le livre réserve d’autres surprises, et quelques fous rires. Une femme, une fourmi, un enfant, un tamanoir vont ainsi intervenir pour stimuler l’action.
L’art et les manières de l’écrivain atteignent ici une sorte d’apogée – ou de point de non-retour. Même lorsque la démonstration se fait trop volontariste, on salue le toupet.
Jean-Louis Ezine, Le Nouvel Observateur, 30 août 2012
En près de vingt romans, ce maître de la dérision a créé un monde unique.
Le nôtre, en fait, qu'on reconnaîtra dans son nouveau récit.
C'est une première mondiale. La condition humaine a certes toujours inspiré les gens de lettres, qui l'ont scrutée à travers les chagrins, les passions, le pouvoir, la guerre, la mort. Il ne s'était cependant pas encore produit qu'un écrivain choisisse de la considérer par le truchement ô combien inessentiel, faiblement spéculatif et peu disposé aux apothéoses littéraires, du gratin de chou-fleur. Le roman français n'est pourtant plus en âge de surprendre la clientèle, il a traité de tout avec conviction et même alacrité. Des pages immortelles se sont écrites sur la chasse aux papillons, la sexualité des loutres, le goût de la madeleine, l'insomnie du garde-barrière. Mais au bureau des sujets de romans, jamais encore on n'avait demandé le gratin de chou-fleur. Sa signature fétide fait juste une ligne dans «les Thibault» de Roger Martin du Gard. Personne n'en a jamais fait un plat. C'est pour moi, a délibéré Eric Chevillard, qui est un incorrigible modeste.
Et là-dessus, il nous sert la grande dispute de la civilisation qui nous a apporté ça. On aurait dû se méfier, aussi. Au commencement des entreprises les plus remarquables, on trouve parfois un motif si ténu qu'il semble d'avance les condamner. Mais une miette dans une tasse de thé peut enfermer les mondes engloutis, le cyclone se prémédite dans l'air immobile que froisse l'aile de la mouche et, pour aller sans barguigner au plan général, l'Univers lui-même, qui est d'origine très modeste, tenait tout entier, nous dit-on, dans un dé à coudre. Le piètre contient et détermine le grandiose, c'est la fatalité mécanique des galaxies en fuite et des vérités en expansion, où les développements ne sont jamais proportionnés aux prémices, loin s'en faut. Et c'est justement tout le propos de Chevillard.
Donc, on a servi au narrateur, au lieu de son plat préféré (la truite aux amandes), un gratin de chou-fleur. Cet immonde attentat l'aurait laissé sans voix s'il n'avait rencontré, à la terrasse d'un café, une oreille charitable à sa plainte. Celle d'une demoiselle, qui n'interviendra jamais dansle récit du fâcheux. Peu importe, la béchamel poisseuse visée par sa logorrhée n'est ici qu'un prétexte à délire, le leitmotiv d'une pure contamination verbale, les mots procédant sur le mode invasif propre aux stases et aux grandes ambitions pathologiques. Il en va ici du langage comme il en va du chou-fleur dans la nature : son tout n'est que la répétition lancinante de sa partie, dans une sorte de bégaiement végétal qui fait tout le pommé de la chose mais aussi le spleen métaphysique à quoi donne naissance l'uniformité. C'est ce qu'on appelle dans les sociétés savantes un objet fractal. Le langage serait-il une maladie mortelle ?
Cette irrésistible sotie ferait songer à une déclinaison burlesque du «Bavard», l'œuvre culte de Louis-René des Forêts qui fut à l'origine de la grande crise fictionnelle qui nous occupe encore, si Eric Chevillard, plutôt que de s'effacer derrière son héros, ne se permettait de le reprendre, le corriger ou le démentir en marge du récit. L'auteur s'immisce dans l'intrigue à coup de notes en bas de page, introduisant un deuxième degré dont Will Cuppy, le légendaire chroniqueur américain, s'était fait une spécialité planétaire. Mais celui-là va devoir céder sa couronne olympique : Chevillard réussit l'exploit de faire tenir un roman entier (l'histoire d'un homme qui poursuit une fourmi) dans une note en bas de page, laquelle, sus à infime insecte, court sur 105 pages ! Un roman dans le roman : un récit gigogne, tout en inflorescences, bref, un chou-fleur.
Voilà à quelles extrémités sportives conduit l'observation d'un légume crucifère dont l'autre grand farceur américain, Ambrose Bierce, disait qu'il est ce qui ressemble le plus au cerveau humain, étant «aussi gros et aussi réfléchi». «Mourir m'enrhume», anticipait Eric Chevillard en une sidérante devise dès son premier texte publié, en 1987. Dix-sept autres romans ont suivi, qui l'ont établi en maître du nonsense sans qu'il s'écarte, et même s'écartât jamais, de la sérieuse question qui les gouverne tous : pourquoi les choses sont-elles ce qu'elles sont plutôt qu'autres ? Et pourquoi s'obstinent-elles à la redite ? Peut-être pour permettre aux écrivains d'écrire. C'est-à-dire, résume l'auteur, de «tout foutre en l'air sans toucher à rien».
Du même auteur
- Mourir m'enrhume, 1987
- Le Démarcheur, 1989
- Palafox, 1990
- Le Caoutchouc, décidément, 1992
- La Nébuleuse du crabe, 1993
- Préhistoire, 1994
- Un fantôme, 1995
- Au plafond, 1997
- L'Oeuvre posthume de Thomas Pilaster, 1999
- Les Absences du capitaine Cook, 2001
- Du hérisson, 2002
- Le Vaillant petit tailleur, 2003
- Oreille rouge, 2005
- Démolir Nisard, 2006
- Sans l'orang-outan, 2007
- Choir, 2010
- Dino Egger, 2011
- L'Auteur et moi, 2012
- Le Désordre azerty, 2014
- Juste ciel, 2015
- Ronce-Rose, 2017
- L'Explosion de la tortue, 2019
- Monotobio, 2020
- La Chambre à brouillard, 2023
Poche « Double »
- Palafox, 2003
- La Nébuleuse du crabe , 2006
- Oreille rouge , 2007
- Le Vaillant petit tailleur , 2011
- Du hérisson, 2012
- Les Absences du capitaine Cook, 2015
- Ronce-Rose, 2019
Livres numériques
- Au plafond
- Choir
- Démolir Nisard
- Dino Egger
- Du hérisson
- L'Auteur et moi
- L'Oeuvre posthume de Thomas Pilaster
- La Nébuleuse du crabe
- Le Caoutchouc, décidément
- Le Démarcheur
- Le Vaillant petit tailleur
- Mourir m'enrhume
- Oreille rouge
- Palafox
- Préhistoire
- Sans l'orang-outan
- Un fantôme
- Le Désordre azerty
- Juste ciel
- Les Absences du capitaine Cook
- L'Explosion de la tortue
- Ronce-Rose
- Monotobio
- La Chambre à brouillard
