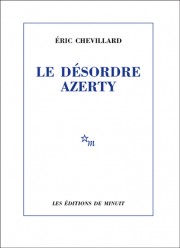
Éric Chevillard
Le Désordre azerty
2014
224 p.
ISBN : 9782707323361
17.00 €
49 exemplaires numérotés sur Vergé des papeteries de Vizille
Nous attendons d’un livre qu’il nous parle de neige, de marquise, d’île, de zoo, de style, de photographie, de Beckett, d’humour, de Dieu, de virgule, de littérature et évidemment de kangourou. Ce sera le cas de celui-ci, entre autres questions de semblable importance. Soucieux de mettre un peu d’ordre dans son recueil, l’auteur a cédé à la tentation de l’abécédaire, optant même pour la disposition AZERTY du clavier français, conçue justement à l’origine pour éviter que les machines à écrire et ceux qui en usent ne s’emmêlent les pinceaux. C’était oublier que l’écriture selon son goût pactisera toujours plus volontiers avec les forces du désordre.
ISBN
PDF : 9782707323477
ePub : 9782707323460
Prix : 11.99 €
En savoir plus
Nathalie Crom, Télérama, 1er janvier 2014
« D'une certaine manière, tous les livres de Chevillard racontent la même histoire, celle de personnages hors normes en butte au monde extérieur et à son refus d'accepter ce qui ne s'intègre pas dans les cadres préétablis », note Pierre Bayard dans l'une des quatre études qui composent le recueil critique – et plutôt drolatique – Pour Eric Chevillard. L'analyse vaut pour Le Désordre Azerty, qui n'est pas un roman et dont le personnage central est Eric Chevillard lui-même. Ce n'est pas manifester beaucoup d'audace ni de pertinence que de qualifier ce livre d'autoportrait, mais, tant pis, faisons-le, puisque c'est encore la définition la plus simple qu'on puisse trouver pour définir cet exercice autobiographique délectable dans lequel, pour mettre un peu d'ordre, canaliser une tendance à la spéculation et à la digression qui l'entraîne souvent bien loin de ce qui semblait être son sujet initial, l'écrivain a choisi de s'en remettre à la forme de l'abécédaire, disposé tel que se présente le clavier français : azertyuio...
La phrase qui précède est un peu longue, mais c'est fait exprès : l'usage de phrases longues, ainsi que de mots rares, inusités ou inconnus de la majorité, donc « susceptibles de saper la cohésion du groupe, d'y introduire le trouble, le malaise, la division », est posé d'emblée par Eric Chevillard comme tout ensemble le symptôme et le moyen d'une certaine asociabilité, acceptée comme un fait autant que revendiquée. Car c'est un des marqueurs de son style propre. Et c'est bien de cela qu'il s'agit : à chaque entrée de l'abécédaire, d'une façon ou d'une autre, tenter d'approcher ce qu'est le style d'un écrivain, qui « se dégage peu à peu de la gangue de la langue commune ». Le style qui est « la langue natale de l'écrivain : le pays suit, l'espace intellectuel et sensible qu'il ordonne » ; un « étrange pays que nous [les lecteurs, NDLR] visitons, où ne vit qu'un habitant – le premier ou le dernier homme ? L'un et l'autre sans doute ».
L'autobiographie telle qu'on l'entend communément – des faits, des paysages... – n'est pas absente de ces pages : elle s'immisce, fragmentée ou livrée en bloc et en vrac dans la frissonnante énumération du chapitre « Quinquagénaire », sorte de Je me souviens. L'ironie, en ces pages, le dispute constamment au sérieux – encore un indice de style – et même à une sorte de mélancolie, qu'on n'avait sans doute jamais sentie si palpable chez Eric Chevillard. C'est que ce plaidoyer pour la singularité de l'artiste ne va pas sans l'aveu répété d'une solitude : « L'écrivain est un théoricien sans école, sans disciple, sans parti. Il s'invente un monde dans lequel il est le seul à vivre. » Et vous, pourquoi n'écrivez-vous pas ? demande-t-il au lecteur – « Comment peut-on ne pas écrire ? Cette aptitude, pourquoi ne l'ai-je pas reçue ? »
Maurice Mourier, La Quinzaine littéraire, 1er janvier 2014
Chevillard nous rend bêtes
Quatre écrivains se sont associés pour une forme d’hommage à Eric Chevillard, intéressante en ce qu’elle tente de fournir des clés de lecture pour une œuvre considérable et trop peu lue. Difficile ? En tout cas pas au sens habituel du terme, l’écriture apparemment fantaisiste et très volontairement digressive de l’auteur offrant nombre de voies d’accès attrayantes, par exemple une invention constante de personnages et de situations aptes, par leur caractère saugrenu, à provoquer le rire.
On s’amuse beaucoup à lire Chevillard, enfin une partie des lecteurs, semble-t-il, devrait ou pourrait s’amuser si ne s’insinuait pas très vite en eux le sentiment que l’époustouflante mécanique verbale de ses livres d’une virtuosité rhétorique sans égale dans le domaine français – depuis, je ne sais pas, aucune comparaison ne s’impose, Rabelais peut-être –, que ce système fou (non pas le moins du monde dément, on n’a pas affaire à du Brisset, mais fou à la manière d’une bobine folle dont le fil cassé se dévide) cache à l’évidence quelque chose d’important, de vital même, que l’on ne comprend pas sans effort.
Le lecteur normal n’aime pas l’effort. Alors, du temps de Rabelais, oui, quand une élite extraordinairement restreinte savait que, derrière la fable hilarante et visible offerte par le Silène du texte, se dissimulait la substantifique moelle du sens religieux, politique, philosophique porté par un Socrate moderne, oui, peut-être… Mais aujourd’hui où l’écrivain s’adresse malgré tout à un public nombreux, ou essaie de s’adresser à lui ?
On ne peut pas dire que nos quatre exégètes, eux, aient ménagé leurs efforts et, puisqu’ils sont par bonheur de tempéraments très divers, l’ensemble de leurs contributions contitue une excellente incitation à en venir, ou à en revenir, au texte. J’ai parlé de « mécanique » ; l’approche de Bruno Blanckeman en fournit un très beau décryptage, académiquement impeccable, une de ces prestations de colloque qui, du premier roman (Mourir m’enrhume, 1987) à l’avant-dernier (L’Auteur et moi, 2012, QL n° 1067), parcourt à fond de train mais avec une rigueur magistrale la logique propre au « métier à tisser le texte » et souligne à juste titre la perfection de son fonctionnement.
De son côté, Pierre Bayard, dont on connaît les détournements malicieux et profonds de livres célèbres, traite avec sa subtilité habituelle du singulier usage que Chevillard fait de la « comparaison éloignante », autre régime de la métaphore où la distance maximale entre deux termes comparés aboutit à une étincelle de rupture différente de celle du surréalisme : il ne s’agit pas ici de créer une combinaison chimique harmonieuse d’éléments contradictoires, mais, en maintenant jusqu’au bout l’écart entre substances littéraires hétérogènes, de préserver la singularité absolue des êtres écrits et des choses montrées.
Voilà, dans les deux cas précédents, du vrai travail de scholiastes, utile et éclairant. On peut néanmoins lui préférer des tâtonnements plus imprécis ou plus émotionnels, mais qui permettent mieux de distinguer en Chevillard ce que la maîtrise textuelle recèle de sensibilité enfouie. Car Chevillard ne serait qu’un surdoué s’il n’écrivait aussi – ou plutôt d’abord – avec son sang, comme l’a bien prouvé Choir en 2010, son roman le moins drôle et le plus accompli (QL n° 1008).
Les auteurs qui comptent pour « phares » à ses yeux, Lautréamont, maître de Michaux, Beckett et Michaux lui-même, sont certes des humoristes mais, on en conviendra, très particuliers. C’est donc avec raison que Dominique Viart, dans sa remarquable analyse, isole, au sein de « l’écriture expérimentale » de Chevillard (qui doit beaucoup à l’aventure du Nouveau Roman, jadis théorisée par Barthes, mais l’a violemment dépassée en verve iconoclaste et en refus de toute filiation mutilante) une dimension tragique sous-jacente. Cet écrivain-là, d’un magnifique emportement, est tout sauf le boute-en-train de l’intelligentsia parisienne. S’il fouaille en acharné les dessous du lieu commun, de la langue convenue, met les ressorts de la sacro-sainte « communication » à nu, dérègle les horloges et fait circuler ses personnages au plafond tels de certains Plume, c’est parce qu’une rage l’habite contre l’ordre cosmique et la condition humaine, en métaphysicien désespéré qu’il est, sous différents masques.
Masques animaux, très souvent, l’orang-outang, le hérisson, la fourmi obstinée, le tamanoir, tout un bestiaire fantasque hante cette sensibilité immature, à moitié enfoncée encore dans le terreau de l’enfance dont les créateurs qui nous touchent le plus n’ont jamais voulu sortir. « Adulte. Achevé. Mort, nuances d’un même état », l’aphorisme génial de Michaux va comme un gant à cette œuvre, et c’est ce que Tiphaine Samoyault, dans le meilleur essai du livre, parce que sa propre écriture possède des antennes ultrasensibles et se méfie des certitudes trop carrées que produit la raison, parvient à nous faire découvrir. Le titre même de son travail, « Rendre bête », est une trouvaille épatante. Chevillard nous rend bêtes, en effet, nous rend à cette situation merveilleuse où l’enfant baigne naturellement et d’où il comprend vraiment le monde, en sachant se mettre au niveau de la bête qu’il est tout comme l’adulte (mais lui ne l’a pas déjà oublié), se faire aussi petit que ces fourmis observées avec une passion myope, dans l’étale d’un après-midi éternel, par « Dovobo, l’Empereur de Grande Garabagne » imaginé par Michaux.
Enfance intacte et qui bannit toute niaiserie. On craint d’abord, en commençant Le Désordre Azerty, dernier livre de Chevillard, qui n’est pas un roman mais une série d’articles savamment désordonnée en forme de clavier français, que ce nouveau procédé d’écriture ne soit qu’une commodité : il peut sembler plus facile d’agencer vingt-six petites histoires à dormir debout que de « construire mécaniquement la cervelle d’un conte somnifère » comme Le Vaillant petit tailleur (2003) ou Dino Egger (2011). Evidemment, il n’en est rien et le livre est aussi chevillé que les précédents, qui inscrit presque en son centre un éloge de l’enfance d’une fervente densité.
Pas de n’importe quelle enfance, notez bien. Frère en cela de Lewis Carroll, l’auteur consacre à Agathe et Suzie, ses deux propres enfants, une entrée « Fille » qui tourne à l’hymne au hors temps absolu, antérieur au funeste clivage de l’androgyne primitif, antérieur à la sexualité, miraculeusement pur de toute velléité de croissance, de vieillissement, de chute, de toute dégradation en l’état d’adulte : « Une petite fille ! Voilà vers quel état, quelle réalisation de soi il faudrait tendre, tous autant que nous sommes : devenir des petites filles. »
Rarement Chevillard a été aussi explicite, rarement il a balayé aussi loin de lui l’armure de ce qu’on prend parfois (bêtement, sans nuance laudative cette fois) pour du cynisme. Rarement, je dois le dire, son écriture s’est faite si cristalline et m’a paru si proche. L’ensemble du livre est d’ailleurs moins amer qu’enjoué, parfois délicieux. Il a pour objet principal, après la proclamation ci-dessus et ce n’est pas un hasard, la littérature, le rejet du réalisme plat, de l’anecdote remâchonnée, du gnangnan intime déguisé en authenticité romanesque. Partout y est saluée la vertu de l’imaginaire et raillée avec allégresse la machine à fabriquer du pathos, du saignant, du vécu, du « comme si vous y étiez ». Même dans ses moments de retour critique sur soi, d’examen plus ou moins théorique d’une pratique d’écriture qui lui est toute personnelle, Chevillard ne cesse jamais d’écrire, c’est-à-dire de jouer des ressources complètes d’une poétique reconnaissable au premier mouvement de sa phrase. Il est poète et écrivain, et non des moindres. Plutôt du dessus du panier, tout le monde va le savoir, à force.
Du même auteur
- Mourir m'enrhume, 1987
- Le Démarcheur, 1989
- Palafox, 1990
- Le Caoutchouc, décidément, 1992
- La Nébuleuse du crabe, 1993
- Préhistoire, 1994
- Un fantôme, 1995
- Au plafond, 1997
- L'Oeuvre posthume de Thomas Pilaster, 1999
- Les Absences du capitaine Cook, 2001
- Du hérisson, 2002
- Le Vaillant petit tailleur, 2003
- Oreille rouge, 2005
- Démolir Nisard, 2006
- Sans l'orang-outan, 2007
- Choir, 2010
- Dino Egger, 2011
- L'Auteur et moi, 2012
- Le Désordre azerty, 2014
- Juste ciel, 2015
- Ronce-Rose, 2017
- L'Explosion de la tortue, 2019
- Monotobio, 2020
- La Chambre à brouillard, 2023
Poche « Double »
- Palafox, 2003
- La Nébuleuse du crabe , 2006
- Oreille rouge , 2007
- Le Vaillant petit tailleur , 2011
- Du hérisson, 2012
- Les Absences du capitaine Cook, 2015
- Ronce-Rose, 2019
Livres numériques
- Au plafond
- Choir
- Démolir Nisard
- Dino Egger
- Du hérisson
- L'Auteur et moi
- L'Oeuvre posthume de Thomas Pilaster
- La Nébuleuse du crabe
- Le Caoutchouc, décidément
- Le Démarcheur
- Le Vaillant petit tailleur
- Mourir m'enrhume
- Oreille rouge
- Palafox
- Préhistoire
- Sans l'orang-outan
- Un fantôme
- Le Désordre azerty
- Juste ciel
- Les Absences du capitaine Cook
- L'Explosion de la tortue
- Ronce-Rose
- Monotobio
- La Chambre à brouillard
