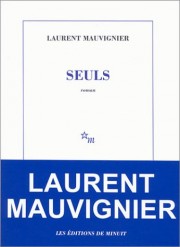
Laurent Mauvignier
Seuls
2004
176 pages
ISBN : 9782707318466
17.00 €
45 exemplaires numérotés sur Vergé des papeteries de Vizille
Pauline est revenue. En attendant de trouver un appartement, elle s'est installée chez Tony, comme quand ils étaient étudiants.
Tony raconte à son père que rien n'a changé : il fait toujours semblant de n'être pas amoureux d'elle, et elle ne s'aperçoit de rien.
Mais quand Tony part sans prévenir personne, c'est à Pauline que son père va demander de l'aide. Et cette fois, il faudra bien que tout soit dit.
Rencontre entre Laurent Mauvignier et Jean Laurenti
(Le Matricule des anges, n°51, mars 2004)
Misère de l'amour
Avec Seuls, Laurent Mauvignier prolonge le sillon qu'il creuse depuis quelques années : offrir une voix à ceux que le monde ignore, donner vie et épaisseur aux ombres. Dans ce nouveau livre, le désespoir doit composer avec la révolte. Éclairages.
Dans les livres de Laurent Mauvignier on ne voit pas beaucoup le ciel. Ou alors par accident, parce que la pluie vient bien de quelque part, ou qu'on guette l'avion qui ramène quelqu'un qu'on n'attendait plus et qui, de toute façon, repartira. La désespérance hante ces vies suspendues entre la grisaille des jours et les rêves anciens dont on se souvient parfois.
Seuls est le quatrième livre de cet écrivain né en 1967, fervent lecteur de Thomas Bernhard et de William Faulkner. Il fait suite à Loin d'eux, Apprendre à finir et Ceux d'à côté, tous publiés aux Éditions de Minuit. Pour les personnages de Laurent Mauvignier, être au monde n'a rien d'évident. Être n'est pas ici un verbe d'état, mais d'action, voire de combat : celui qu'on mène quand on s'efforce d'exister, dans un monde où on est quantité négligeable. C'est cette quête qui produit la substance du récit. Du côté de l'auteur, elle nécessite la création d'une « langue », qui sera le refuge de ces exilés, le lieu d'où pourra se dire leur plainte et s'accomplir leur geste. La phrase y est soumise à un travail incessant, tour à tour étirée à l'extrême, concentrée, privée de lin. Dans Seuls, elle est portée par un chœur qui conte une histoire tragique, celle d'un amour devenu fou à force de ne pouvoir se dire.
Le titre de votre nouveau livre, Seuls, aurait pu être celui d'un des précédents...
Oui, bien sûr. Ça pose la question de la redite. De la même façon que je n'ai pas peur du ressassement dans un livre, je n'en ai pas peur non plus entre plusieurs livres. Je pense à la formule de Faulkner : on a chacun l'espace d'un timbre et on doit sans cesse le creuser. Bien sûr, les choses se retrouvent, se croisent. Je pense à la sculpture, par exemple. Le fait de tourner autour d'un objet que je ne sais pas définir vraiment... en espérant être dans une spirale concentrique, de plus en plus proche de cet objet. Dans Seuls, par rapport au premier livre, on touche à une matière plus intime. Je vais vers des territoires qui étaient à peine esquissés dans Loin d'eux. Entre ces deux livres, j'ai le sentiment que la question du désir s'est encore creusée. Elle est de plus en plus à nu. De ce fait, il n'y a pas vraiment de ressassement. Plutôt quelque chose qui emprunte les mêmes chemins, mais qui ne va pas au même endroit.
Le motif de la solitude est-il davantage central dans ce livre-là ?
Il a été très difficile, très long de trouver un titre. La solitude est un motif, mais parmi d'autres, cachés dans le tapis. Comme dans mes livres précédents, il y a cette question : comment sortir de soi, de son corps ? Comment faire violence à soi ou aux autres pour sortir de son corps ?
Vos personnages sont en effet comme enfermés, ils se cognent aux murs...
Oui et ce thème me ramène à un autre, celui du social... Ce n'est pas le social en soi qui m'intéresse, mais en tant que contrainte du réel. Si on prend un tableau de Francis Bacon, on voit une matière organique, qui est un corps humain, contraint, frappé par un espace qui est formé par des aplats, des lignes droites... Pour moi, le social a un peu cette forme-là. II suscite une volonté d'exister, de pousser les murs.
Justement, la question sociale est plus présente dans ce livre que dans les précédents. On sent comme un marquage social dans le comportement de Tony face au monde petit-bourgeois de Pauline, qui lui est étranger.
Je ne peux pas faire autrement que de me préoccuper de ça, je suis vraiment là-dedans. Ce livre-là est peut-être plus abouti que les autres, parce qu'il assume mieux cette dimension sociale. Ça pose la question de la place qu'on occupe, et pour moi cette place passe par la langue...
Est-ce lié à un questionnement que vous avez dans votre vie personnelle ?
Oui, évidemment. Même si je ne suis pas dans l'autobiographie, ni l'autofiction. Des textes comme Entretien dans la montagne, de Celan, ce sont des choses qui me touchent beaucoup. Cette idée de l'homme en marche, à la recherche de son propre lieu. Tout ça peut ramener à une seule notion : celle de la place de chacun dans le monde. Je viens d'un milieu ouvrier, j'ai grandi dans une petite ville, une zone pavillonnaire. J'ai fait un BEP comptable que je n'ai pas eu, puis je suis entré aux Beaux Arts... Comme beaucoup de gens, j'ai été élevé par des parents qui m'ont dit : “ Pour nous aimer, ne sois pas nous... ” Nos parents nous ont appris que pour les aimer, il fallait les trahir. D'où l'idée d'exil... On n'est jamais nulle part à sa place, socialement parlant. Et alors, naît le besoin de refonder une famille, une communauté par la langue, par l'écriture..
Est-ce qu'on peut dire que la matière première de votre travail sur les personnages, le point de départ de vos histoires, c'est la souffrance ?
Pas vraiment, ça part plutôt de la voix du personnage, du lieu de sa plainte. Je perçois un murmure, une revendication. La souffrance, c'est une notion compliquée. On peut aussi la désirer. Non, je ne peux pas me limiter à cette idée de souffrance, parce que je ne sais pas quels sont les mobiles... Je me souviens qu'au cours d'une lecture de Apprendre à finir, certaines personnes trouvaient que la narratrice avait un comportement masochiste, d'autres, un comportement sadique. Moi, les deux me paraissaient recevables.
L'important est que ça aboutit à une libération du personnage dans ce livre-là...
Oui, et en ce sens c'est un livre très positif, la fin d'une aliénation. Seuls, en revanche, assume l'aliénation jusqu'au bout. Sa tonalité est beaucoup plus sombre.
Dans Seuls, la souffrance est surtout dans l'impossibilité de la dire...
C'est la question du refus, du non-dit... Je pense beaucoup à Melville, avec son Bartleby : son entêtement, c'est celui de Tony avec lui-même, avec les autres… un acharnement qui n'est pas très éloigné de celui d'Achab envers Moby Dick. Moby Dick n'est pas une baleine, comme Pauline n'est pas une femme non plus, c'est une image.. Est-ce que mes personnages aiment leur souffrance, est-ce qu'ils en jouissent (comme chez Bataille), est-ce qu'elle est leur repère ? On ne peut pas donner une réponse globale. C'est vrai que la souffrance peut donner la sensation d'exister – je souffre, donc je suis –, ça c'est quelque chose que tout le monde connaît. Je me pose des questions auxquelles j'essaie de répondre en écrivant. Écrire a aussi un côté aliénant : on essaie de répondre à des interrogations en faisant des livres, mais on n'y parvient pas. Alors d'autres questions viennent et il faut encore continuer.. Chaque livre soulève de nouvelles questions. C'est un mouvement exponentiel.
Dans Seuls, Tony met en scène sa souffrance avec une sorte d'auto-ironie grinçante...
C'est peut-être une des questions du texte : comment aujourd'hui on peut écrire une histoire d'amour, comment on peut vivre une histoire d'amour sans être dans l'ironie. Comment on remplit notre sensation de néant, comment on affronte tout ça. Tu te dis qu'en 2004, une histoire d'amoureux éconduit, c'est complètement intenable… Et de toute façon, écrire un roman en 2004, c'est complètement intenable... On est tellement écrasé par ce qu'on ne sera jamais. C'est comme si on était condamnés à être des spectateurs, à ne plus être acteurs. Et d'une certaine manière, on n'a plus qu'à réinvestir cette impossibilité par la langue, par la parole, par la voix... C'est une manière de reconquérir le droit d'agir. Je ne suis pas dans la course à l'originalité dans mes histoires. Au moins, avec de tels sujets, tu es tenu à une certaine rigueur dans le travail.
Le personnage de Tony choisit le simulacre pour affronter le réel.
Oui, et d'ailleurs, quand il cesse de faire semblant, il disparaît. Le plus souvent la parole a à voir avec le mensonge, ou le non-dit. Pas avec la réalité.
Vous réécrivez beaucoup vos textes ?
Le dernier, qui est un peu plus long que les précédents a fait l'objet d'un travail intense de réécriture. Le texte s'est écrit plus simplement que les autres, mais le travail a été plus long. II y avait beaucoup de détails, de répétitions dans la phrase, sur lesquels il fallait revenir. Du point de vue du scénario, j'ai pris conscience d'une chose étrange : au fur et à mesure que le texte avançait, tout y disparaissait. Et plus j'enlevais des éléments, plus le texte grossissait. L'idéal serait qu'il ne reste plus rien à la fin, que le texte se vide absolument de tout. Arriver à une sorte de travelling sur un lieu déserté..
Dans votre mode narratif, l'écriture pourrait consister à donner la parole à celui qui ne l'a pas...
Oui, et là, je repense à la dernière phrase de Loin d'eux : “ ton rêve de nous voir tous un jour avec les mêmes mots, oh oui tu dirais, qu'on ait tous les mêmes mots, et qu'un jour entre nous, comme un seul regard ils circulent. ” On est dans l'utopie, le fantasme comme ce que dit Kafka dans son journal, ce rêve de trouver une langue vraie, d'homme à homme… Trouver un langage qui ne soit pas celui de la communication, puisque ce langage-là annihile la communication. Ce n'est pas un langage vrai.
Le moment crucial dans Seuls, la visite de Tony à son père, donne l'impression d'avoir eu lieu hors-champ. Ce qui s'y est dit échappe en partie au lecteur. Un peu comme dans la tragédie, où les scènes capitales se déroulent à l'extérieur de la scène.
Je crois qu'un jour il y aura livre rien que sur cette rencontre. Pour moi, ça a une importance que le livre n'arrivait pas à porter. C'est la forme du tragique qui veut ça, aussi. Si on veut sentir un déplacement presque physique vers le dénouement on est obligé de tout faire converger dans ce sens-là. Tous le reste est important, cependant, tous ces événements qui permettent de structurer l'ensemble, qui ouvrent des pistes, d’autres possibles…On retrouve l'image de la spirale, avec dans chaque détails des amorces d'autre chose. Pour moi, la rencontre du père et du fils a quelque chose de la scène primitive, aussi.
Cette scène hors-champ, c'est ce qui fait progresser la narration.
C’est un hors-chalmp, et en même temps une voix off. Elle contient ce que j’ai dû supprimer. C’est comme ça qu'on diminue le nombre de pages, qu’on resserre vers l’essentiel, qu'on retire les choses qui ne sont pas totalement indispensables… Et tout ça crée des connexions inattendues. Par exemple, la focalisation sur la petite fille de l'affichette, cette gamine disparue qu'on recherche, accompagne la montée de la tension à la fin du livre. Tous ces signes d'étrangeté ponctuent l’action, ajoutent au sentiment d'inquiétude.
Cette montée de la tension dans la narration, c'est la première fois qu'on la ressent autant dans un de vos livres...
Oui, c'est vrai que je vais de plus en plus vers le roman, comme ça. J'ai envie maintenant d'une histoire, avec de multiples personnages. J’ai l'impression que Seuls conclut un cycle, et en même temps il ouvre vers autre chose.
Comment est venue cette double narration : le père de Tony, d'abord, puis l'amant de Pauline, avec un passage de relais insensible d'une instance à l'autre ?
Quand j'ai commencé à écrire, ce n'était pas le père qui racontait. Mais au fur et à mesure du travail, je voyais que quelqu'un parlait de Tony, qu'il essayait de se cacher, d'être neutre, sans y arriver. J'ai réalise que ça ne pouvait être que le père qui parlait, qu'il avait des choses à dire et qu'il voulait forcer le texte pour cela. Il voulait raconter une histoire et il se cognait à une autre, qui n'était pas la sienne, mais celle de son fils avec Pauline. En même temps, il va vouloir faire entrer son histoire à lui : sa femme, morte, ses soirées tout seul où il attend que son fils l’appelle... Toutes ces choses-là, il va les dire petit à petit, jusqu'à ce qu'il bascule dans le récit, devienne un personnage, et donc ne puisse plus être un narrateur. Ça a pas mal compliqué les choses, parce qu’il a fallu revoir la mécanique du récit pour que l'ensemble reste compréhensible. Ça m'a obligé à relire le texte un grand nombre de fois. Jusqu’aux dernières épreuves j'ai changé des choses qui n’allaient pas. Je ne relirai jamais plus ce livre (rires) parce que j’ai encore l'impression que des détails ne vont pas
Ce narrateur, qu'est le père, on le perçoit aussi comme faisant partie d'un chœur tragique qui raconte.
Oui, et c’est peut-être plus vrai encore de l'autre narrateur : Guillaume (l’amant de Pauline, ndlr) est davantage une fonction narrative, même si bien en tant que personnage il a un rôle très important. Mais de lui, au fond, on ne sait presque rien. D'autant qu'en réalité, c’est lui-même qui est exclu…
Pauline est un personnage très ambigu...
Elle n’est pas du tout le personnage qu’on a cru découvrir. On réalise qu’elle était au courant de l’amour de Tony, qu'elle était censée ignorer. Et puis il y a peut-être chez elle un peu de perversité... Elle va au devant de ce qui lui arrive. On peut dire que Seuls est d'une certaine façon un roman d’amour. C’est un livre qui pouvait prendre des directions différentes. Comme il joue sur les faux-semblants, j'envisageais plein d’issues en allant vers le dénuement ... je veux dire le dénouement… mais au fond, il s'agit un peu de la même chose, non ? Faire disparaître les personnages, les déshabiller. Comme lorsque Tony se rase le crâne au lieu d'aller au rendez-vous avec Pauline.
On pense au film Taxi Driver de Scorcese avec cette scène, et avec d'autres aussi...
Ah, mais moi aussi ! Je n'ai pensé qu'à ce film-là en écrivant ce texte. Il est un des déclencheurs du livre. Il est très gentil, au début, le personnage de Scorsese. Après ça change !
Dans Seuls, quelque chose est plus perceptible que dans vos livres précédents : le travail poétique, la musicalité de la phrase. Des répétitions en forme d'anaphores...
L'écriture poétique est toujours le souci premier quand je fais un livre. J'ai travaillé ce livre-là différemment des autres : il y a une tension plus forte entre l'oralité et l'écrit que dans les précédents. Apprendre à finir ou Loin d'eux, par exemple, étaient beaucoup plus dans l'oralité. On était plus dans des questions de rythme que de musicalité. Dans Seuls, il y a une mélancolie, une langueur. Dans les livres précédents, j'étais comme en apnée : il m'arrivait d'écrire trente pages en seulement quelques heures, mais ça m'avait pris des mois pour parvenir à cet état. Du coup, certains passages conservent des accidents liés à ces conditions d'écriture. Je pense au passage, dans Loin d'eux, où le père apprend la mort de son fils.
Cette narration en forme de chœur participe aussi à cette écriture poétique.
Je crois que tout ça est inséparable. La question du style est fondamentale. Imaginez Thomas Bernhard sans le ressassement. C'est là qu'on voit combien Echenoz est un vrai styliste, un grand lecteur de Flaubert. Tout ce travail coûte très cher au quotidien, on ne soupçonne pas combien c'est difficile.
Votre intérêt toujours plus grand pour le social s'accompagne d'un éloignement de toute forme de réalisme...
Oui, au fond quand mon personnage nettoie les trains et qu'il est question de miettes sur les sièges, ce qui m'intéresse c'est avant tout l'effet du mot “ miettes ”. Je suis plutôt un militant de la phrase qu'un écrivain militant. La réalité c'est d'abord celle du livre qui se fait, sa réalité textuelle. Le réalisme, ce serait faire comme si le livre n'existait pas. Ce serait mentir, effacer le livre. Un livre ne peut pas être transparent, il faut qu'il se voie. C'est un objet dans le réel. II ne peut pas se substituer à lui. Le réalisme, on sait que c'est inefficace. Comment peut-on parler du chaos dans une langue qui ne serait jamais concernée par le chaos dont elle se fait l'écho ? Ça me paraît être un mensonge terrible.
Vous portez cependant une attention extrême à des détails concrets, un bruit métallique reconnaissable entre tous, une tache de café, des verres de lunettes sales...
Il y a paraît-il des écrivains du plan large, et d'autre du gros plan. J'appartiens plutôt à la seconde catégorie. Les détails permettent de dire beaucoup de choses… Dans Apprendre à finir, le mot “ hôpital ” ne permettait pas de faire sentir l'hôpital. Tandis qu'avec les bruits de pas dans le couloir, les chambres blanches, le claquement du brancard, on entrait de plain-pied dans cet univers. En même temps, j'aimerais parfois changer de focale. Brasser plus de choses, faire tenir un stade ou un pays dans une seule phrase... Il faut passer par beaucoup de modalités d'écriture pour compenser l'écart entre ce qu'on voudrait dire du monde et notre capacité à le faire.
Propos recueillis par Jean Laurenti dans Le Matricule des anges, n°51, mars 2004
ISBN
PDF : 9782707325051
ePub : 9782707325044
Prix : 11.99 €
En savoir plus
Christian Sauvage, Le Journal du dimanche, 18 janvier 2004
« Ecrire est le seul moment où je suis à ma place. » Allez interviewer un homme qui est tout entier dans ce qu’il écrit ! Il faut avoir beaucoup d’admiration ou un peu d’impudence pour déranger un tel écrivain. L’homme, avant de le rencontrer dans un restaurant bordelais, on le sait déjà timide, pudique, sans doute fragile ; on craint ses silences, on craint le malaise que peut provoquer la moindre question. Mais faut-il rencontrer les écrivains qu’on aime ? Risque de déception, d’incompréhension. Voilà le cinéma que se joue le journaliste dans sa tête avant de rencontrer l’auteur. Un peu comme les personnages de Mauvignier. Qu’on entend plus qu’on ne lit. Car à chaque fois c’est leur voix intérieure qui nous parle : ici (Apprendre à finir, Minuit, 1999), dans la tête d’une femme que son mari a quittée et qu’elle tente de reprendre ; là, dans son dernier roman, Seuls, au milieu des réflexions d’un père qui voit son fils s’échapper pour une fille qui ne l’aime pas.
Quand Laurent Mauvignier entre, enfourné dans un caban gris, on perçoit la réalité d’un être. Regard sombre, corps habité, avec un début de calvitie. On ne tarde pas à découvrir un bon coup de fourchette et pas mal d’humour (« Vous devriez aller aux toilettes, un disque diffuse des chants d’oiseaux, un peu comme à Tchernobyl après l’accident, pour rassurer ceux qui passent ! »). Eh oui, c’est bien l’auteur des éditions de Minuit, l’écrivain aux phrases longues, quasiment envoûtantes, qui est là. En fait de timidité, il y a un homme qui parle facilement. Mais pas de tout. Une question sur son père provoque un silence, un écart de la main et, d’une voix serrée : « Non, ça, je n’en parle pas. »
Ecrire est le seul moment où Laurent Mauvignier est à sa place dans sa vie. Evidemment. On l’imagine normalien, féru de Proust et de Beckett, et on découvre un « exilé de l’intérieur ». Sa mère était « femme au foyer », son père, c’est tout ce qu’il en dira, « ouvrier métallurgiste puis éboueur ». Il n’est plus de ce monde-là, il n’est pas du monde de l’édition, ni de la bourgeoisie. Il est de sa langue, lui qui à 8 ans a commencé à écrire. « Tout petit déjà », se marre-t-il. Pourquoi ? « Mon père avait été appelé pendant la guerre d’Algérie ; il avait rapporté des photos de là-bas. On n’y voyait rien, en tout cas pas la guerre. J’adorais cet album et ma mère me racontait l’histoire de ces photos, une à une. C’est de là qu’est sans doute né mon désir d’écrire. » A défaut de Normale sup, il a fait un BEP de comptabilité. « Très utile grâce aux deux heures de dactylo par semaine. » Il écrit tous ses livres à l’ordinateur. « Vous savez, Rilke, dans ses Lettres à un jeune poète, conseille aux auteurs de faire recopier leur texte par quelqu’un d’autre pour éviter le sentimentalisme. L’ordinateur, c’est cruel, mais c’est ça. On lit comme de l’extérieur. » Lui qui écrit de l’intérieur.
De 12 à 16 ans, Laurent Mauvignier écrit plusieurs livres. Puis arrête. Fuit l’écriture. Après le BEP, il est pion dans un lycée. Et va jusqu’au bout. Le chômage. Il écrit alors trois livres. Les deux premiers disparaîtront, le troisième, Loin d’eux, il l’enverra aux éditions de Minuit par la poste. Deux jours plus tard, Irène Lindon le rappelle : elle prend son texte. La publication, c’est une reconnaissance. « D’un coup, je suis passé du statut de chômeur qui tire la gueule et boit beaucoup à celui de quelqu’un à qui on demande son avis. » Le succès auprès des critiques est immédiat. Une voix est née. Un écrivain de 32 ans. Le succès public viendra un an plus tard avec Apprendre à finir, prix du livre Inter, plus de 100 000 exemplaires. Des lecteurs fervents découvrent le monologue de cette femme quittée qui espère reprendre son mari victime d’un accident de voiture. Amoureuse puis libérée. Une femme du peuple qui ne parle qu’à elle-même. Absolument bouleversant.
Cette fois, avec Seuls, Laurent Mauvignier raconte l’étrange relation d’un homme, Tony, et d’une femme, Pauline, qui vivent ensemble sans s’aimer. Enfant, Tony a écrit à Pauline une lettre d’amour. Sans réciprocité. Etudiants, ils ont été colocataires. Aujourd’hui, Pauline revient de l’étranger et va passer quelques jours chez Tony. Tout passera par les souvenirs, agacements, grommellements du père de Tony. Encore un long monologue intérieur. Encore un livre bouleversant. Qu’on ne saurait trop recommander aux lecteurs de savourer jusqu’au bout car il contient une sacrée surprise.
Bien sûr, il y a les phrases longues. « C’est ridicule, cette critique… mais c’est vrai. Quand j’étais à l’hôpital, j’ai écrit un texte sur un gamin qui courait dans les champs. Je sais maintenant pourquoi mes phrases sont longues. Je n’arrête pas de courir. » Alors il écrit, il écrit. Sur ses carnets (l’histoire des chants d’oiseaux dans ce resto bordelais), et puis vient un moment où sa femme lui dit : « Il faudrait t’y remettre, tu deviens bizarre. » Des livres il en a plein la tête. « Mais je sais que certains, je ne pourrais pas les écrire avant longtemps. C’est pour ça que j’ai arrêté de fumer… A 70 ans il faut que je sois là. » Si l’on ne sentait l’émotion qui l’étreint, on penserait qu’il ironise. Ce n’est pas le cas.
Comme le disait un personnage du téléfilm de Laurent Cantet Ressources humaines : « Et toi, elle est où ta place ? » Laurent Mauvignier a du mal à qualifier ses origines. « Comme disait Koltès, arrêtez de me parler de mes “ racines ”. Je ne suis pas une salade ! » Il n’aime pas les mots « humbles », « modestes », « pauvres ». Il dit : « Les gens. » Il dit : « C’est dur d’être coupé de son origine et de son avenir. » Il ajoute : « Quand on lit un livre ou voit un film, il fait partie ensuite de vos origines. Je viens d’une famille épouvantable. J’en change la nature en faisant de la littérature. Il s’agit de transformer sa vie en mythe. » Le lecteur, son « frère fantasmé », apprécie.
Marie-Laure Delorme (Magazine littéraire, février 2004)
Labyrinthe sentimental
Laurent Mauvignier décrit des êtres qui dissimulent leurs sentiments, se désirent, se manquent. Entre l'envie de l'autre et la crainte de soi.
« Il raconte toujours la même histoire. La douloureuse attente, les coups de marteau du désir, la peur de l'Autre, les crocs de la solitude. l'explosion du drame. Et puis les mots qui séparent, mentent, égarent mais jamais ne relient. Seul le surgissement du malheur libère les hommes et les femmes de leur enfermement. C'était donc ça : on n'entendait rien, on ne voyait rien, on ne savait rien et pourtant c'était là. Si proche. Il suffisait de. Laurent Mauvignier, comme tout grand écrivain, possède son propre univers. Il raconte toujours la même histoire mais à chaque fois différemment. Il explore les frontières perdues de nos univers quotidiens. La famille (Loin d'eux, Éditions de Minuit. 1999), le couple (Apprendre à finir, Éditions de Minuit, 2001), la solitude (Ceux d'à côté, Éditions de Minuit, 2002). Il s'agit de rêves et de deuils ; de volontés et de craintes. Ses personnages sont arrivés au bout de leurs guerres intérieures et se retrouvent confrontés à leurs défaites sociales. Peut-on vivre sur le charnier de ses désirs ? Laurent Mauvignier, né en 1967 à Tours, semble écrire dans un souffle. Le ciselé de ses phrases, à l'intérieur desquelles la vie et la mort sont en état de lutte perpétuelle, se fait à un moment donné oublier : elles deviennent alors une magnifique houle.
Seuls parle du long et sinueux chemin des sentiments. Quand on veut autant que l'on ne veut pas l'amour. Des êtres se heurtent plus qu'ils ne se côtoient. Tout y est dit sauf l'essentiel. Tony est amoureux depuis toujours de Pauline. Il ne lui a jamais rien avoué. Juste parfois des bouts de cendres aussitôt éteints. Ils ont, dans leur adolescence, étudié, dîné, habité ensemble. Comme deux amis. Puis Pauline est partie à l'étranger pour suivre Guillaume. Tony a alors arrêté ses études. Il est devenu ce garçon de petits boulots et de filles de passage. Plus de joie ni de peine. L'indifférence. Mais aujourd'hui, Pauline est de retour. Tony va la chercher à l'aéroport. Elle dépose ses affaires chez lui. Ils peuvent unir leurs deux solitudes. Elle : sans amour et sans travail. Lui : sans amour et sans diplômes. On se dit alors que tout est possible. On a à la fois tort et raison. Ils vont vivre dans le même appartement durant un mois et demi. II va parler et parler pour qu'elle ne voie pas. Les regards sur son corps, l'angoisse comme une lame de fond, le durcissement de ses traits. Les mots vont être leurs tombes. Tony veut deux choses jusqu'à en mourir : qu'elle devine son amour et qu'elle ne devine pas son amour. Mais un jour Guillaume revient chercher Pauline.
L'histoire nous parvient à travers des voix. Elles donnent l'impression de se tenir la main pour raconter un seul et même drame. On perd et retrouve l'identité des narrateurs dans une impression de chœur brisé. Laurent Mauvignier tisse la toile des pleins et des déliés de ses quatre personnages principaux. La douleur de l'absence est partout. Besoin d'un fils : il y a l'incompréhension. Besoin d'un ami : il y a le mensonge. Besoin d'un amour : il y a le malentendu. Besoin d'un être : il y a la mort. La construction de Seuls est un tour de force. Une montée en puissance. Un hiver sans lendemain. Le grand thème des romans de Laurent Mauvignier est sans doute le désir. Qu'est-ce que l'on fait quand son désir ne trouve pas son devenir ? Il existe, dans toute son œuvre, un besoin fou de l'Autre. Ses personnages sont, malgré les apparences, des êtres passionnés, vibrants, métalliques. Ils veulent mais ne peuvent pas. Le manque de mots amène le manque de bonheur. La rage cogne en eux. Seuls est, comme les trois autres romans de Laurent Mauvignier, dénué de sentimentalisme. On est dans la folie de l'amour. C'est-à-dire dans l'envie de l'Autre et la crainte de soi : la peur de ce que l'on pourrait lui faire.
Le style, mélange de lutte oral-écrit, de répétitions nécessaires, de fureur contenue, se révèle une prouesse. Il y a des passages magnifiques. Des détails comme des clous. Une robe rouge, des chaussures sans lacets, une affiche de recherche, une maison en Bretagne, l'absence d'une mère, des carnets. La scène bouleversante du restaurant où il a fallu faire comme si. Comme si Tony était heureux de contempler son existence réduite en miettes par l'arrivée de Guillaume. Le personnage ambigu de Pauline offre au livre toute sa puissance. Ne pas savoir. Ne pas vouloir savoir. Seuls parle aussi des faux-semblants, des rapports père-fils, des violences cachées, des attentes succédant aux attentes. On y voit la solitude et la finitude des vies honteuses d'elle-même. On y entend des battements de cœur secs et rapides. Et puis la vieillesse soudaine de certains visages. »
Patrick Kéchichian (Le Monde, 23 janvier 2004)
La juste voix de Laurent Mauvignier
Seuls explore l’existence d’êtres voués à l’impossibilité de se rejoindre
« Laurent Mauvignier n’est pas un procureur. Il ne désigne aucun coupable : pour mettre en accusation, sans doute faut-il aller moins loin dans l’intériorité des personnes, moins profond dans le puits de détresse où ils se trouvent plongés. Il n’est pas non plus l’avocat des causes désespérées qui font la trame de ses récits. Il écrit, dirait-on, dans la position du témoin, de celui qui partage, qui souffre avec ses personnages en inventant la parole même de cette souffrance. En la tirant de son propre fond, puis en s’effaçant.
Le succès public – et critique – rencontré par les trois premiers romans de Laurent Mauvignier démontre qu’il touche juste. Apre, douloureuse, constamment tendue, son écriture n’offre pourtant aucun des agréments et des démagogies qui accompagnent généralement, ou multiplient, les suffrages. Ce qui est juste, qui fait justice, c’est donc cette voix que le romancier construit mot à mot, avec un sens aigu de la respiration et du rythme. Cette voix, Seuls la fait à nouveau entendre avec une grande pureté. Comme si les situations narratives, les circonstances sociales et mentales, tout l’itinéraire des personnages n’étaient destinés qu’à cela : dessiner une ligne blanche, un chemin invisible dans l’épaisseur et l’obscurité des vies afin de témoigner en faveur de celles-ci, de les mettre en lumière – alors même que tout invite à les taire, à les dissimuler, à les noircir. Mais de quelle pureté peut-il s’agir lorsque la fatalité, la misère morale ou matérielle semblent seules dominer et commander les existences ? Citons un passage, volontairement soustrait de son contexte : “ c’était la colère et le désordre, comme on parle de la foule pour dire qu’elle est une marée et qu’elle peut déborder, chavirer, eh bien lui, tout seul, sans rien ni personne que ce monde où depuis longtemps il se fabrique des larmes et des couteaux, oui, Pauline, il se prépare. Il vacille et ni les larmes ni le désarroi ne desserreront ses mâchoires. ”
Si Tony, cet homme qui chavire, parlait lui-même, la “ colère ” et tout ce qui fait son “ désarroi ” le déborderaient. S’il était simplement et classiquement mis en situation, dans la distance de l’écriture, rien d’authentique ne pourrait être dit sur ce qui se “ fabrique ” de “ larmes ” et de “ couteaux ” au secret de son cœur. Mauvignier a choisi une solution difficile et risquée, menacée par l’artifice : faire entendre exclusivement la voix des tiers, de ceux qui assistent de l’intérieur, y participant, au drame qui se joue entre Pauline et Tony, non pas seulement dans le temps du récit, mais dans sa préhistoire. Le père de Tony puis un compagnon de Paule vont raconter, passé et présent mêlés, cette fatalité malheureuse faite de silence et d’impuissance qui empêche un être d’en rejoindre un autre pour (se) faire, ensemble, du bien, pour ne plus être “ seuls ”. Mais, au lieu de cela, il faut constater à nouveau que personne ne peut “ donner de l’amour à qui n’est pas capable d’en recevoir ”. Et cette double incapacité, au lieu du bien, fera le mal. “ … La douceur pour lui c’était le tapage dans sa tête et la patience toujours la même faillite, l’amour pelé, râpé dans des concessions où il faisait tout pour trouver de quoi tenir et se punir aussi de n’être que lui, digne de s’écraser… ”
Ce n’est pas réduire le mérite du romancier que de saluer sa réussite technique, et la parfaite coïncidence de sa manière et de son propos. Le monologue intérieur, ici, est comme voué à sortir de cette intériorité, à se construire en faveur d’autrui. C’est là que réside la pureté de la voix de Mauvignier. »
Jean-Claude Lebrun (L’Humanité, 15 janvier 2004)
Récit d’une déroute
« Il ne fait pas de doute que Laurent Mauvignier, au terme déjà de quatre romans, s’affirme comme l’un des talents les plus sûrs de la nouvelle génération. Sa puissance d’écriture, sa façon d’empoigner la langue, de la forger dans des postures inaccoutumées, en effet à chaque page ici éclate. En parfait accord avec la rudesse et la violence contenue du sujet. Si la critique aujourd’hui ne se prêtait pas tant au soupçon de fonctionner sur le mode superlatif – inversé chez tel ou tel en détestation systématique –, l’on n’hésiterait pas à situer Seuls parmi les textes les plus marquants de ces dernières années.
Il y est question, très communément, d’un jeune homme et d’une jeune femme. Mais aussi du père de celui-là et d’un autre homme dans la vie de celle-ci. Tony Rousset depuis l’âge étudiant s’était énamouré de Pauline, qui ne s’en était jamais avisée. Ou avait peut-être fait comme si. Un jour, elle était partie avec un autre. Il avait arrêté ses études et s’était mis à voyager, parcourant ici et là des villes, pour “ réapprendre à vivre ”. Il travaille maintenant de nuit au nettoyage des wagons dans un entrepôt ferroviaire. On le devine le regard terne, prématurément désabusé. Une ombre d’humain. La thématique n’est pas nouvelle, on la voit circuler un peu partout aujourd’hui chez les romanciers de la jeune génération. Combien d’attentes qui, à force de se prolonger, débouchent sur une sensation de no future et de néant ? Combien de ces destinées solitaires prises dans les rets médiocres d’une existence prosaïque ? Combien ? dans ce marasme, de violence restée à l’état de latence ? La littérature ne se lit jamais vraiment hors du monde où elle s’écrit. Mais elle n’en est pas davantage la banale transcription. En ces premières années du siècle, le roman tire fortement vers le noir et le glauque. C’est un fait qu’il faut bien admettre et essayer de comprendre. Laurent Mauvignier, sur ce chapitre, s’inscrit dans le courant. Là où commence sa différence, c’est dans la manière, le style. Ce qui constitue assurément le propre de tout véritable créateur.
Voici donc un premier narrateur évoquant le retour surprise de Pauline dans l’appartement de Tony, après des années d’absence. Et la métamorphose qui s’ensuit. Celui qui avait d’abord fait assaut de cynisme, n’ayant pour vision de la vie que “ le mépris et la révolte ”, puis, la considérant comme “ un partage des ratages, des erreurs ”, se prend à espérer. Mais sans le laisser remarquer : comme auparavant, il stimulera l’indifférence, fera semblant de jouer au gentil frère. De son côté, elle donnera à l’impression de ne rien remarquer de ce qui ne cesse d’agiter le brave Tony. Ces deux-là incontestablement s’apprécient, mais sur la base d’un total malentendu. Comme si, dans une époque encline comme jamais à la pleurnicherie et à la sentimentalité de midinette, les sentiments qui engagent vraiment ne pouvaient plus se dire. Ou alors de façon détournée, par peur peut-être de sortir du personnage qu’on s’est façonné et de s’en trouver ridicule. Lorsque Pauline un jour repart, pour rejoindre l’autre, Tony s’en va ainsi vers son père, confident inattendu, tant ils semblaient jusqu’alors indifférents l’un à l’autre. Mais c’est justement ce père qui tient le rôle du narrateur principal et montre son intelligence de la situation. Laurent Mauvignier excelle à explorer l’incommunicabilité, à la traquer dans ses détails les plus minimes. Il construit peu à peu le véritable tableau clinique d’un temps qui n’hésite pas à pratiquer l’incontinence verbale comme antidote à son aphasie foncière. Qui peut recourir à la violence, faute d’accéder à l’expression de ce qui l’agite. Pauline, retrouvée par Tony, paiera le prix fort pour toute cette passion tue. Quand les mots échouent à sortir du non-dit, c’est toute une primitivité à peine enfouie qui resurgit.
Adolescent, Tony avait accoutumé de tenir un journal intime. Jusqu’à ce que son père un jour s’en empare et le lise, provoquant entre eux la rupture. La véritable scène primitive du récit. Toujours cette question des mots et de la souffrance, quand ils ne peuvent se dire, mais aussi quand on force leur accès. La finesse d’approche est ici admirable. Liée intimement à la singularité de cette langue, au souffle saccadé de la phrase, lui-même amplifié par la distorsion de la structure classique. Tel Tony, resté jusqu’au bout « droit dans sa déroute », le texte de Laurent Mauvignier se tient continûment sur cette hauteur escarpée et magnifique. Par sa forme, il laisse pressentir un insondable chaos là où ne paraissait péniblement s’écouler qu’une destinée désespérément atone. De l’âme de ce temps, de ses complications et contradictions, il invente tout simplement un style nouveau de représentation littéraire. »
Jean-Baptiste Harang (Libération, 15 janvier 2004)
Désespoir pour la soif
Laurent Mauvignier s’y entend comme personne pour dire le gris du réel et donner voix à ceux qui se taisent.
« Le mot “ seuls ”, au pluriel, qui donne au livre son titre, a de faux airs d’oxymoron, on se dit qu’après tout, à plusieurs, on doit se sentir moins seul. Les titres précédents de Laurent Mauvignier ne laissaient guère espérer un tel goût pour le paradoxe désinvolte, Loin d’eux, Apprendre à finir et Ceux d’à côté, et leurs lecteurs avaient ravalé dès les premières pages tout penchant pour la gaudriole. Les livres de Laurent Mauvignier sont faits de douleur et de littérature, ils s’écoutent autant qu’ils se lisent, l’écriture s’incarne en une voix pressante. Cette voix ne s’adresse qu’au lecteur, il n’y a personne dans le livre pour l’entendre, tout le monde y est le seul, ensemble ou séparément.
La voix est toujours celle de Laurent Mauvignier, elle pourrait être jetée sur une scène de théâtre, une voix reconnaissable, avec son assurance, sa juste vue des choses, mais aussi ses détours, ses hésitations, des phrases qui, parfois, ne trouvent pas leur fin, qui s’arrêtent un pied en l’air, sans point. Et retombent au paragraphe suivant avec ou sans majuscule, sur un bon ou un mauvais pied, elles se font mal, on appelle cela un style. C’est aussi chaque fois la voix d’un autre qu’on se figure, d’un personnage auquel on croit. Ici, ils sont deux, ils se relayent dans le mitant du livre, parce que ce qu’il y aura à dire est trop lourd pour un seul homme, pour le seul homme qui compte ici, Tony, qui, lui, ne dit rien, ne dira rien, qui finira mal comme toutes les histoires d’amour et de solitude en général. Les deux qui se relayent ne se nomment qu’à peine, le premier est le père de Tony, au détour d’une phrase, page 24, “ puisque, voilà ce père, c’est moi ”, et l’autre Guillaume, l’amant de Pauline, qui a pris la parole depuis quelques pages, pour dire, justement, ce qui concerne le père et que le père ne peut pas dire de sa propre voix, laisse filer, page 109, l’aire de rien (alors que c’est toute l’histoire) : “ puisque cet homme qui est revenu, c’est moi ”. À ces deux petits bouts de phrases, cette symétrie voulue, on voit bien que la voix plurielle est unique, les deux pupitres d’un même chœur.
Mais peut-être fallait-il commencer par dire l’histoire, on la recopie sur la couverture du livre pour être certain de ne pas en dire trop, surtout la fin, qu’on ne dit pas mais que l’on craint, celle-là ou une autre, tout au long du livre, pour s’en tenir à ce que l’auteur et l’éditeur ont choisi de faire savoir : “ Pauline est revenue. En attendant de trouver un appartement, elle s’est installée chez Tony, comme lorsqu’ils étaient étudiants. Tony raconte à son père que rien n’a changé : il fait toujours semblant de n’être pas amoureux d’elle, et elle ne s’aperçoit de rien. Mais quand Tony part sans prévenir personne, c’est à Pauline que son père va demander de l’aide. Et cette fois, il faudra bien que tout soit dit. ” On pouvait ajouter que Guillaume revient (on le sait), que Pauline quitte l’appartement de Tony pour le rejoindre. Qu’importe : les livres de Laurent Mauvignier ne se résument pas comme des vaudevilles. Ils sont des travellings sur les gris du réel, les mauvaises dents, les trains de nuit, ceux qu’il faut laver à grande eau entre deux trajets (c’est le travail de Tony), les lunettes toujours sales qu’on ne sait pas essuyer, une mère morte avant qu’on ait l’âge de comprendre que tout le monde meurt. Une petite fille disparue, mal photocopiée sur les pompes des stations-service, les caisses de supermarchés. La caisse du chat que l’on change les jours d’espoirs, qui s’englue quand tout va mal. Les vrais semblants. La politesse du désespoir, ce silence qui ment. Des gens qui s’aiment, qui ne savent pas s’aimer, qui ne s’aiment pas pareil, de l’amour contre de l’amitié, de la haine contre de la maladresse. Le mal de vivre tue.
Les livres de Mauvignier donnent une voix aux taiseux, à ceux qui ne peuvent ou ne savent pas dire. Ici, le désordre, la douleur et la tragédie sont terrés dans la pensée de Tony. Tony se tait et Mauvignier lui prête deux voix, des voix qui ne sont pas les siennes, celles du père longtemps haï, celle de Guillaume, son rival transparent, et il réussit ce tout de force de nous imprégner de la pensée de Tony, de sa douceur et de sa douleur, de sa patience et de sa folie, par le truchement de ceux qui ne le comprennent pas, ce n’est pas une pensée, c’est une folie, un désordre amoureux, une vie en biais, faussée par un mauvais départ, par une fausse patience. La folie de Tony est d’aimer, d’aimer Pauline, de l’aimer à la folie, avec la discrétion et la tendresse de trop vieux amis, dans un jeu de rôle où l’on n’est dupe que de soi-même, jusqu’à ce qu’une colère éclate plus grosse que la honte, plus lourde que l’impuissance à dire, que le malheur soit assez grand pour recouvrir l’entièreté d’un bonheur perdu. Et qu’on en parle plus. »
François Nourissier (Le Figaro Magazine, 21 février 2004)
Donnez-nous notre prose quotidienne
« Une fois n'est pas coutume, je vais m'offrir – vous offrir – une citation. La voici : “ Je pensais que c'était ça que je finirais par oublier. Mais non. Des nuits entières. Ma vie ne passe pas. Il y a des gouffres qui reviennent dans mes rêves, des espaces qui vibrent, des murs liquides, c'est de l'eau noire qui s’infiltre et déborde, et puis la nuit jette ses nuages, sa lune voilée. Et quand je ne pense plus à rien et que c'est plus doux, ça revient aussi : la honte de n'avoir pas su me tenir à la hauteur de ma peur. ”
Qu'en pensez-vous ? Je trouve cela très beau : l'eau noire... les murs liquides… Il y a là du désespoir, de la nuit, de la simplicité et quand même un fond de mystère et de peur. Ce sont les qualités de Seuls, quatrième roman de Laurent Mauvignier, dont on avait déjà aimé Loin d'eux, Apprendre à finir, Ceux d'à côté.
Qui est seul ? Ou “ qui sont seuls ? ” diront les apprentis grammairiens facétieux. Jusqu'à la dernière page les personnages de Mauvignier vont clamer leur vocation à la liberté et à l'égalité. Égalité, ici, relative : celle des vies grises, des lents étouffements. Version banlieusarde de La Mort du loup. L'auteur est excellent quand il fait parler les éternels muets de cette tragédie en mineur que composent les amours à contretemps. On se rappelle la trouvaille que fit un jour Mme Marcelle Segal dans son Courrier du Cœur : “ Je ne l'aime pas, il ne m'aime pas – que faire ?... ” Des incohérences de cette sorte malmènent les trois personnages de Seuls : Pauline, Tony, son père. Du temps qu'ils étaient étudiants, Pauline et Tony ont partagé un appartement, ce qui ne signifie pas coucher, en tout cas pas pour eux, mais assiettes sales, divan convertible, et cette humiliation qu'éprouve un homme quand il voit, par l'entrebâillement d'une porte, la fille qu'il aime enfiler du linge et une robe qu'un autre lui retirera tout à l'heure. Pauline est partie, à la traîne d'un type, comme d'habitude, puis revenue après un échec. La “ vie d'étudiante ”, quoi ! Réinstallée chez Tony, et ne voulant pas voir le désir du garçon, qui crève les yeux, elle va provoquer beaucoup de dégâts. Et le père de Tony, que fait-il là-dedans ? Il tient le stylo, m'a-t-il semblé, il était quand même plus facile de lire Capitaine Fracasse que d'affronter l'éternel “ Qui parle ? ” des romans d'aujourd'hui ! Improbable, dangereux, le trio est en place : la tragédie peut commencer.
J'éprouve beaucoup de plaisir à savourer l'art d'écrire de Laurent Mauvignier. Ce n'est pas du joli style. C'est râpeux, épais, parfois même un peu charabia : de la pâte à pain dans un vieux pétrin. Au volant de son camion, l'auteur ne feint pas de déraper dans les pièges d'un rallye : pas de contorsions pour avoir l'air d'un acrobatie, il s'acharne à exprimer le plus fin de ses sensations sans abandonner sa façon d'écrire, avec sa robustesse, ses déboires répétitifs, son poids. Là où la chèvre est au piquet, elle broute. C'est bien la sensation que me donne Mauvignier, d'un écrivain qui, lorsque son récit en a besoin, se porte au-dessus de lui-même, s'opiniâtre, se force, se bat sans se croire obligé de risquer quelque morceau de bravoure. Mauvignier n'est pas l'écrivain des prouesses, mais il donne à la sourde misère des petits-bourgeois cette rugosité et cette patine qui sont d'autres formes de la prouesse littéraire. Le lecteur ne sait pas pourquoi, mais il marche. L'émotion naît. Naturalisme pas mort : un réalisme aléatoire, détaché, “ décalé ”. (“ Déconstruit ” et “ décalé ” sont des mots à la mode, bien commodes quand même...) Lisez, page 78, le monologue du père venu demander à Pauline de l'aider à sauver Tony de ses démons : c'est d'une qualité et d'une ambition rares. »
Du même auteur
- Loin d'eux, 1999
- Apprendre à finir, 2000
- Ceux d'à côté, 2002
- Seuls, 2004
- Le Lien, 2005
- Dans la foule, 2006
- Des hommes, 2009
- Ce que j'appelle oubli, 2011
- Tout mon amour, 2012
- Autour du monde, 2014
- Retour à Berratham, 2015
- Continuer, 2016
- Une légère blessure, 2016
- Histoires de la nuit, 2020
- Proches, 2023
Poche « Double »
- Loin d'eux, 2002
- Apprendre à finir, 2004
- Dans la foule , 2009
- Des hommes , 2011
- Autour du monde, 2016
- Continuer, 2018
- Voyage à New Delhi, 2018
- Histoires de la nuit, 2022
Livres numériques
- Apprendre à finir
- Ce que j'appelle oubli
- Ceux d'à côté
- Dans la foule
- Des hommes
- Le Lien
- Loin d'eux
- Seuls
- Tout mon amour
- Autour du monde
- Retour à Berratham
- Autour du monde
- Une légère blessure
- Continuer
- Histoires de la nuit
- Proches
