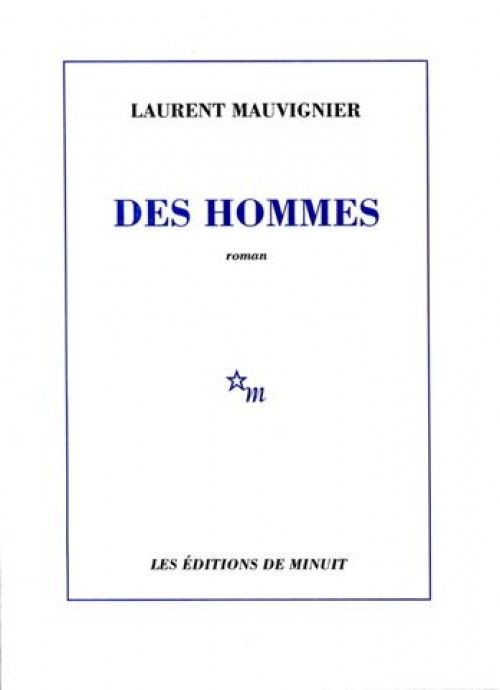
Laurent Mauvignier
Des hommes
Prix Millepages 2009
Prix Initiales 2010
Prix des Libraires 2010
2009
288 p.
ISBN : 9782707320759
17.75 €
45 exemplaires numérotés sur Vergé des papeteries de Vizille
* Réédition dans la collection de poche double .
Ils ont été appelés en Algérie au moment des événements , en 1960. Deux ans plus tard, Bernard, Rabut, Février et d'autres sont rentrés en France. Ils se sont tus, ils ont vécu leurs vies.
Mais parfois il suffit de presque rien, d"une journée d’anniversaire en hiver, d’un cadeau qui tient dans la poche, pour que, quarante ans après, le passé fasse irruption dans la vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier.
ISBN
PDF : 9782707321848
ePub : 9782707321831
Prix : 8.49 €
En savoir plus
Nelly Kaprièlian, Les Inrockuptibles, 8 septembre 2009
Une guerre trop refoulée pour apparaître dans le roman français ? Ou trop honteuse, comme si la littérature française se devait d'être la vitrine du pays, dès lors seulement dévolue aux Première et Seconde Guerres mondiales comme versions héroïques du destin français ?
Alors que les écrivains américains, dont Philip Roth, Toni Morrison, Denis Johnson ou encore Jayne Anne Phillips, n"ont jamais hésité à s’emparer de la guerre de Corée ou de celle du Vietnam, à fouiller les non-dits collectifs et les mémoires qui blessent, Laurent Mauvignier, 42 ans, signe l’un des trop rares romans autour de la guerre d’Algérie (1954-1962), sans conteste le plus puissant.
Ni juge ni démagogue, il ouvre son septième roman, Des hommes, par une réunion de famille et de voisins dans un village français aujourd’hui, qui tournera à la tragédie quand l’un d’entre eux, semi-clochard, semi-cinglé, exclu de l’assemblée, se vengera en agressant brutalement une famille d’Algériens. C’est en fouillant la mémoire de ces hommes pourtant tranquilles et vieillissants à l’aune de cet événement que Laurent Mauvignier fracture son roman en son milieu par une brusque plongée en pleine guerre d’Algérie, soit quarante ans avant, pour mieux mesurer l’onde de choc de cette guerre sur la psyché d’individus qui ne s’en sont jamais remis. Ces hommes qui ont tué, violé, torturé en Algérie, ou au contraire ont refusé de le faire et ont assisté de force à l’horreur, et qui restent, pourtant, des hommes .
Comme dans les drames intimes des précédents romans de Mauvignier, Apprendre à finir (2000) ou Ceux d’à côté (2002), c’est encore une fois par la voix-litanie de narrateurs que l’on pénètre dans l’univers clos d’une tragédie collective. En accompagnant depuis dix ans la trajectoire littéraire de Laurent Mauvignier, ses romans en forme de monologues circulaires et blessés, c’est à une montée en puissance romanesque époustouflante qu’on assiste. De l’incarcération de soi dans sa propre psyché (Loin d’eux, 1999) à l’incarcération des êtres face à l’événement (la tragédie du stade du Heysel de Dans la foule, 2006), ou aujourd’hui dans les rets de l’Histoire, d’une histoire qui ne les laissera jamais en paix. Des hommes est un très grand roman - celui qu’on attendait sur la guerre d’Algérie.
ENTRETIEN
Pourquoi avez-vous eu envie d’écrire autour de la guerre d’Algérie ?
Laurent Mauvignier – Mon père a fait le guerre d’Algérie et en a ramené plein de photos… sur lesquelles il n’y a rien, et ça me perturbait beaucoup. Lui n’en parlait pas, c’est ma mère qui me racontait ce qu’il avait vécu, des histoire horribles, comment il avait, par exemple, été traumatisé par la vue d’une femme enceinte piétinée par des soldats français. Et puis chaque année, il y avait les repas des anciens d’Afrique du Nord, sauf qu’on ne savait pas ce que c’était puisque personne ne disait rien… Quand on discute avec des gens de notre génération, on s’aperçoit qu’on a tous dans nos familles quelqu’un qui a fait l’Algérie, mais qui n’en dit pas un mot. En France, dans la littérature, dès qu’on parle de la guerre, c’est 14-18 ou la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu de loin en loin quelques romans sur la guerre d’Algérie, mais je crois que le problème, c’est que les auteurs sont restés pédagogiques, en tentant de dénouer les rapports historiques ou de montrer qui sont les bons et les mauvais. C’est louable, mais si on observe comment les cinéastes américains s’emparent du Vietnam – comme dans le film de Michael Cimino, Voyage au bout de l’enfer –, on s’aperçoit que la plupart du temps ils mettent en scène un rapport frontal à la violence plus que l’histoire de la guerre. Ce qui m’a intéressé, ce n’est donc pas de faire un roman sur la guerre d’Algérie en montrant les bons et les mauvais, c’est de mettre des hommes en situation.
Vous avez fini par interroger votre père ?
Il s’est suicidé quand j’étais adolescent. Il m’a fallu des années pour me dire que, peut-être, le fait d’avoir participé à cette guerre et d’avoir vu ces choses avait contribué à son suicide. Il y est resté vingt-huit mois, ça n’est pas rien. J’ai entendu aussi l’histoire de types qui devenaient fous. Ça ressemble à un cliché, mais ça m’a aussi intéressé de trouver le moyen, techniquement, de dire ces clichés.
Vous avez compris les raisons du non-dit chez cette génération ?
Peut-être qu’ils se sont dit les Allemands, c’est nous … Ils ont utilisé du napalm, il y a eu la question de la torture, et puis la trahison de la France, atroce, envers les harkis. Bref, la sensation d’être du mauvais côté. Et puis c’était une guerre sans objet, extraordinairement complexe : d’abord civile, dans la mesure où l’Algérie était la France, civile aussi entre Algériens… C’est une guerre perdue, et comme au XXe siècle la France en a perdu plusieurs, c’est la guerre de trop : la petite guerre par rapport à la Seconde Guerre mondiale, la guerre honteuse. Je crois que le sentiment de honte est le plus fort.
Qu’est-ce qui a été le plus difficile dans l’écriture de ce livre ?
Montrer les relations de cause à effet entre ce qu’ils ont vécu pendant la guerre et ce qui arrive quarante ans après, quand le roman s’ouvre dans le petit village. Et aussi ce passage quand ils arrivent dans une guerre qui a déjà commencé. La question de la causalité entre les Algériens qui attaquent et les Français qui répondent violemment est insoluble. Il ne fallait pas que je fasse croire que les Algériens étaient violents d’emblée et que les Français le devenaient en réaction.
Pourquoi les écrivains français se sont-ils emparés de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, en délaissant la guerre d’Algérie ?
Parce que la guerre d’Algérie n’est pas finie. Le Front national, c’est la guerre d’Algérie. Les propos qu’on entend aujourd’hui, cette espèce de racisme progressiste, l’idée qu’un Français ne peut pas être algérien – et donc qu’un Algérien ne peut pas être français –, c’est vraiment la question de départ de la guerre d’Algérie. Et on voit bien comment en France aujourd’hui cette question n’est pas réglée. Dans l’inconscient collectif, il y a quelque chose de ce rejet de l’Algérien qui continue, parce que cette question n’a jamais été pensée dans sa globalité sur les cinquante dernières années. Ça devient un refoulé. La France n’arrive pas à se donner une identité à travers ça, alors que face à la Première et la Seconde Guerre mondiale, elle peut s’en inventer une héroïque.
Les écrivains américains semblent moins hésitants à traiter la Corée ou le Vietnam…
C’est dû à une histoire littéraire différente. En France, on a mis beaucoup de temps à revenir à une littérature du sujet. J’ai mis dix ans avant d’assumer l’idée de faire un roman avec des personnages, des situations. Je suis parti d’une écriture qui passait par la voix intérieure d’un narrateur, et là j’aboutis à un passage sur la guerre, avec des personnages en situation d’une violence inouïe. Au bout d’un moment, j’ai réalisé qu’il me fallait sortir du poids des avant-gardes et accepter de faire un roman très roman si c’est ce que j’avais envie de faire. Adolescent, je lisais Dostoïevski et je trouvais ça très fort. Puis j’ai lu la littérature du XXe siècle et les avant-gardes… C’est finalement le cinéma qui m’a fait comprendre que j’avais envie de revenir au roman , c’est en voyant Raging Bull (de Scorsese, où De Niro incarne le boxeur Jake La Motta – ndrl) que j’ai réalisé que j’aimais aussi ça en littérature, quelque chose qui cogne, et que c’est ce que j’avais envie de faire. On peut certes y revenir par l’ironie, comme Jean Echenoz l’a fait avec Zatopek (son roman sur le coureur de fond tchécoslovaque – ndrl), en montrant qu’on n’est pas dupe de ça…
Mais c’est peut-être bien d’accepter d’être dupe…
Pour ça, il m’a fallu lâcher prise. Je voulais créer une vraie rencontre entre moi, le livre et un éventuel lecteur, un texte qui ne soit pas que du consommable. J’ai essayé d’écrire de la littérature qui dise quelque chose sans renoncer à ce qu’a été le XXe siècle formellement. Je sais que beaucoup de gens n’acceptent pas le rapport à l’émotion et aux clichés en littérature, alors qu’ils le font sans aucun problème au cinéma. C’est comme s’il y avait un machisme littéraire : l’émotion et les sentiments, c’est bon pour la littérature populaire, c’est des trucs de femme, il faut s’en méfier. Alors qu’au cinéma, les meilleurs cinéastes ne se posent pas la question.
Le point commun entre tous vos romans, c’est le non-dit ?
Oui, mais pour le dire, pas pour le réparer. Plutôt pour tourner autour, pour le souligner, comme on souligne un corps invisible. Ça, c’est vraiment le propre du roman, c’est ce que l’histoire, la philo ou la sociologie ne peuvent pas faire. Le roman peut montrer les manques mais il ne s’agit jamais pour lui de donner des réponses. Le roman, c’est l’art de reformuler les questions.
Jérôme Garcin, Le Nouvel Observateur, 27 août 2009
Les blessures assassines
Jeunes paysans, ils sont partis en 1960 se battre en Algérie et sont revenus brisés pour toujours. Ils parlent dans ce livre polyphonique et magistral
Il se prénomme Bernard. Dans le pays, on l'appelle Feu-de-Bois. Ça lui va bien. Il est brûlé de l'intérieur, noir de crasse et d'alcool, inflammable. Il se consume lentement, dans un mutisme et une misère à faire peur. Il a 63 ans, le visage bouffi, les cheveux jaunes, de grosses moustaches et un nez grêlé. Il vit seul, dans un gourbi. La nuit, il arpente la forêt, un fusil sous le bras; le jour, il traverse la campagne sur sa vieille Mobylette pour aller s'échouer sur le zinc des bars. C'est, dit de lui Laurent Mauvignier, un bloc de silence qui s'est rétracté.
Feu-de-Bois sent mauvais. Il pue la mauvaise gnôle, la cendre froide et la haine. Pour tout le village, et pour les siens en particulier. Pour lui-même, aussi. Autrefois, il a insulté l'une de ses sœurs sur son lit de mort ; il a accusé sa mère de lui avoir volé un chèque; il a abandonné, dans la banlieue parisienne, sa femme et ses deux gosses. Seule sa sœur Solange trouve encore grâce à ses yeux. Le jour de son anniversaire, dans la salle des fêtes où tous les amis sont réunis, en titubant il lui offre une broche en or nacré avec l'argent qu'il a dérobé à sa mère après son départ pour la maison de retraite. Solange la refuse. Fou de colère et d'humiliation, il part alors casser du bougnoule, pénètre dans la maison de Saïd, le seul Arabe du canton, tente de violer sa femme, terrorise leurs enfants et s'en retourne chez lui, ivre mort. Il vomit son passé. Il se vomit.
C'est la guerre d'Algérie qui l'a brisé, qui a fait de lui une épave. Parti avec un FM et un missel, il ne s'en est jamais remis. Une jeunesse en enfer. Les camarades abattus. Le médecin du bataillon martyrisé. Les fellagas torturés. Les filles violées. Les corps carbonisés par les bombardements au napalm. Les villages détruits. Les harkis qui trahissent et ceux que la France a trahis. Là-bas, pourtant, il a rencontré Mireille, il rêvait de fonder une famille et d'ouvrir un garage en France. Mais il a fini à la chaîne des usines Renault de Billancourt, habité une HLM, et finalement tout largué pour revenir croupir, en 1973, dans son village natal, broyer du noir et se battre avec ses fantômes.
D'autres, comme son cousin et voisin Rabut, ont aussi été appelés en 1960, et ont connu l'horreur. En apparence, ils s'en sont sortis. Ils mènent aujourd'hui de petites vies respectables. Ils ne se vautrent pas dans l'abjection comme Feu-de-Bois. Mais ils sont pareillement hantés, malgré les lourdes doses d'anxiolytiques. Ils se cachent toujours pour souffrir. Ces mots, par exemple, Rabut n'a jamais osé les dire à sa femme : Nicole, tu sais, on pleure dans la nuit parce qu'un jour on est marqué à vie par des images tellement atroces qu'on ne sait pas se les dire à soi-même.
Des hommes, magnifique et bouleversant lamento collectif, n'est pas un roman sur la guerre d'Algérie, c'est un livre où parlent tous ceux qui ne trouveront jamais la paix. C'est un livre sur la guerre qui continue après la guerre. Aussi violente, sanglante, et injuste, elle est désormais intérieure, comme une hémorragie interne dont on ne guérit pas. Même si Laurent Mauvignier raconte, avec une force et une précision incroyables, les derniers combats entre l'armée française et le FLN, le traumatisme qu'il décrit est le même que celui dont ont souffert, à en devenir fous, à en mourir, les rescapés du Chemin des Dames ou les vétérans du Vietnam.
C'est le septième livre de Laurent Mauvignier. Le plus accompli, le plus torrentiel, le plus étourdissant, celui qui les rassemble tous : Loin d'eux, Apprendre à finir, Ceux d'à côté, Seuls, le Lien et Dans la foule. Car depuis dix ans ce jeune et singulier romancier, qui tient de l'écrivain public et du psychothérapeute, n'a de cesse, en s'effaçant toujours plus, de rendre la parole aux sans-voix, d'arracher des aveux aux taiseux, de ressouder les destins brisés, de nommer l'innommable, d'écouter les survivants de désastres intimes – un suicide, un viol – ou de drames qui ont marqué les consciences, comme celui du stade du Heysel, en 1985. Sa prose, étonnante, organique et polyphonique, mêle les récits de tous ces anonymes pour n'en faire qu'un.
Ici, dans cette tragédie en quatre actes (après-midi, soir, nuit, matin), Feu-de-Bois, Rabut, Février et les autres, qu'ils l'exhibent ou la dissimulent, qu'ils la fassent saigner ou la pansent, portent la même blessure et semblent charger Laurent Mauvignier d'en mesurer la largeur et la profondeur. Ils ont raison de lui faire confiance : ce grand écrivain ne les trompera jamais, et sa main ne tremble pas.
Minh Tran Huy, Le Magazine littéraire, septembre 2009
Chœur brisé par l'Algérie
Roman après roman, les catastrophes bouleversant les vies des personnages de Laurent Mauvignier gagnent en ampleur. Apprendre à finir (prix du Livre Inter 2001) déroulait le monologue d"une femme qui ne se résignait pas à la dissolution de son couple. Dans la foule (2006) faisait entendre, en une polyphonie virtuose, les voix d’hommes et de femmes spectateurs, victimes ou coupables du drame du Heysel, avant, pendant et bien après les mortelles bousculades qui firent quelque trente-neuf morts et six cents blessés. Des hommes, l’un des plus beaux ouvrages qu’il nous ait été donné de lire en cette rentrée, s’intéresse pour sa part au traumatisme et aux traumatisés de la guerre d’Algérie. Longtemps désigné sous le terme des événements , comme si on espérait que cette dénomination lui permettrait de basculer discrètement dans les oubliettes de l’histoire, ce conflit, revenu au premier plan à l’occasion de l’apposition en 2001 d’une plaque sur le pont Saint-Michel à la mémoire des Algériens tués à Paris le 17 octobre 1961, de la reconnaissance par Jacques Chirac la même année d’une dette d’honneur à l’égard des harkis, ou de films tels que Nuit noire ou L’Ennemi intime, sert de toile de fond à plusieurs ouvrages paraissant cet automne, dont L’Aimé de juillet de Francine de Martinoir (lire p. 27), La Chambre de la vierge impure d’Amin Zaoui, ou encore Le Rapt d’Anouar Benmalek (lire p. 32) - comme si la littérature s’engouffrait dans la brèche d’une mémoire ravivée aujourd’hui après avoir été occultée des années durant.
Découpé en plusieurs chapitres/séquences intitulésAprès-midi, Soir, Nuit, Matin et architecturés à la manière d’un montage cinématographique, Des hommes se déroule apparemment sur vingt-quatre heures – le temps prescrit pour une tragédie –, en réalité sur quatre décennies, un vaste mouvement de flash-back s’amorçant à l’arrivée de la Nuit . Tout commence de nos jours lors d’une fête d’anniversaire organisée en l’honneur de Solange. Surgit le frère, un pauvre bougre surnommé Feu-de-Bois tant l’odeur de crasse, de vin et de charbon de bois qui émane de lui a effacé Bernard, l’homme qu’il fut autrefois. Son comportement, entre égarement et agressivité raciste, crée le scandale, amenant le narrateur, son cousin Rabut, à se remémorer des souvenirs qu’il a longtemps repoussés, voire reniés. Avec la Nuit s’opère un basculement à la fois géographique, temporel et narratif : nous voilà en Algérie quarante ans plus tôt, alors que la guerre bat son plein. Rabut cesse d’être notre guide et témoin pour devenir un protagoniste parmi d’autres, engagé tout comme Bernard au sein d’un conflit qui refuse de s’avouer comme tel. C’est au cours de ces quelques mois d’épreuves que réside la clé expliquant la conduite de Feu-de-Bois, si bien que, lorsque au Matin nous revenons au présent et au récit de Rabut, le regard que nous posons sur ce dernier comme sur Bernard/Feu-de-Bois, et l’incident du premier chapitre, change du tout au tout.
On avait déjà pu admirer la maîtrise de Laurent Mauvignier dans l’orchestration des points de vue avec Dans la foule, où les monologues de Geoff, de Jeff, de Gabriel, de Tana s’entrelaçaient en un choeur éclairant le drame du Heysel sous plusieurs facettes, composant une sorte de mosaïque croisant les nationalités et les histoires de chacun. L’emboîtement de narrations, qui donne à Des hommes toute sa puissance et sa subtilité, est pareillement remarquable. Si la voix de Rabut domine au début et à la fin du texte, la narration omnisciente de la Nuit fait apparaître une multitude de personnages qui se relaient dans la prise de parole : Châtel, qui ne supporte pas les exactions auxquelles il est forcé de participer, Nivelle, qui n’hésite pas à tirer une balle dans la tête d’un jeune garçon lors de la fouille d’un village, Abdelmalik et Idir, les deux harkis déchirés, Bernard, bien sûr, qui a rencontré la fille d’un riche colon, Mireille, et rêve d’un avenir avec elle, et d’autres, encore, qui sont amenés à parler tout haut ou tout bas, ajoutant chacun sa pierre au tombeau terrible et sublime dressé par Laurent Mauvignier aux nondits de la guerre d’Algérie.
Car c’est bien le silencequi est au cœur de l’histoire que nous conte l’auteur. Silence des autorités pour commencer. Silence de ceux qui, tel Rabut, n’ont eu de cesse, une fois revenus chez eux, d’effacer ce qu’ils avaient vécu, de se taire, de montrer les photos, oui, du soleil, beaux paysages, la mer, les habits folkloriques et des paysages de vacances pour garder un coin de soleil dans la tête, mais la guerre, non, pas de guerre, il n’y a pas eu de guerre . Silence de ceux qui, tel Bernard, ne se remettront jamais des événements , au point d’oublier qui ils étaient pour renaître en perdants amers, désespérés, murés dans l’impossibilité d’exprimer leur douleur. Silence de ceux qui sont morts là-bas, aussi, et puis de ceux qui vous accueillent à votre retour, qui ne savent pas trop comment s’adresser à vous et ne s’attardent pas. Silence enfin entre Rabut et Bernard, plus intime cette fois-ci, les non-dits collectifs se confondant dans Des hommes avec les secrets familiaux, l’incommunicabilité s’étageant sur plusieurs niveaux, comme une chape implacable isolant chacun des personnages et le condamnant à poursuivre son existence en fantôme de celui qu’il fut.
Laurent Mauvignier sait donner corps à l’absence, au blanc, comme à ce qui se tient tapi dans l’ombre, ce fatum menaçant, pareil à ces rebelles introuvables village après village, et ne laissant d’autre trace que l’image d’un cadavre sauvagement torturé avec cette inscription : Soldats français, vos familles pensent à vous, retournez chez vous. Mais il sait tout autant nous plonger au cœur des choses, nous faire partager le quotidien d’une troupe, le vacarme des appels crachés des haut-parleurs, les ricanements, jérémiades, engueulades, et ces affreux lits superposés où grouillent des punaises, des puces, des morpions aussi […] , et nous donner à voir une horreur vécue, tout au long de saynètes incarnant très concrètement les inextricables nœuds d’un combat où tous sont à la fois victimes et bourreaux, innocents et coupables, pris dans un engrenage que rien ne peut arrêter, jusqu’à l’acmé que nous ne dévoilerons pas et qui plane sur l’ensemble du roman comme un point d’orgue, un trou noir où est né Feu-de-Bois et où est mort Bernard. L’auteur de Dans la foule aime à suivre chacune des ramifications d’un traumatisme, qu’il soit amoureux ou familial, intime ou collectif. Ses conséquences immédiates, parfois spectaculaires, et puis les autres, qui couvent sous la cendre, pareilles à des braises qu’un simple coup de vent peut transformer en incendie. Auscultant chacune des émotions et des contradictions de ses personnages, Laurent Mauvignier se glisse dans leur cœur et leur esprit en sismologue des âmes blessées, suivant l’onde de choc de ce qui les a meurtries non tant pour leur apporter un impossible apaisement que pour mettre au jour le fil à même de nous guider dans le labyrinthe de leurs pensées, de leurs souffrances, de leurs regrets – en un mot, de leur humanité.
Norbert Czarny, La Quinzaine littéraire, 1er au 15 septembre 2009
Écrire la guerre
On le surnomme Feu-de-Bois, il se prénomme Bernard. Avant d'être cet homme aux ongles sales, qui sent mauvais et qu'on préfère tenir éloigné, il a été un époux, un père de famille qui travaillait à l’usine, à Boulogne. Quarante ans ont passé et quand il vient offrir un cadeau coûteux à sa sœur Solange, tout le monde s’interroge sur la provenance de l’argent.
Le passé, la famille, l’argent : un lien étroit unit ces trois constituants de l’univers de Mauvignier, depuis Loin d’eux, son premier roman. Ici, le passé, on l’apprendra assez vite, c’est la guerre d’Algérie. Bernard l’a faite, dans l’Oranais, avec son cousin Rabut qui fait office de narrateur à diverses reprises dans le roman, et Février, un compagnon qui vivait dans le Limousin et espérait mener une longue existence auprès d’Eliane.
La famille est donc réunie auprès de Solange qui fête son départ à la retraite, mais nul n’attendait Bernard qui vit aux crochets des siens depuis qu’il est séparé de Mireille, son épouse restée en région parisienne. On est plus qu’embarrassé par sa présence, et on l’est d’autant plus lorsqu’il sort de sa poche un cadeau pour Solange. La broche a coûté cher et on soupçonne le miséreux d’avoir volé sa mère partie en maison de retraite, pour acheter cet objet. Et puis un incident se produit, une altercation avec Chefraoui, suivie d’une intrusion violente chez ce villageois plutôt bien intégré malgré ses origines arabes. Le maire et les gendarmes sont obligés d’intervenir. En moins de vingt-quatre heures, la durée du roman, le tourment de la guerre s’est réveillé dans ce lieu paisible.
Découpé en quatre temps, à partir de l’après-midi jusqu’au lendemain matin, Des hommes est construit comme une spirale. Tout commence dans ce village de La Bassée, semblable à beaucoup d’autres, sans identité particulière, avec son bistrot et sa salle des fêtes, son paysage hivernal sans contours précis. La présence de Feu-de-Bois, puisque c’est ainsi qu’il apparaît tout au long de la première partie suscite le malaise. L’odeur qu’il dégage, sa saleté repoussante, tout dérange. L’agression sur Chefraoui qui constitue l’essentiel de la partie intitulée Soir annonce la plongée brutale qui suit, dans la partie Nuit . Un narrateur externe et Février, ancien combattant insomniaque se partagent le récit de ce séjour dans l’Oranais. Dès le début, la violence est extrême : les soldats français investissent en hurlant un village peuplé de vieillards, de femmes et d’enfants. On cherche les hommes. Et pendant tout ce temps de la guerre, ces hommes sont invisibles. Les crimes, eux, sont bien visibles, et terrifiants : un médecin français dépecé vif, une fillette algérienne massacrée, des torturés, des soldats égorgés… C’est une litanie, un défilé d’horreurs, une sorte de cauchemar perpétuel. Les seuls moments heureux sont ceux pendant lesquels on contemple les photos, les femmes sont des souvenirs cachés dans des portefeuilles lit-on. Ce sont aussi les virées dans Oran, quand les permissions sont trop courtes pour se rendre en métropole. Mais ces moments sont brefs, et souvent inquiets. Dans le dernier temps du roman, Rabut se rappelle les derniers jours de la guerre, la joie des Algériens après les accords d’Évian, la fuite des pieds-noirs, l’abandon des harkis dans le port d’Oran et sur le tarmac de l’aéroport. Ils sont promis au pire, et on le sait. Le rythme s’accélère soudain, les événements se précipitent, comme si on n’avait qu’une hâte, en finir.
On a si souvent reproché au roman français son narcissisme, son peu d’ambition, qu’il faut saluer pour commencer le défi de Mauvignier. Il écrit la guerre d’Algérie. Bien que fondé sur des faits historiques, et sans doute sur des témoignages, Des hommes est avant tout l’œuvre d’un romancier que l’on reconnaît depuis son premier roman, et qui va de plus en plus loin dans le désir de lier l’histoire des individus et celle qu’ils font, qu’ils le veuillent ou pas. Ce titre, Des hommes, peut ainsi se lire de double façon : comme une affirmation, on voit des humains se débattre, essayer de survivre à l’abjection et au crime et comme une interrogation : que reste-t-il de l’homme, de l’humanité dans cette Algérie en guerre ? Mauvignier pose la question du Mal, comme le fait Haenel dans Jan Karski. Et tous deux appartiennent à la même génération qui a entendu parler de, mais n’a pas vécu les faits. Dans les deux cas, il n’y a pas de réponse, ou plutôt si : le Mal l’a emporté, partout, chez tous. Et le silence qui a tenté d’étouffer les témoignages est assourdissant.
Mais ce serait réduire le roman de Mauvignier que de taire le travail du romancier. Lequel est d’abord la maîtrise du temps et de la durée. On n’entre pas d’emblée dans l’œil du cyclone. On tourne avec Feu-de-Bois, dans son village, parmi les siens. Une allusion aux réunions d’anciens combattants d’Algérie, dont Rabut est le représentant au conseil municipal, une question ressassée sur la présence d’un Arabe dans le village suffisent à créer un climat.
Et puis la langue, entre oral et écrit de Mauvignier, entre monologue et discours indirect libre, rend la pensée ou le propos en action. La phrase est faite de répétitions, de et qui semblent lier ce qui est dit à ce qui est tu, son jeu sur le rythme et les sonorités donnent une épaisseur aux deux premières parties, créent une tension qui n’ira que s’amplifiant. L’emploi du futur lance le lecteur vers un horizon qu’il devine, celui de la mort, d’une fatalité à l’œuvre qui détruira tout.
La guerre, vue du côté des insurgés algériens est affaire de patience autant que d’invisibilité. L’ennemi reste caché et il attend. Comme le lecteur qui découvre avec les soldats, le corps du médecin supplicié et ceux des compagnons tués dans le poste. Si le terme n’avait pas ici quelque chose d’indécent, on parlerait de suspens. Disons simplement que le narrateur rend la peur, l’horreur des jeunes appelés de façon progressive, taisant le pire que l’on devine devant leurs yeux. On ne saurait regarder la Méduse en face.
Le temps est fait de silences et le souvenir est une déflagration qui traverse les années. Toute cette guerre et l’histoire d’une humiliation. Mauvignier montre ces soldats mal nourris, mal logés, trimballés ici et là. Les temps morts sont remplis par des tâches sans intérêt, des jeux stériles. L’énervement provoque des bagarres, comme celle, fatale pour la suite des événements entre Bernard et son cousin Rabut. Et puis soudain, on part en opération et la peur revient. Les jeunes hommes qui rentrent d’Algérie ne sont plus capables de parler, de faire des phrases complètes, de bâtir un discours cohérent. Ils ne peuvent dire tout ce qu’ils ont vu, ce à quoi ils ont participé. Les gestes violents, les impulsions soudaines remplacent les mots. On le lit ici comme on le lisait dans un très beau chapitre de La Tache, de Philip Roth, lorsque des anciens combattants du Viet-Nam se trouvaient réunis pour un repas, et que les serveurs asiatiques les terrorisaient sans bien comprendre pourquoi. Chefraoui fait peur à Feu-de-Bois, réveille le souvenir d’Abdelmalik, harki ayant trahi ses compagnons français dans le poste de garde. Les liens entre passé et présent sont puissants, mais souvent aussi invisibles que l’ennemi qu’il fallait combattre.
On n’en finirait pas de tisser des liens, de relever les échos qui font de ce roman une œuvre forte, impressionnante. La guerre est-elle la cause ou la conséquence des vies perdues, des couples défaits, des pères rejetant leur fille et des sœurs méprisées par leurs frères ? Combien de rêves détruits, d’illusions enfouies ont commencé à Oran ? Je voudrais savoir si l’on peut commencer à vivre quand on sait que c’est trop tard se demande Rabut à la toute fin du roman. Nous connaissons, hélas, la réponse.
Rencontre
Du même auteur
- Loin d'eux, 1999
- Apprendre à finir, 2000
- Ceux d'à côté, 2002
- Seuls, 2004
- Le Lien, 2005
- Dans la foule, 2006
- Des hommes, 2009
- Ce que j'appelle oubli, 2011
- Tout mon amour, 2012
- Autour du monde, 2014
- Retour à Berratham, 2015
- Continuer, 2016
- Une légère blessure, 2016
- Histoires de la nuit, 2020
- Proches, 2023
- La Maison vide, 2025
Poche « Double »
- Loin d'eux, 2002
- Apprendre à finir, 2004
- Dans la foule , 2009
- Des hommes , 2011
- Autour du monde, 2016
- Continuer, 2018
- Voyage à New Delhi, 2018
- Histoires de la nuit, 2022
- Quelque chose d'absent qui me tourmente, 2025
Livres numériques
- Apprendre à finir
- Ce que j'appelle oubli
- Ceux d'à côté
- Dans la foule
- Des hommes
- Le Lien
- Loin d'eux
- Seuls
- Tout mon amour
- Autour du monde
- Retour à Berratham
- Autour du monde
- Une légère blessure
- Continuer
- Histoires de la nuit
- Proches
- La Maison vide
- Quelque chose d'absent qui me tourmente
