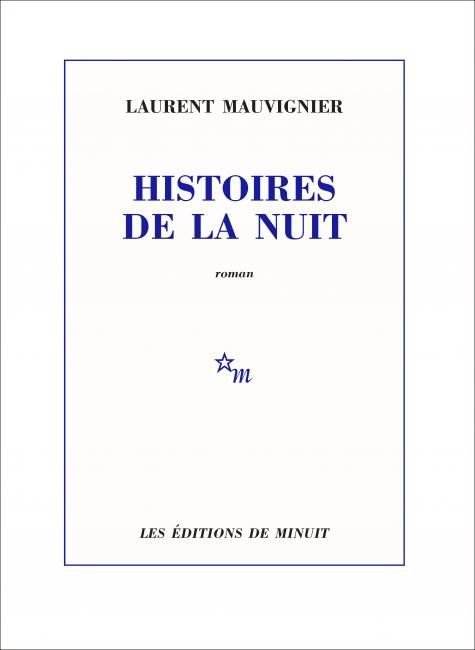
Laurent Mauvignier
Histoires de la nuit
2020
640 pages
ISBN : 9782707346315
24.00 €
60 exemplaires sur Vergé des papeteries de Vizille
Il ne reste presque plus rien à La Bassée : un bourg et quelques hameaux, dont celui qu’occupent Bergogne, sa femme Marion et leur fille Ida, ainsi qu’une voisine, Christine, une artiste installée ici depuis des années.
On s’active, on se prépare pour l’anniversaire de Marion, dont on va fêter les quarante ans. Mais alors que la fête se profile, des inconnus rôdent autour du hameau.
ISBN
PDF : 9782707347282
ePub : 9782707347275
Prix : 9.99 €
En savoir plus
Anna Cabana, JDD, dimanche 16 août 2020
Retiens la nuit
TERREUR Laurent Mauvignier signe un roman magistral où la tension vous entête jusqu’à la dernière ligne
Certes, il ne sort que le 3 septembre, il faudrait probablement attendre pour le chroniquer, être raisonnable, mais c’est précisément ce qui est impossible après la lecture de ce roman que ne peut pas l’être moins, ce texte effroyablement déraisonnable, donc, parce que l’effroi y est poussé jusqu’à la déraison, et que c’est magistral. Aussi ne saurait-on commencer autrement ces carnets de rentrée.
C’est l’histoire d’une séquestration par trois frères des habitants d’un hameau au nom glaçant et prédestiné : L’Écart des Trois Filles Seules. Trois filles seules qui ne pourraient mieux mériter leur nom : la voisine, Christine, est une peintre un tantinet fêlée qui met sur son désespoir et celui des autres « des formes brouillonnes et bouillonnantes » ; la femme, Marion, est une « bouffée d’étrangeté et de fantasmes, de rêves et de renouveau dans leur vie à tous » - sauf dans celle de Christine, qui ne l’aime guère mais la supporte parce qu’elle est l’épouse de son voisin et ami, Patrice, que chacun appelle par son patronyme de fermier : Bergogne ; l’enfant se prénomme Ida, il s’agit de la fille de Marion – que tout le monde adore, y compris Christine. Le drame les surveille dès le premier chapitre. Le précipité comme la cristallisation, au sens chimique, s’opèrent le jour de l’anniversaire des 40 ans de Marion.
Laurent Mauvignier prend le temps. Littéralement. Il s’en saisit et le malaxe, dans un sens, dans l’autre, encore et encore. Il le met à sa main : il décompose chaque mouvement du corps, de l’esprit, de l’âme, du pneu de la voiture. La narration est « prise dans le coton engluant et moelleux du ralenti » - l’expression est de Mauvignier, à propos de tout autre chose. Dès lors qu’il s’agit de ralenti, cet écrivain est un virtuose. Un extrémiste, aussi. Le ralenti cinématographique est comme dépassé par ce que l’on a envie d’appeler, tant il est singulier, le « ralenti Mauvignier ». Celui-là n’est pas en trois dimensions mais en mille et une. La terreur est suspendue, étirée, dilatée, disséquée ; la tension vous entête jusqu’à la dernière ligne.
Le romancier campe la scène – que d’emblée on pressent scène du crime –, le décor physique, psychique, sensoriel : les désarrois, les désamours, les dégoûts, le crissement des pas sur le chemin, le bois de l’escalier qui craque, le bruit du silence qui précède la mort, celui des pensées, et elles s’entrechoquent, se meurtrissent – il restitue les sons émis par chacune d’elles, et cela donne une musique qui nous emporte vers le pire de l’être humain, le meilleur de la littérature.
Il est capable d’expédier d’un verbe un moment crucial et de couvrir cent pages de phrases infiniment spiralaires pour décrire dans ses profondeurs et ses méandres une action de quelques instants. Sans parler du chapitre qui précède où il relate l’anticipation par l’un des personnages dudit évènement. La relation de la réunion montée par le chef de projet de l’imprimerie où travaille Marion pour tenter de faire le procès de celle-ci et de ses deux collègues est un monument : on a droit à la scène telle que Marion imagine qu’elle va se dérouler, puis à la scène telle que Marion l’a vécue, tandis qu’elle refait le film en roulant vers chez elle. Mais pas à une narration au présent de l’indicatif.
Ce n’est pas parce que Laurent Mauvignier joue avec le temps comme d’un accordéon que l’on peut entrer dans son livre comme on va au bal musette. La magie Mauvignier ne se donne qu’au lecteur qui, au moins pendant les premiers chapitres, s’accroche aux reliefs de sa peinture noire et luminescente – il aime ce dernier terme. Les passages consacrés à l’art, et ils sont nombreux et très aboutis, sont autant de métaphores de l’existence. À l’instar du monologue intérieur de Christine, tandis qu’elle regarde le jeune homme l’ayant prise en otage dévorer des ris de veau aux morilles : « Sa voisine avait essayé de bâtir une vie dans laquelle elle pouvait s’arracher à une forme de mort, non par dissimulation donc, mais par recouvrement, saturation, ce que Christine fait tous les jours dans son travail, oui, on peut recouvrir sa vie pour la faire apparaître, superposer des couches de réalités, de vies différentes pour qu’à la fin une seule soit visible, nourrie des précédentes et les excédant toutes ; elle n’avait jamais pu imaginer que ce soit vrai ailleurs qu’en peinture, elle qui l’avait fait sur chaque toile qu’elle avait peinte. » En fait Laurent Mauvignier, qui ne s’est attaqué aux lettres qu’après avoir été diplômé en arts plastiques, est resté un artiste. Il écrit comme on peint quand on a la folle ambition, à force de tourner autour de la vérité, lentement, très lentement, de l’encercler jusqu’à lui faire rendre grâce. Il résiste aux tendances moralisatrices de l’époque ; sur 640 pages, il est peu de bons sentiments, beaucoup de mauvais, et c’est aussi cela qui est bien.
Mâchoires serrées par le suspense, on ne veut pas que ça finisse, surtout pas, et néanmoins on brûle d’avoir le fin mot de l’histoire, ou plutôt de ces « histoires de la nuit » qui ont donné son titre au roman. Ces histoires du « grand livre à la couverture jaune aux lettres bosselées et dorées » qui « compile des contes venus du monde entier » et que Marion lit chaque soir à sa petite Ida. Toutes, précise Laurent Mauvignier, ne sont pas pour les enfants de son âge ; Ida prétend que les plus angoissantes sont celles qu’elle préfère « alors qu’en réalité ces histoires s’immiscent secrètement dans ses rêves, qu’elles colorent ses nuits d’images et de sensations qui font que parfois, le matin, Ida se réveille tremblante ». C’est exactement ce que provoque l’ouvrage de Laurent Mauvignier. Et le tremblement perdure bien au-delà du réveil.
Sylvie Tanette, Les Inrockuptibles, 19 août 2020

Martine Landrot, Télérama, 26 août 2020
Une enfance dans un monde sans livres, un détour par la peinture, et finalement l’écriture l’emporte… Avec ses romans torrentiels, où fiction et réel se télescopent, l’écrivain Laurent Mauvignier sonde les zones d’ombre de nos vies. Comme dans “Histoires de la nuit”, qui sort aux Éditions de Minuit.
Fidèle aux Éditions de Minuit, « parce qu’un écrivain n’a jamais qu’un seul éditeur, celui qui l’a découvert », Laurent Mauvignier creuse son sillon, sa crevasse, sa faille sismique, depuis vingt ans. Chacun de ses livres procure le même choc. Choc de la magnificence d’une langue en lame de fond, qui sectionne ses phrases en milieu de ligne, puis les laisse déferler sur des pages. Choc de la puissance de personnages dépecés par leurs traumas, entraînés dans la précipitation d’événements qui les dépassent : le drame du stade du Heysel (Dans la foule, 2006), la guerre d’Algérie (Des hommes, 2009), la folie meurtrière des vigiles d’un supermarché contre un voleur de bière (Ce que j’appelle oubli, 2011), le 11 septembre 2001 (Autour du monde, 2014), la dérive d’un adolescent sauvé par unvoyage initiatique auKirghizistan avec sa mère (Continuer, 2016). Huis clos dans un hameau pris d’assaut par des rôdeurs qui revisitent leur passé, Histoires de la nuit, son dernier roman, est un thriller sur les faux-semblants qui maquillent chaque existence.
Originaire de Touraine, où il est né en 1967, Laurent Mauvignier a grandi à la campagne, dans un monde sans livres, où, « de toute façon, un garçon, ça ne lisait pas ». Il vit aujourd’hui à Toulouse avec une libraire et se passionne pour des écrivains comme António Lobo Antunes ou László Krasznahorkai. Enfant silencieux, il est devenu bavard, deux versants d’une personnalité indéfectiblement attachée aux mots.
Si le verbe « mauvignier » existait, quel sens lui donneriez-vous ?
Ce serait sans doute un verbe proche de courir. Courir vers un point impossible à atteindre.
N’est-ce pas la clé de votre écriture, faite de longues phrases qui courent à perdre haleine ?
Je suis admiratif des écrivains qui s’en tiennent à des phrases courtes. On pense souvent que c’est un signe de modestie de leur part, mais il faut être sûr de soi pour tout condenser en quelques mots. Quand j’écris, je doute, je suis en état de vigilance permanente, voire de défiance face à moi-même. Il y a toujours une petite voix qui me chuchote que je prends une fausse piste.Alors j’étire le texte, je fais des pas de côté, je rebrousse chemin, j’élague, je déploie à nouveau, j’essaie de préciser, de décaler, tout en fuyant le mot juste à tout prix. Pour moi, le mot juste écrase tout. Comme une lumière trop forte braquée sur les yeux, qui efface le visage tout autour. J’ai toujours peur du moment où je dois mettre un point à la fin d’une phrase. Je suis pris d’une angoisse physique, je sens le vide sous mes pieds. Du coup, je reprends une bouffée d’air en prolongeant le mouvement, en réanimant la phrase pour ne pas la laisser mourir.
Votre écriture est porteuse d’une grande violence…
À mes débuts, j’avais un vif besoin d’expulser cette violence à travers la langue. Avec le temps, je suis passé à une narration beaucoup plus traditionnelle, pour ne pas devenir la caricature de moi-même et ne pas écrire des monologues jusqu’à la fin de mes jours. Mais je sais que la violence est toujours en embuscade. La question de la violence cache celle de la peur. Elle est au cœur de ma vie. Le jour où je pourrai y répondre, j’arrêterai d’écrire.
Pour la première fois, vous accordez une place centrale à un enfant. Comment avez-vous travaillé sur ce personnage de petite fille ?
Je me souviens très bien de ma propre enfance, de la perception aiguë que j’avais des adultes, et du nombre de fois où je me suis supplié, comme si je me lançais à moi-même une bouteille à la mer, de ne pas oublier quand je serais devenu grand. Souvent les enfants s’inventent un compagnon imaginaire, moi je parlais à l’adulte que je serais. Je lui disais : « Ne m’abandonne jamais, rappelle-toi tout. » J’avais une obsession des détails que je voulais graver dans ma mémoire. D’où des souvenirs physiques précis, des flashs visuels, des sensations de chaud, de froid, de matières. J’étais un enfant sage, mais intérieurement très en colère. Une colère qui ne s’exprimait pas. J’ai compris pourquoi j’écrivais Histoires de la nuit en arrivant au dernier paragraphe, centré sur le personnage de la petite fille. Je me suis dit : nous y voilà ! Je vois précisément de quels traumas de ma propre enfance cela vient.
Vous n’avez jamais été tenté par l’autofiction ?
Pour moi, c’est une impossibilité indépassable, notamment parce que l’autofiction peut engager les proches dans un bateau sur lequel ils n’ont pas demandé à monter. Cela fait vingt ans que j’écris des livres, donc je commence à savoir pourquoi, mais il y a en moi des choses qui me paraissent encore trop monstrueuses pour que je les regarde en face. La fiction me permet d’avancer pas à pas, timidement, dans mon autobiographie. Je crois que les livres sont voués à surseoir, à tourner autour du pot. Si un modeste petit roman permet de passer une marche, c’est déjà bien. Chaque écrivain fait ce qu’il peut, sans qu’une solution soit meilleure que l’autre. Je vois bien le moteur de l’autofiction, j’ai du plaisir à en lire. J’aime beaucoup Annie Ernaux, par exemple. Je suis sensible aux questions qu’elle se pose, j’admire le fait qu’elle n’ait pas peur de dire « Yvetot », sa ville d’enfance. Moi je ne peux pas. Si je nommais dans mes romans l’endroit de Touraine où j’ai grandi, j’aurais l’impression de le trahir, de le réduire à la façon dont moi je l’ai vécu, alors que d’autres l’ont vécu autrement.
Vous avez donc inventé le lieu-dit La Bassée, où se passent beaucoup de vos livres…
J’ai choisi ce nom parce que, dans La Bassée, on entend « c’est là-bas », et puis un peu « l’ABC ». J’ai aussi pensé au chien, le basset, pour son côté « ras des pâquerettes », pour l’idée d’horizontalité. C’est un lieu que j’ai eu besoin d’imaginer pour mes premiers livres, et, peu à peu, La Bassée est devenu un point d’ancrage à partir duquel je peux créer de l’espace. Maintenant, je n’en ai plus vraiment besoin pour écrire, c’est comme une maison que j’ai quittée, qui existe encore, où je peux retourner en pensée de temps en temps. J’ai découvert par la suite que cinq endroits s’appellent vraiment La Bassée en France !
Vos romans s’inscrivent dans une réalité sociale forte et sont parfois prémonitoires. Comment orchestrez-vous ce télescopage entre la fiction et le réel ?
Ce télescopage se produit dans la vie de tous les jours. Je suis frappé de voir combien le réel ressemble de plus en plus à une fiction. Je pense que cela a commencé avec le 11 septembre 2001, et le Covid a porté cette impression à son paroxysme. On entend fréquemment les gens s’exclamer : « On se croirait dans un film ! On dirait une dystopie pour adolescents ! » Aujourd’hui, on ne fait pas naître la fiction à partir du réel, mais le réel à partir de la fiction. Quelque chose s’est inversé. Pendant le confinement, je suis sorti seul dans le centre de Toulouse et je me suis retrouvé face à un groupe de SDF qui erraient dans la ville déserte. En les voyant se précipiter vers moi d’une façon presque agressive, j’ai immédiatement pensé aux Pièces de guerre du dramaturge anglais contemporain Edward Bond. De plus en plus souvent, on est appelé à vivre des situations que la fiction nous a déjà montrées de manière très codifiée, en particulier dans des scènes de violence au cinéma. Mais, en même temps, la réalité ajoute un vertige supplémentaire de l’ordre de l’impensable. Il y a là un frottement qui nous laisse complètement démunis.
Histoires de la nuit est le plus épais de vos livres. Pourquoi ce choix ?
Paradoxalement, à l’origine, ce roman était un scénario de vingt-cinq pages. J’avais déjà tourné un court métrage, l’expérience m’avait plu. J’ai donc voulu m’essayer au moyen métrage, à partir d’une histoire typiquement cinématographique de prise d’otage, avec l’idée de travailler sur la circulation des corps dans un espace clos. J’avais passé beaucoup de temps dessus et, soudain, j’ai eu envie de faire un antiscénario, d’introduire de la littérature dans chaque interstice, d’étirer chaque chose au maximum, pour raconter tout ce qu’un film passe sous silence entre deux scènes. Un roman peut se déployer à l’infini. On ouvre une porte, qui débouche sur une multitude d’autres portes. C’est une sensation vertigineuse. La littérature est un art souverain dans le monde d’aujourd’hui, où tout s’emballe, parce qu’elle requiert de prendre le temps de prendre du temps. J’aime beaucoup les gros livres à cause de leur lenteur salutaire. Quelle expérience fusionnelle exceptionnelle ! Il y a quelques années, j’avais vu une étude très intéressante, canadienne je crois, sur les différences de comportement entre les gens qui lisent et ceux qui ne lisent pas. Le résultat montre que les lecteurs de romans ont une bien plus forte capacité que les autres à faire face aux coups durs de la vie. Après tout, pourquoi éprouvons-nous du plaisir à lire des histoires qui ne nous concernent pas ? C’est quand même étrange ! En fait, la lecture a une fonction de survie, comme le rêve. Elle nous prépare à reconnaître les choses quand elles nous arriveront. J’aime bien cette idée.
Cela vous donne une grande responsabilité en tant qu’auteur… Comment la vivez-vous ?
Je me vois comme un écrivain engagé, mais surtout pas militant. C’est épidermique, je n’ai jamais pu supporter d’afficher quoi que ce soit. Je n’ai jamais eu l’âme d’un porte-drapeau. Cela touche à quelque chose de très intime chez moi. Pendant l’enfance, j’ai été longuement hospitalisé. Un jour, mes parents sont venus me voir à l’hôpital, qui était à 70 kilomètres de chez eux. Ma mère ne conduisait pas. Mon père était ouvrier, il avait dû prendre son après-midi, ce qui n’était pas rien, parce que cela impliquait qu’il ne serait pas payé. J’ai une image précise des médecins leur expliquant, à quelques mètres de moi, ce que j’avais. Dans mon souvenir, il se passe à ce moment-là quelque chose de très désagréable, qui n’est pas lié au diagnostic annoncé, mais à un rapport de domination entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Cela m’avait rendu triste de voir mes deux parents ainsi infantilisés, rabaissés, par une certaine utilisation du langage qui était du côté du pouvoir. Je pense que la littérature doit toujours être du côté du contre-pouvoir. Je n’ai pas envie que les mots soient des instruments de combat, j’ai trop détesté les gens qui utilisaient le langage pour asservir les autres. La seule tribune que je pourrais écrire, à la rigueur, serait contre une expression qu’on entend souvent aux informations : « la foule des anonymes ». Ce sont des inconnus, pas des anonymes ! C’est grave d’insinuer que seuls les gens connus ont droit à un nom. Écrire, c’est travailler à détruire ce langage de pouvoir et de mépris de classe.
Vos romans s’ouvrent de plus en plus à des personnages de femmes. Quel regard portez-vous sur la montée actuelle du féminisme ?
Le féminisme libère l’homme de l’obligation d’être un gros con, voilà le fond de ma pensée. Dans mon enfance, vécue à la campagne dans les années 1970, devenir un homme était une perspective à laquelle je n’arrivais pas à m’identifier. Il y avait des conditions à remplir, exténuantes et ridicules. Le mépris de l’intello, l’exaltation des travaux manuels, le goût d’une virilité dominatrice, le culte d’une masculinité triomphante… Qui pouvait s’y reconnaître ? À part ceux qui étaient heureux d’aller servir sous les drapeaux, de fonder une famille sur le mode patriarcal, et qui n’imaginaient même pas qu’on puisse rêver d’autre chose pour soi ou pour les siens, notamment pour les femmes ? En tant qu’écrivain, ces dernières années, j’ai pu toutefois vivre des moments qui m’inquiètent. Des étudiants en fac d’histoire m’ont reproché à mots couverts d’avoir écarté les femmes de mon roman Des hommes, sur la guerre d’Algérie. Des jeunes femmes ont un jour interpellé une comédienne qui jouait un monologue que j’avais écrit, Une légère blessure, en trouvant scandaleux qu’un homme s’arroge le droit de parler au nom des femmes. Il ne s’agit pas d’écrire à la place de qui que ce soit, mais d’essayer de se projeter dans une figure autre. Tout ce qui compte pour moi, c’est la capacité de l’auteur et du lecteur à s’intéresser à la commune humanité. Personne n’est jamais réductible à une parole, à une action, à un slogan, à une définition. Comment traduire la somme des réalités qui constituent les êtres ? Comment rendre compte de l’opacité de la vie ? Voilà ce qui m’intéresse.
La peinture occupe une grande place dans votre dernier roman. Quel rôle joue-t-elle dans votre vie, depuis vos études aux Beaux-Arts ?
Je suis un peintre raté. Je vis cela comme un échec. À l’origine, je me suis servi de la peinture pour renoncer à l’écriture. Jeune adolescent, à la mort de mon père, j’ai tenté d’écrire autour de ce deuil et j’ai eu tellement honte de faire une chose pareille que je n’ai plus touché un stylo pendant plusieurs années. La peinture est venue pallier cela. Je suis arrivé aux Beaux-Arts de Tours à 17 ans, parce que je n’avais pas le bac et qu’on pouvait y entrer sans. Cela m’a sauvé la vie de découvrir d’autres gens, de m’ouvrir à un espace mental différent. C’étaient les années 1980, la peinture s’envisageait sur un mode assez ironique, l’art était beaucoup plus conceptuel qu’aujourd’hui. Pas du tout mon univers ! Alors j’ai recommencé à écrire petit à petit, des textes un peu expérimentaux. J’étais très influencé par Antonin Artaud, qui incarnait pour moi cette possibilité d’effondrement intérieur qui nous guette tous. La peinture me fascine pour sa proximité avec la folie. Une couleur n’est pas là pour dire quelque chose, elle est là parce qu’elle est là. J’aime la superposition des couches, la succession des trames, ce qu’on appelle si joliment les « repentirs ». J’essaie de restituer cette matérialité en littérature, de garder un geste d’écriture qui ne soit pas lisse, qui porte la trace de mes hésitations et de mes choix. Mais je n’ai pas dit mon dernier mot. Je garde l’impression que quelque chose ne s’est pas accompli et qu’il me faudra revenir à la peinture. Je m’imagine très bien, vieux, tout arrêter pour ne faire que peindre.
Christophe Kantcheff, Politis, 3 septembre 2020
Terreur nocturne
Dans une langue ample et puissante, Laurent Mauvignier met en scène un thriller singulier, fort en suspense et en humanité.
Les Histoires de la nuit dans le nouveau roman de Laurent Mauvignier, est le titre d’un album, appartenant à la petite Ida, qui rassemble des contes pour enfants censés faire peur. Mais celui que lui lit sa mère, Marion, ce soir-là, où il est question d’un chien fidèle à son maître au-delà du meurtre de celui-ci, ne l’effraie pas. Ida est émue par l’animal.
Nul hasard, bien sûr, dans le fait que ce soit aussi le titre du roman (sans l’article défini). Avec Histoires de la nuit, Laurent Mauvignier s’illustre dans un genre nouveau pour lui : le thriller. D’un type particulier, est-il besoin de le préciser, de la part d’un écrivain qui aime à transgresser les archétypes, à l’image de son roman précédent, Continuer, où le récit d’aventure croisait l’intime et le politique.
Histoires de la nuit a lui aussi la double qualité de donner potentiellement des frissons ainsi que de toucher le lecteur quand il ne s’y attend pas. La situation est simple : dans un hameau perdu en pleine campagne, au lieu-dit L’Écart des Trois Filles Seules, où vivent Ida, Marion et son mari, Patrice, ainsi que, dans la maison voisine, Christine, une artiste peintre vieillissante, trois hommes – trois frères – surgissent avec des intentions mauvaises.
Sur l’intrigue, il faudrait pouvoir en dire le moins possible. Parce que le suspense qui la fond procure un plaisir incontestable – et constitue une raison évidente à ce que les 630 pages du volume défilent sous nos yeux à vitesse grand V. On sent chez Laurent Mauvignier le goût du feuilleton qui tient le lecteur en haleine, chaque fin de chapitre suggérant une action à venir grave ou déterminante, tandis que le récit se déroule alternativement dans l’une ou l’autre maison, ce qui multiplie par deux l’attente de ce qui va suivre.
Particularité notable de cette narration à suspense : elle est singulièrement étirée. L’action du livre se déroule pourtant sur vingt-quatre heures, et les moments les plus dramatiques sur quelques heures seulement. Le texte contient une allusion à cette forme distendue : « Alors ce qui se passe va très vite, et c’est comme si seulement un très long ralenti pouvait le rendre visible. » Histoires de la nuit a ainsi des allures de thriller- spaghetti (comme on parlait de western-spaghetti). Ici sans intention parodique. Au contraire, cet étirement du temps, qui passe par une écriture plus ample, plus fluviale encore qu’à l’accoutumée chez Mauvignier, rehausse la tension générale. Chaque phrase contient elle-même l’incertitude de son déploiement, de son devenir. Les plus intenses déroulent un monde qu’a priori on ne soupçonnait pas. Toutes sont chargées du poids de l’imprévisible destinée.
Il y a là un couple mal apparié : Patrice l’agriculteur, mari un peu rustre mais au grand cœur tenu à distance par Marion, sa femme, belle et de fort caractère, qui travaille dans une imprimerie, s’adonnant au karaoké tous les vendredis soir avec deux copines de boulot ; la petite Ida, qui a « l’âge de savoir » ; et Christine, coupée volontairement de toute vie sociale, n’existant que pour son art, éprouvant toutefois un sentiment presque maternel pour Patrice et une profonde tendresse envers l’enfant.
Le premier tiers du livre leur est consacré. Peu à peu, le lecteur fait plus intimement connaissance avec eux, qui prennent de l’épaisseur par le biais de monologues intérieurs. On apprend ainsi la méfiance qu’inspire Marion à Christine, dont le tableau en cours est une mystérieuse femme nue et rouge, dont « l’âge laissait apparaître plusieurs époques d’une seule vie dans une seule image ». On entend la frustration de Patrice, qui a toujours été pris de haut par quiconque, sauf par les animaux de la ferme. On subodore le passé trouble de Marion, qui vient « d’un monde où les mots travaillent à se faire aussi laids et triviaux que la réalité dans laquelle ils nagent ». Tous ont une même idée en tête : le prochain dîner doit être une fête, c’est l’anniversaire de Marion, qui a 40 ans !
Alors surgissent les trois frères maléfiques. D’autres que Laurent Mauvignier en auraient fait des monstres désincarnés, des tortionnaires à la Haneke (Funny Games), des abstractions plus que de vrais personnages. L’auteur au contraire leur insuffle une présence, et même une humanité. Il crédite Denis, le cerveau, plus âgé que les deux autres, Christophe, le pragmatique, et le dénommé le Bègue, le plus jeune, d’une biographie et d’une histoire familiale. Christophe et le Bègue sont sous l’emprise de leur aîné – l’emprise, une notion centrale dans Histoires de la nuit, dont Mauvignier éclaire toutes les facettes, même si le mot n’apparaît jamais –, le premier s’étant particulièrement occupé de son frère cadet, psychiquement fragile et rejeté par leurs parents. Au gré d’un subtil glissement, ils passent un temps sur le devant de la scène du roman. Le lecteur n’approuvera jamais ce à quoi ils se livrent, mais il peut en comprendre les ressorts, les motivations.
C’est l’apanage de la littérature, quand un écrivain ne se transforme pas en juge pour complaire à l’air du temps. D’autant que Laurent Mauvignier ne sous-estime pas la violence des situations qu’il met en scène. Une violence non démonstrative, mais sourde, affleurante et tentaculaire. Une violence qui puise sa source dans les ruines des enfances tourmentées, des mauvais départs dans l’existence. « Est-ce qu’elles ont une idée de ce que c’est, la terreur, quand l’idée de la peur la fait doucement rire, parce qu’avec la peur il y a toujours l’idée qu’on peut s’en sortir… » Histoires de la nuit n’est pas un conte pour enfants, mais on tremble à le lire en espérant que le jour revienne.
Lire sur Diacritik du 3 septembre 2020 l'article de Johan Faerber
Lire également sur Diacritik du 3 septembre 2020 l'article de Christian Rosset
Rencontre
Du même auteur
- Loin d'eux, 1999
- Apprendre à finir, 2000
- Ceux d'à côté, 2002
- Seuls, 2004
- Le Lien, 2005
- Dans la foule, 2006
- Des hommes, 2009
- Ce que j'appelle oubli, 2011
- Tout mon amour, 2012
- Autour du monde, 2014
- Retour à Berratham, 2015
- Continuer, 2016
- Une légère blessure, 2016
- Histoires de la nuit, 2020
- Proches, 2023
- La Maison vide, 2025
Poche « Double »
- Loin d'eux, 2002
- Apprendre à finir, 2004
- Dans la foule , 2009
- Des hommes , 2011
- Autour du monde, 2016
- Continuer, 2018
- Voyage à New Delhi, 2018
- Histoires de la nuit, 2022
- Quelque chose d'absent qui me tourmente, 2025
Livres numériques
- Apprendre à finir
- Ce que j'appelle oubli
- Ceux d'à côté
- Dans la foule
- Des hommes
- Le Lien
- Loin d'eux
- Seuls
- Tout mon amour
- Autour du monde
- Retour à Berratham
- Autour du monde
- Une légère blessure
- Continuer
- Histoires de la nuit
- Proches
- La Maison vide
- Quelque chose d'absent qui me tourmente
