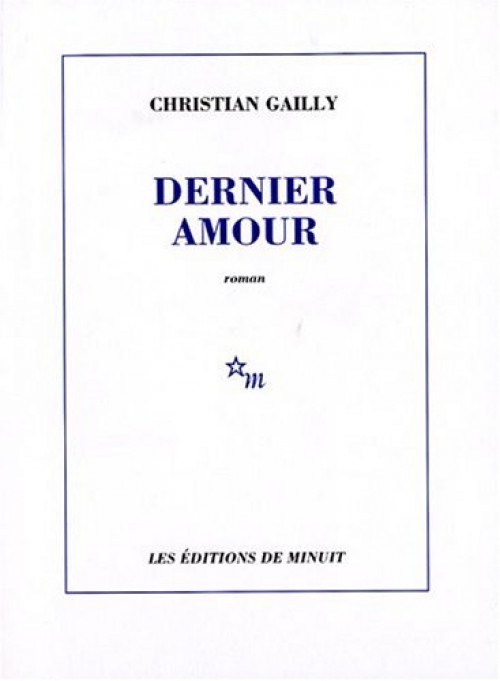
Christian Gailly
Dernier amour
2004
128 pages
ISBN : 9782707318855
12.15 €
67 exemplaires numérotés sur Vergé des papeteries de Vizille
Imaginez. Il ne vous reste que deux jours à vivre. Qu'est-ce qui est préférable ? Finir tranquille dans l'ennui qu'aura été toute votre vie ? Ou bien, si vous êtes musicien, comprendre enfin pourquoi votre musique vient d'être huée et, dès le lendemain, rencontrer celle qui devrait être votre dernier amour ?
Rencontre entre Christian Gailly et Christophe Grossi
(Librairie Les Sandales d'Empédocle, Besançon)
Chaque livre de Christian Gailly est une avancée supplémentaire dans sa tentative d'épuisement d'un visage familier. Cette fois, Dernier amour raconte l'histoire d'un compositeur de musique contemporaine, Paul Cédrat, qui n'a plus que quelques jours à vivre. Alors que tout semblait programmé, surgit une baigneuse et, avec elle, une possible renaissance – en musique.
En 1964, lors d'un festival de jazz amateur, vous avez vécu le même drame que votre personnage principal. Pourquoi avez-vous choisi de revenir sur cet épisode précis de votre vie ?
Dans Dernier amour, j'aborde à nouveau l'expérience musicale parce qu'il n'y a que là où j'ai pu retrouver suffisamment d'émotion pour me faire écrire ; d'autre part, parmi les rares questions qui peuvent me tarauder encore, celle de la musique est certainement la plus importante. J'ai donc transposé cette expérience musicale plus de vingt ans plus tard, en 1987, lors d'un festival de musique classique et contemporaine. Il se trouve que j'aime particulièrement les quatuors à cordes et que je me pose un certain nombre de questions sur la musique contemporaine : ce qu'elle devient et pourquoi elle devient ce qu'elle devient. J'ai donc fait de Paul un compositeur qui serait confronté, comme moi, à ce questionnement paradoxal : la musique contemporaine est-elle contemporaine de quelqu'un ? Parce qu'à l'exception d'un petit cercle d'initiés, on peut dire qu'elle n'est entendue par personne et qu'elle n'intéresse personne. Je m'amuse donc à m'interroger sur cette non-contemporanéité.
L'écriture de romans n'est-elle pas une forme de réponse à vos questionnements ?
Oui, sauf que je ne prends pas vraiment le risque de me faire sortir de la salle. J'essaye de me battre autant que possible avec la banalité de la formulation, de l'écriture même, de la construction des choses. Mais, malgré tous mes efforts et tout ce que parfois je peux dire, je reste dans quelque chose de lisible et d'assez classique. je crois que si je me mêlais de faire de la littérature expérimentale, je serais illisible.
Parce que c'est toujours l'émotion qui vous guide, qui est le moteur de votre écriture et de vos histoires.
Cela prouve en effet que je n'arrive pas à écrire ni à être complètement désespéré. Dans Dernier amour, Paul est prêt à mourir ; mais comme à chaque fois, quelque chose surgit : de l'émotion, de l'amour. Cela prouve que l'on ne fait pas ce qu'on veut et que l'on n'est pas ce qu'on veut. On reste exposé. Cela rend les choses quasiment insupportables et en même temps d'une beauté noire. En effet, ce quelque chose qui vous arrive va vous faire regretter une vie que, jusque-là, vous ne rêviez pas. Pour Paul, il est temps de mourir mais, au fond, il aurait envie de continuer. Quelque chose ou quelqu'un vous donne envie de continuer. Et c'est d'autant plus atroce quand il s'agit non pas d'une tentation suicidaire mais d'une maladie.
Paradoxalement, votre écriture, elle, va en se simplifiant. Comme s'il y avait, d'un côté, un homme toujours aussi torturé par les échéances et, de l'autre, un écrivain de plus en plus serein.
C’est vrai, l'écriture aspire à de plus en plus de simplicité et la phrase se donne un air serein. Parce que ça devient de plus en plus périlleux. L'obsession de la mort est telle qu'elle empoisonne toute pensée, toute perspective. Il s'agit donc de se tenir le mieux possible et au plus près des choses et de soi, dans un état de tension. Il n est plus question d'envolées lyriques, de laisser partir les phrases.
C'est d'ailleurs le rôle de l'ironie ça ?
Depuis deux ans, je n'arrivais plus à écrire ; l'ironie m'avait quittée. Je n’arrivais plus à être sincère. Jusqu'à ce que je m'aperçoive que la seule façon que j'avais de m'en tirer était d'accepter cette obsession de la mort ; au moins le temps de l'écriture du livre. Le plus simple était donc de m'identifier à un condamné à mort, à un malade. C'est seulement là que l'ironie m'est revenue. Toute cette production d'ironie, avec plus ou moins de férocité ou d'acuité, est là, en effet, pour injurier le destin.
Est-ce que l'ironie pourrait être une tentative de réconciliation avec soi, avec son passé ?
Une réconciliation ou une conciliation. C'est ce que j'appelle avoir pitié de soi. Accepter de se moquer de soi, c’est parvenir à se supporter comme on est. Paul, par exemple, s’obligeait jusque-là dans son travail musical à ignorer ce qui pouvait rendre cette musique insupportable. Il n'est pas réconcilié avec la musique mais avec lui-même. C'est toujours ça de gagné.
Votre goût pour la lenteur joue également un rôle important pour Paul dans sa lutte. J'avais déjà perçu cette même lenteur dans le film Sous le sable de François Ozon.
Paul n'a plus les forces nécessaires pour se dépêcher et allonger le pas. Il n'a pas le temps de voir les gens, d’entendre. Dans mes différentes variantes, il se trouve que j’avais pensé à ce film de François Ozon. J'avais d'abord cru que c’était la femme qui était menacée de mort et qui disparaissait. Mais ça n’a pas marché.
L'ombre de Samuel Beckett (et son Premier amour) plane encore dans ce roman.
J'y ai pensé à ce livre-là. J'ai d'ailleurs voulu ce titre comme ça et j'ai voulu qu'il soit inscrit sur deux lignes. C’est même nombre de lettres et je le voulais comme un signe en miroir à Samuel Beckett. C'est un auteur qui m'a beaucoup influencé. Très vite je me suis senti de la même famille d'esprit. La première page de L'Innommable a été déterminante pour moi, comme une voie possible dans laquelle s’engager.
La peinture est toujours présente par le travail de la composition et des couleurs. On passe de Morandi à Hopper en une scène.
J'aime beaucoup la peinture. Chaque fois que je la rencontre, elle me fascine. C'est une façon de ne pas l’oublier, de rendre présent d'une manière forcée ce qui échappe à la littérature. Rien n'est à proprement parler audible ni visible dans ce roman, mais la peinture et la musique sont toujours présentes.
Comme des jaillissements ?
Il y a parfois des moments de grâce, des pulsions poétiques ; parfois on a une vision très nette, très colorée et la phrase surgit d'elle-même. À ce moment-la, on vit l’événement avec une intensité plus forte que celle du souvenir qui sous-tend l’écriture de la scène. C'est parfois tellement puissant qu’on en est à penser que la vie, c'est ça.
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
« Dernier amour débute lors d'un festival d'été en 1987 à Zurich. Au programme, Haydn, Beethoven et une œuvre contemporaine, celle du personnage principal du roman, Paul Cédrat Le quatuor à cordes entame l'opus 12 de Paul Cédrat, mais, très vite, tout dégénère. Le public se met à siffler, à huer le quatuor donc le compositeur, qui interrompt alors l'opus et se retire. C'est un échec pour Paul. Surtout qu'il n'a plus que quelques jours à vivre. Reste alors, avant de partir, la possibilité de se réconcilier avec lui-même. Il a tout préparé, a demandé à ses proches de le laisser seul, s'enferme dans sa maison près de la plage : il est prêt. Mais voilà, survient ce qu'il n'avait pas prévu : le grain de sable – en l'occurrence Debbie la baigneuse. L’émotion le submerge et l'amour, auquel il n'avait plus pensé, resurgit. L'histoire de la défaite d'un homme et de sa lente approche vers une mort annoncée laisse alors place à sa possible renaissance. Et la renaissance ne semble pouvoir se réaliser que si l’amour et l'émotion s'en mêlent. Spécialiste des variations autour d'un même thème mais aussi des improvisations, Christian Gailly retrouve ce qui, depuis son premier roman, le singularise : son ironie et sa poésie. À la fois drôle et touchante, sobre et gracieuse, son écriture sert à merveille cette histoire d'amour et de conciliation. Une fois encore, Dernier amour nous dit que le désespoir total n'est pas pour maintenant. Il suffit d'une couleur particulière, d'un enfant qui se baigne et vous rappelle votre jeunesse, d'une femme qui vient récupérer son peignoir, d'une berceuse, entre autres preuves, pour se sentir à nouveau en vie.
“ C’est tout de même bête d'avoir passé toute sa vie avec une femme et de s'apercevoir seulement maintenant qu'on est fait pour marcher au bras d'une autre.
L’a-t-il pensé ? Senti ? Bien sûr que oui. Mais ça n'était que cette vieille envie de vivre. Non pas de recommencer. Juste continuer. ”
Livre après livre, à travers les clins d'œil à sa famille d'écriture (Samuel Beckett, Marguerite Duras ou encore Jean Echenoz), les reprises, les répétitions et les récurrences (on retrouvera par exemple le Dauphin vert, Simon Nardis et Debbie du Soir au club), un visage de plus en plus précis apparaît. Bout de peau après bout de peau, cet amateur de peinture poursuit son autoportrait commencé en 1987 (même visage avec à chaque fois quelques années de plus) et qui nous émeut toujours. C'est donc encore une fois un Christian Gailly inquiet et chargé d émotion qu'on devine dans Dernier amour même si l'écriture, elle, on dirait bien qu'elle tremble moins. C'est peut-être ça, la grâce. »
Christophe Grossi (Page, septembre 2004)
ISBN
PDF : 9782707327277
ePub : 9782707327260
Prix : 6.99 €
En savoir plus
Jean-Baptiste Harang (Libération, 16 septembre 2004)
À l'article de l'amour
Le héros de Christian Gailly a de belles heures devant lui.
« C'est écrit sur le dos du livre : “ Imaginez. Il ne vous reste que deux jours à vivre. Qu'est-ce qui est préférable ? Finir tranquille dans l'ennui qu'aura été toute votre vie ? Ou bien, si vous êtes musicien, comprendre enfin pourquoi votre musique vient d'être huée et dès le lendemain, rencontrer celle qui devrait être votre dernier amour. ” On a le droit de répéter ces choses, elles sont en vitrine, faites pour être lues avant d'entrer, exposées pour achalander. Nous, Gailly, on le lirait les yeux fermés. C'est son douzième roman, on n’a pas besoin de réclame Pourtant on en apprend beaucoup avec ces six petites lignes : “ Imaginez ”, déjà signifie qu'il va falloir y mettre du sien, qu'on va se faire servir des verbes à la deuxième personne du pluriel de l'impératif, et que ce roman, cette œuvre d'imagination, devra autant à la vôtre, ainsi sollicitée, qu'à la sienne, Gailly, d'imagination. Bien sûr, il y a un cadre, un postulat, “ Il ne vous reste que deux jours à vivre ”, on appelle cela une mauvaise nouvelle, on n'avait rien demandé. Surtout qu'à l'intérieur, ce n'est pas si simple. D'accord, il n'en mène pas large, Paul Cédrat, ce n'est pas la grande forme, page 18 on parle de son état de faiblesse qui l'empêche de sauter du parterre sur la scène d'un théâtre, mais on n'est pas à l'agonie, surtout qu'il vient de se faire agonir par le public devant lequel on joue son œuvre triste, ils n'y connaissent rien. Page 21, il a besoin de prendre l'air, mais là encore, ce n'est pas l'article de la mort.
Bon, d'accord, page 38, le chauffeur du taxi Mercedes (il y en aura trois, des taxis Mercedes, dont l'un servira trois fois, ce sont des renseignements qui ne figurent qu'à l'intérieur, mais qu’on donne ici, par pure générosité), le chauffeur, donc, dit à Paul, sans le moindre guillemet (c'est un livre sans guillemet, les dialogues font partie du reste, c'est-à-dire du tout, les monologues intérieurs, surtout un, celui de Paul, et les nôtres, narrateur, auteur et lecteurs, ils ne sont pas plus certains que le reste, pas moins non plus, d'ailleurs) le chauffeur de taxi, donc, avec sa raie au milieu, dit à Paul : “ Vous pouvez dire que vous m’avez fait peur. J'ai cru que vous étiez mort. ” Certes il l'a cru, mais Paul n'est pas mort, un simple endormissement. Cinq pages plus loin, bien sûr, “ Paul avait du mal. Peinait à avancer. J'en peux plus. J'ai plus de force. Ça fait rien. Avance quand même. Tant que tu peux avancer, avance. Tant que tu pourras Tu ne vas pas nous laisser. Pas déjà. Alors avance ”. Voyez, ce ne sont pas les impératifs qui manquent, ni le courage. D'ailleurs, autant vous le dire tout de suite, Paul ne mourra pas dans ce livre. Voilà, c'est dit. Ou alors dans les quelques pages blanches qui restent à la fin, pour la tare, quand tout a été écrit, que tout a été lu. Mais ça, ce n'est pas du ressort de Christian Gailly, les pages blanches, elles sont à nous, je veux dire vous et moi, tant pis pour lui, il avait qu'à les écrire, les pages blanches, ce n'est tout de même pas sorcier. Vers la fin, disons aux deux tiers, lorsque celle qui pourrait bien être ce Dernier amour, celle qui avait un peu oublié, mais pas vraiment, son peignoir gris sur la plage, vient voir Paul, on entend bien ceci : “ Vous avez bien fait, dit Paul, puis : Vous avez surtout bien fait de venir vite. Elle : Pourquoi dites-vous ça ? Lui. Parce qu'en principe je devrais être mort. Elle : Qui vous a dit ça ? Lui : Les médecins. Elle : Quand vous l'ont-ils dit ? Lui : Il y a un peu plus de trois mois. Elle : Combien de temps vous accordaient-ils ? Lui : Devinez. Elle : Bah oui, bien sûr, évidemment, excusez-moi, je suis stupide. Paul : Oui, enfin non, enfin bref inutile de nous attendrir. Dites-moi comment vous vous appelez et puis partez. ” Bon, enfin de compte, elle s'appelle Deborah Nardis et on ne perd rien pour s'attendrir, elle reviendra. Elle dira : “ Comment vous sentez-vous ? ”, et Paul répondra : “ Comme un type qui n'en finit pas. ”
Les livres ne sont pas des mondes finis, ils empiètent les uns sur les autres, ici par exemple (page 60) on lit un livre, “ À en juger par le titre, il devait s’agir d'une soirée mémorable dans un night-club ”. Et, dans Un soir au club, le précédent livre de Gailly, une Debbie, l'accourci de notre Deborah, tenait comme ici un night-club à l'enseigne du Dauphin vert, il faudrait vérifier, mais je pense qu'il était vert. Alors ? “ Finir tranquille dans l'ennui qu'aura été toute votre vie ? ” qu'est-ce que vous en savez, que c'est fini ? qu'on est tranquille ?et qu’on se sera ennuyé, hein ? aimé comme on est par Lucie, femme parfaite, mère de nos enfants, qu'on aura été joué, bien, à Zurich entre Haydn et Beethoven, sifflé, hué, d'accord, mais joué. Et, à supposer qu'on meure, mettons que ça nous pend au nez, on meurt quand même dans le paquet-cadeau d'un Dernier amour, avec auprès de soi, Lucie, que par pudeur on aurait préféré éloigner, comme un premier amour. Christian Gailly écrit pour être consolé, sans l'ombre d'une illusion, on le lit pour exactement la même raison, alors, forcément, on se tombe dans les bras. Premier amour était (est) un roman de Samuel Beckett, que publièrent aussi les Éditions de Minuit, il n'y a pas à sortir de là. »
Patrick Kéchichian (Le Monde, 1er octobre 2004)
Les élans retenus de Christian Gailly
Le douzième roman de l'auteur de Be-bop tisse la toile des ultimes instants de la vie d'un homme. Tout l'art de l'écrivain se déploie avec une légèreté aérienne dans l'histoire de ce « dernier amour »
« Il faudrait prescrire ce livre – et tous les livres de Christian Gailly – aux amateurs d'emphase et d'éloquence flamboyante. Non pas aux maîtres, bien sûr, mais à la légion des émules qui sévissent, et pas seulement en littérature. À ceux qui mesurent benoîtement la beauté d'un style à la longueur, à la lourdeur des phrases, et la richesse du sens à l'accumulation des subordonnées. Ce serait une cure salutaire. Et leur prose empesée s'allégerait à l'instant de sa propre pesanteur et de tout son poids de falbalas et d'amidon.
Christian Gailly, lui, ne termine pas toutes ses phrases. Même lorsqu'elles sont brèves, il lui arrive de les interrompre, de placer au plus vite le point qui vient briser leur élan. Car l'élan, semble-t-il professer, doit être ailleurs que dans les tournures avantageuses, plus près, à l'intérieur des choses elles-mêmes, et non dans le langage qui les désigne.
De même, il a un usage aérien des pronoms personnels. Ce n'est pas du minimalisme ou de l'objectivisme, mais exactement le contraire, puisque c'est l'émotion qui gagne en qualité, en subtilité. Elle est là, mais invisible. Elle grandit pourtant, se diffuse, se transmet. Comme si à trop nommer, à trop raconter on s'éloignait d'elle. Cela aboutit fatalement à des livres courts comme ceux de Gailly. Des livres qu'on lit avec légèreté, bonheur et reconnaissance. Après, on se retourne, pour évaluer ce qui vient de se produire, cet intime et discret événement que la lecture est apte à susciter. On relit chaque page, chaque phrase, avec attention pour tenter de comprendre la manière dont cette émotion s'est propagée. On admire l'auteur pour son art plein de réserve, ennemi de la pose, si juste cependant.
Paul Cédrat est malade, il va mourir, mais il n'est pas encore mort. C'est dans cette certitude et dans ce répit que s'inscrit ce Dernier amour, le douzième roman de Christian Gailly. Paul Cédrat est musicien ; son “ troisième quatuor à cordes, opus 12 ”, interprété par l'ensemble Alexander, un soir d'été à Zurich, est sifflé. Accumulation de mouvements lents. “ Ça manquait de variété. Il faut dire. Ça souffrait surtout d'une absence de contrastes. Les fameux contrastes. Lenteur-vivacité. Tristesse-gaieté. ” Paul quitte anonymement la salle de concerts, après ce dernier acte raté. Il ne se lamente pas, est triste surtout pour les quatre jeunes gens qui ont subi la mauvaise humeur du public. Lui est déjà dans le lointain. Dans l'ascenseur de l'hôtel, il croise une jeune femme, s'imagine qu'elle va mal – elle a les yeux “ injectés de sang. Trop pleuré, pensa Paul ” – lui propose de l'aide. Mais c'est lui, assurément, qui a besoin de secours et de soins.
Puis, de sa chambre, il appelle au téléphone Lucie, sa femme. Vieille complicité. Difficulté à trouver des mots neufs, surtout en une telle circonstance. Crainte de l'apitoiement, auquel on substitue la rigidité du comportement. À ce stade très avancée de la vie, on peut se permettre d'être un peu tyrannique avec les siens. Paul va gagner la maison du couple, au bord de la mer. Même si ce n'est pas dit, il est clair que c'est pour y mourir. Il veut être seul.
Là, à l'occasion d'un minuscule incident – un peignoir laissé par une baigneuse sur la plage –, il croise à nouveau une femme. Il pourrait en tomber amoureux, tant sa disponibilité est grande, sans limite, sans retenue, finale. “ Mais ce n'était que cette vieille envie de vivre. Non pas de recommencer. Juste continuer. ”
Ce sont tous les détails qui importent ici, l'écheveau infime et miraculeux des circonstances, des hasards, des rencontres. On ne sait pas ce que tout cela signifie, mais on constate que l'existence entière est suspendue à ces petits nœuds sans importance. C'est pourquoi il ne faut pas en dévoiler davantage. Car le livre est déjà, par ses ellipses, une sorte d'esquisse, de résumé, comme une suite de notes.
Avec l'idée que l'on ne pourra jamais tout dire. Qu'il faut suggérer, présenter le fil, et que le lecteur le tirera, secrètement, pour lui-même. Dans Nuage rouge (Éditions de Minuit, 2000), Gailly avait écrit : “ Que faisons-nous d'autre, nous autres, vous et moi, vous qui me lisez pendant que moi j'écris tout ça, sinon croire que ça suffira ? ”
On ne peut parler des romans de Christian Gailly sans évoquer leur rythme, leur tempo, leur mélodie. Chez lui, “ la musique est toujours celle des circonstances ”. Il dit aussi : “ Il n'y a pas de peine perdue. ” Là, on lui adresse un salut, et on s'empresse de donner à lire Dernier amour, à tous ceux que l'on aime justement. »
Nathalie Crom (La Quinzaine littéraire, 1er septembre 2004)
Paul Cédrat va mourir
Quel est-il ce « dernier amour », qui donne son titre au nouveau roman – il s'agit du onzième, deux ans après Un Soir au club, prix du Livre Inter 2002 – de Christian Gailly ? Peut-être une femme. Peut-être une musique. À moins que ce ne soit un paysage, une couleur, un bruit, une odeur... À moins que ce ne soit tout cela ensemble, tout cela réuni en une ultime respiration. Car Dernier amour est l'histoire d'une fin. La fin de tout.
« Paul Cédrat va mourir. C'est une question de jours, et même une question d'heures. On ne le sait pas encore quand on le rencontre à Zurich, un soir d'août, lorsqu'il assiste à la création sur scène d'un “ Quatuor ” de sa composition. Le concert tourne au fiasco intégral, le public juge l'œuvre trop lente, longue, triste et répétitive : “ On a vu. Surtout entendu mais aussi vu. La salle se déchaîner contre la musique de Paul. Pas brutalement comme un coup de tonnerre. Plutôt comme un orage lent, long à venir, venant de loin, précédé de coups de vent avec les cris aigus des oiseaux noirs qui tourbillonnent. ” Sur ce, retour à l'hôtel.
Le lendemain, voici Paul revenu à Paris. Exténué par l'expérience de la veille et surtout par la maladie qui, de l'intérieur, le ronge. Paul : “ Grand spectre osseux. Lenteur de vieillard. ” Un bref passage à l'appartement, et direction la gare. Trois heures dans le train lancé à grande vitesse, et ce seront la villa, l'océan. Elle ne le voit pas mais, sur le quai parisien, Paul croise Lucie, sa femme. La villa, elle en revient, elle l'a préparée pour le séjour de Paul – ses derniers jours, qu'il va peut-être abréger, qu'il a en tout cas décidé de vivre seul, sans elle.
La propriété porte un nom de carte postale, “ Les Flots bleus ”. Soit une maison en bord de mer, encadrée de pins : “ Hauts et nus jusqu'au ciel. Idéalement espacés distillaient une douce clarté, laiteuse, une sorte de lumière de lait avec une pointe de menthe. ”
L'écriture dépouillée, elliptique, syncopée que l'on connaît depuis longtemps à Christian Gailly – depuis notamment Be-Bop (1995), Les Évadés (1997), La Passion de Martin Fissel-Brandt (1998) –, prend dans ces pages une valeur singulière, tant esthétique que métaphysique. Comme si le morcellement de la phrase, le rythme posé et la tonalité presque froide que l'écrivain lui imprime, disaient la fatigue extrême, l'accablement physique et tantôt moral de son personnage, disaient surtout la distance qui déjà le sépare de la vie – comme si était ainsi anticipée, discrètement et sans pathos, la tragique syncope finale. De même, la remarquable capacité de Christian Gailly à agencer les sensations – lumineuses, colorées, sonores – pour composer des décors, installer des ambiances, pour dire le monde comme un tableau intelligent et construit, trouve-t-elle dans l'exacerbation maladive des sens de Paul, l'homme qui va mourir et regarde autour de lui pour la dernière fois, une raison de s'épanouir avec une force singulière.
La proximité de la mer, c'est d'abord le bruit : l'océan “ en pleine puissance sonore. La violence de la lumière ne fait que rendre ce vacarme encore plus assourdissant. Non, ça n'est pas du vacarme. Et ça n'est pas assourdissant. C'est le bruit des vagues à marée haute. De hautes vagues grossies par le vent. Elles se laissent tomber. Choir pour ce qu'elles sont. Gros paquets de mer... ” Et après le bruit, vient la lumière, avec elle les couleurs, puis les odeurs (un tissu imprégné de soleil, puis les sensations tactiles (le velours d'une fleur), tout cela agencé avec acuité par Paul Cédrat, le musicien, en une composition subtile, en quatre dimensions.
Dans le tableau, bientôt, le regard de Paul isole un détail : “ Ses yeux se posèrent sur une tache gris clair. Bien visible sur la sable jaune foncé. Près d'un rocher noir. Magnifique rapport de couleur. Hasard ou simple désir de faire beau. ” Émouvant et providentiel accident esthétique, qui vaudra à Paul de rencontrer la femme qui en est à l'origine. Une jolie femme dont il ferait volontiers son dernier amour – histoire, peut-être, de quitter ce rôle de spectateur résigné de l'existence que lui assigne la maladie, pour en redevenir, l'espace de quelques heures, un acteur. Ce serait pourtant mal connaître Christian Gailly que de croire qu'il pourrait laisser ici s'installer le sentimental, et le tragique qui lui serait forcément corollaire. Ce dernier amour de Paul est un élan rien moins que contrarié, au déroulement miné par des dérèglements cocasses, des malentendus. Il fallait certainement à la mort cette atmosphère tragi-comique, pour survenir discrètement, élégamment, comme une virgule musicale plutôt qu'un coup de gong. Ultime ponctuation de ce beau roman où Christian Gailly laisse entendre la note grave, presque anxieuse, toujours présente dans ses livres, ici plus audible, plus claire, presque lumineuse. »
Jean-Maurice de Montremy (Livres-Hebdo n°562, 18 juin 2004)
Mort, avec vue sur la mer
« La scène se trouve au milieu de ce douzième roman de Christian Gailly, Dernier amour. Le compositeur Paul Cédrat – “ élégant grand maigre ” – revient seul. exténué, d'un séjour à Zurich, où l'on vient de créer son dernier quatuor. Un “ four ” : le public a jugé l'œuvre sinistre, répétitive. Mais Paul Cédrat n'a même pas voulu se battre. Il sait, depuis trois mois, que sa fin est imminente. Il a donc voulu tout de suite rejoindre sa villa du bord de mer Les Flots bleus.
Il est en piètre état, silencieux, presque absent à lui-même. Il ouvre les portes-fenêtres, et la mer fait son entrée dans le roman : “ La mer, c'est l'océan qu'on entend maintenant. En pleine puissance sonore. La violence de la lumière ne fait que rendre ce vacarme encore plus assourdissant. Non, ça n'est pas du vacarme. Et ça n'est pas assourdissant. C'est le bruit des vagues à marée haute. ” À ces ambiances musicales que Christian Gailly sait si bien écrire, en évitant de les décrire, s'ajoutent les “ échanges de couleurs ” dont il a le secret : “ Ses yeux, poursuit le narrateur, viennent de subir les éclairs du soleil. De plein fouet. Il est de face à cette heure-ci. Dès qu'il a ouvert la porte-fenêtre. Mais alors, l'air de la mer, du large. L'odeur, la tiédeur forte, fraîche. Quel plaisir de respirer un air comme ça. Qui vous rappelle quel plaisir c'est de respirer ”.
Paul Cédrat sait donc qu'il va mourir. Il veut anticiper de quelques jours seulement une fin que son médecin lui annonce cruelle. Il a, pour cette raison, demandé à sa femme de préparer Les Flots bleus, mais de l'y laisser seul. La description de la villa, de ses teintes, de ses matières prolonge ainsi le calme rituel d'évocations colorées commencé aux premières pages par la salle du concert et le grand hôtel de Zurich.
Paul Cédrat (et le lecteur avec lui) voit tout pour la dernière fois sur le mode du constat, presque à plat, qu'il s'agisse de sa chambre luxueuse, puis du taxi suisse le menant à l'avion, puis de l'avion le menant au taxi parisien puis du train le menant jusqu'aux parages de la mer. Rituel qui culmine avec le troisième et ultime taxi, toujours une Mercedes, qui l'a conduit de la gare jusqu'à la villa.
L'ordonnance de ces dernières journées, l'intense et discrète poésie du deuil n'empêchent pas les touches d'humour, les petits déréglages et autres coq-à-l'âne d'une vie qui reste encore – malgré l'adieu – une banale vie quotidienne. Aussi Paul Cédrat connaîtra-t-il, aux Flots bleus, de manière insolite, voire cocasse, un épisode de comédie amoureuse tout à fait imprévu : une histoire de peignoirs confondus sur la plage et l'apparition d'une belle nageuse sortie de la mer comme sortait de la lagune l'énigmatique figure révélatrice de La Mort à Venise ...
Ce “ dernier amour ” dans la vie de Paul Cédrat permet à Christian Gailly d'utiliser en finesse tout son clavier : l'extrême grave, l'élégance, l'incongru. Il n'en perd pas pour autant son sens, tout musical, de la narration. Ceux qui ont aimé Be-Bop (1995), Les Évadés (1997) ou Un soir au club (Livre Inter, 2002) retrouveront ici, dans un registre renouvelé, le meilleur de l'écrivain. Et même quelques musiques ou personnages récurrents. »
Du même auteur
- Dit-il, 1987
- K. 622, 1989
- L’Air, 1991
- Dring, 1992
- Les Fleurs, 1993
- Be-Bop, 1995
- L'Incident, 1996
- Les Évadés, 1997
- La Passion de Martin Fissel-Brandt, 1998
- Nuage rouge, 2000
- Un soir au club, 2002
- Dernier amour, 2004
- Les Oubliés, 2007
- Lily et Braine, 2010
- La Roue et autres nouvelles, 2012
Poche « Double »
- Be-Bop , 2002
- Un soir au club , 2004
- Nuage rouge , 2007
- L'Incident , 2009
- Les Évadés , 2010
- K.622 , 2011
- Les Fleurs, 2012
- Dernier amour, 2013
- Lily et Braine, 2023
Livres numériques
- Be-Bop
- Dernier amour
- La Roue et autres nouvelles
- Les Fleurs
- Be-Bop
- Dernier amour
- K. 622
- K.622
- L'Incident
- L’Air
- La Passion de Martin Fissel-Brandt
- Les Évadés
- Les Oubliés
- Nuage rouge
- Un soir au club
- Dit-il
- Lily et Braine
