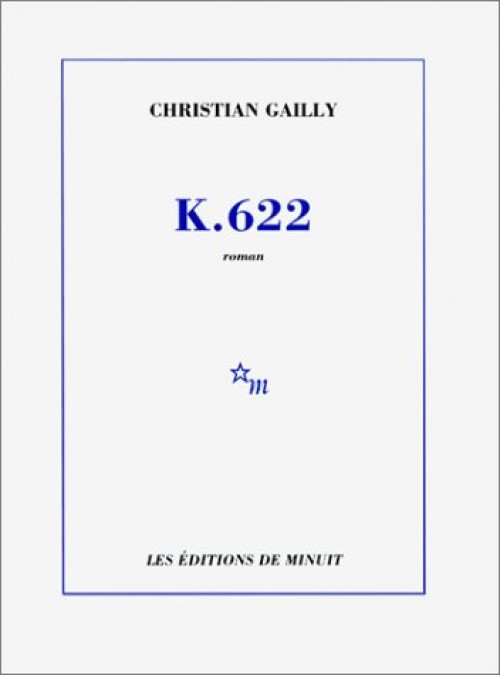
Christian Gailly
K. 622
1989
128 pages
ISBN : 9782707312990
13.70 €
* Réédition dans la collection de poche double n° 71
Une nuit alors qu'il est au lit dans le noir et somnole la radio allumée, la musique de Mozart s"insinue dans la chambre et le réveille. L’émotion est si forte qu’il a peur de la perdre, de ne jamais pouvoir la revivre. Il se procure différents enregistrements de l’œuvre, les écoute, mais chaque fois quelque chose manque, il ne retrouve pas le plaisir de cette nuit-là. Puis un jour il apprend que le concerto va être donné à Paris. Il décide de s’y rendre.
ISBN
PDF : 9782707327499
ePub : 9782707327482
Prix : 5.99 €
En savoir plus
Françoise Asso (La Quinzaine littéraire, 1er décembre 1989)
Écrire quand même, écrit-il
« Raconter une histoire ne va pas de soi, surtout quand on éprouve, comme le narrateur de ce livre (et le lecteur, rêve-t-il), de la “ répugnance pour les récits nickel au passé simple ” ; qu'on a lu déjà quelques histoires, et non des moindres, dans lesquelles quelqu'un part, en l'écrivant, à la recherche d'une sensation, d'une émotion perdue ; que l'on sait déjà, en commençant, que la beauté ne se retrouve identique que sous une autre forme, et que cette forme, on sait qu'on doit l'inventer, au plus loin de la première dont on ne peut retrouver l’équivalent qu’en y renonçant.
Le livre de Christian Gailly est donc comme la métaphore désinvolte – d'une désinvolture travaillée – d'un apprentissage, dont l'épigraphe donne le ton : “ C'est en écrivant qu'on devient écrivain, écrit-il. ” Métaphore double, puisqu'elle se repère aussi bien dans la ligne de l'histoire que dans celle, disloquée, digressive, et acrobatiquement tenue, du récit.
La ligne de l'histoire est donc une recherche, celle d'une émotion, à la rencontre de laquelle le personnage se prépare minutieusement pour en trouver une autre, et cependant la même – histoire qui, à l'évidence, ne saurait se résumer : pour en donner une idée, c'est la préparation minutieuse que l'on aurait envie d'évoquer, donc de développer et non de résumer, ce qui conduit par force à l'essentiel, la ligne du récit, celle-là même du récit en train de s'écrire, entre distraction et obsession, du récit empêtré dans des préliminaires, des rêveries parallèles, des anecdotes contiguës, qu'il accueille chemin faisant, et qui se font toujours plus rares dans la dernière partie, lorsque l'histoire est advenue et que le livre, comme de juste, s'interrompt (“ ... on ne sait pas finir, se dit-il.
On ne sait pas s'arrêter à temps, l'ennemi c'est le temps, la durée, il fallait couper l'histoire en plein milieu, ne pas hésiter à l'interrompre, oser suspendre le récit à son point le plus haut, le plus intense, le plus dense, le plus captivant, se dit-il aussi.
Aucune histoire ne résiste au temps, il faut l'arrêter, arrêtez-la !, oser, peu importe qu'elle ne finisse pas au sens où on l'entend, une fin est une fin, se dit-il encore.
L'arrêt y met fin sans lui permettre de finir, pourrir, se dégrader, du même coup me libère sur le moment le plus élevé, se dit-il enfin. ”)
Et la fin joue, en effet, le jeu d'une convention romanesque où ce récit excentrique s'abîmerait s'il n'était brusquement suspendu, dans un mouvement qui ramène l'histoire au récit qui s'est écrit (“ Voilà, c'est tout. C'est peu, je sais, mais j'ai beau fermer les yeux, je ne vois plus rien, c'est tout blanc, sans doute la couverture, et le chiffre apparaît en bleu : K. 622. ”), au Je du premier chapitre (l'effort pour raconter s'accompagne ici, conformément à la règle, d'un passage appliqué à la troisième personne), à la première phrase : “ l'œuvre dont le chiffre apparaît sur la couverture est un concerto de Mozart, je sais que tout le monde le sait mais je le dis pour ceux qui, peut-être, ne le savent pas, et aussi pour ceux qui le savent, afin qu'ils sachent que je le sais aussi, et enfin afin que nous soyons tous là à savoir que nous le savons, ça commence bien. ”
Le charme de ce livre, infiniment drôle dans sa syntaxe même qui met sur le même plan, fait entendre d'une même voix, récit et commentaire, vient de ce qu'il se permet tout, se passe toutes ses fantaisies, s'écrit dans une fausse innocence, ressemble à quelqu'un qui traîne ostensiblement les pieds et s'amuse – lui tout seul, oui, c'est la meilleure manière d'être drôle – à esquisser en douce, à part soi, quelques entrechats. »
Jean-Noël Pancrazi (Le Monde, 16 mars 1990)
Christian Gailly ou la beauté inaccessible
« Peut-on éterniser une émotion musicale, empêcher le temps de l'altérer ? C'est ce que tente le narrateur du deuxième livre de Christian Gailly, ébloui par le Concerto pour clarinette en la majeur de Mozart (K.622), qu'il a écouté, une nuit, à la radio.
En recherchant de disquaire en disquaire l'enregistrement idéal, en se préparant, une semaine à l'avance, à se rendre au “ Théâtre musical ” où le concerto est joué, il cherche à mettre en scène le plaisir et l'émotion qu'il a éprouvés à la première écoute. Mais s'il est possible de reproduire le décor extérieur, “ le décor intérieur, lui, n'est pas reproductible ”.
Pour évoquer cette chute de l'absolu, ce passage de l'extase à la déception, Christian Gailly accomplit des variations pathétiques et burlesques, le narrateur prend une allure de clown perdu qui semble vouloir expier sa propre impossibilité à rejoindre la beauté.
L'humour acerbe qu'il exerce à l'égard de lui-même ne s'estompe qu'au moment du concert. Il trouve alors une équivalence imaginaire à son émotion première. Le rythme de parade loufoque du livre s'apaise dans de très belles pages, féeriques, intemporelles.
Comme hanté par l'idée de perdre la grâce vibrante de son récit, Christian Gailly le suspend à son moment le plus dense : l’approche tremblante des corps. Une pirouette narquoise interrompt la vague de lyrisme. Cette élégance de l'ironie, cette musique des mots brisée à son apogée, appartiennent en propre à Christian Gailly et sont la marque de son talent. »
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
« Ça commence par une phrase incroyable, avec un verbe huit fois repris, jeu de variations sur une même note : “ L’œuvre dont le chiffre apparaît sur la couverture est un concerto de Mozart, je sais que tout le monde le sait mais je le dis pour ceux qui peut-être ne le savent pas, et aussi pour ceux qui le savent, afin qu'ils sachent que je le sais aussi, et enfin afin que nous soyons tous là à savoir que nous le savons. ” Rien de moins. Avec en supplément une petite fantaisie sur l'assonance enfin/afin. Inutile de préciser que le reste est à l'avenant. Et qu'on en redemande. »
Jean-Claude Lebrun (Révolution, 8 décembre 1989)
Claude Prévost (L'Humanité, 25 octobre 1989)
« L'apogée du récit. c'est le chapitre 3, six petites pages qui “ racontent ” le concerto. Exercice difficile : “ La musique parle en se taisant et moi j'écris mon découragement de ne pouvoir traduire ce qu'elle dit, et elle dit, elle dit, mon sentiment, la somme, la totalité de mes sentiments, elle recouvre, englobe, tout ce que je ressens, comme mutité, aveuglement, impuissance. ” L'écrivain affronte la même épreuve que “ WAM ”, le compositeur, Wolfgang Amadeus Mozart : “ traduire l'impossible ”. C'est même l'obsession de cet homme qui nous confie : “ Je ploie toujours sous l'absolue nécessité d'écrire ” et qui constate – cela revient comme un leitmotiv – qu'il ne retrouvera jamais l'émotion éprouvée, qu'il s'épuise à vouloir saisir l'insaisissable. »
Michèle Bernstein (Libération, 12 octobre 1989)
Christian Gailly. Mozart en sourit dans sa tombe
« On n’aurait peur de rencontrer, dans la vie, le personnage-narrateur de K.622, le roman de Christian Gailly : il est si gentil, si foncièrement bon et si vulnérable, qu'en passant à deux mètres, on lui ferait un bleu. “ J'ai l'âge de tirer des conclusions, se dit-il : je serai toujours plus bête qu'un autre et plus malheureux que n'importe qui. Voilà qui est clair. Avant que je n'en finisse, que tout cela ne finisse, j'espère que mon petit malheur fera le bonheur de quelques-uns, écrit-il. ”
L'âge ? L'âge mûr, à vue de souvenirs, quarante ans ou plus. C'est ce qui donne le relief à cette sensibilité à vif, à cette intelligence brouillonne : les émotions lui obstruent la gorge, les mots bouillonnent dans sa tête. Et – puisque le roman est construit sur une comparaison musicale, continuons allègrement – Christian Gailly traduit cette effervescence par une écriture qui suit le rythme du vol du bourdon. Qu'il est loin le temps où Flaubert (je crois) nous interdisait d'utiliser deux fois le même mot dans une phrase. Ici l'accumulation (à ne pas confondre avec répétition pure et simple), L’accumulation charge le sens. On voudrait citer court qu'on ne le pourrait pas : “ ...Il s'effondre sur le volant et sanglote : mon père aussi, dit-il tout haut dans l'habitacle sourd, mon père aussi se serait défendu s'il avait pu se défendre, s'il avait eu l'occasion de se défendre ou la chance ou le choix de pouvoir se défendre mais il est mort, il n'a pas eu l'occasion ni la chance ni le choix de se défendre, il se serait défendu aussi, aussi bien que moi mais il est mort avant d'avoir pu se défendre, il n'a pas eu le choix ni la chance ni l'occasion de se défendre, on ne lui a pas offert (...) de se défendre contre la mort et s'il n'y a aucun moyen de se défendre contre la mort, je n'ai aucune raison de me défendre contre le reste, je n'en vois aucune... ” Remarquez pour rabâcheur qu'il soit, ce développement en escargot m'en dit autant, et plus vite, que tout un chapitre de réminiscences prolétaires brimées.
Maintenant, précisons bien : dans ce roman qui, en filigrane, est celui de la revanche du faible, le héros n'est pas malheureux. Suivant une logique quasi évangélique, le dernier arrive premier. À chaque pas il risque le malheur, il frôle le pire, et par un retournement hardi rencontre – à la mesure du quotidien dérisoire – un triomphe. C'est la mort de Pearl White, L’arrestation de Fantômas : à un cheveu près. Reprenons la très simple intrigue : un matin, il entend à la radio le concerto K.622 pour clarinette en la majeur de Mozart (celui du titre), et est écrasé par une illumination de beauté comme j'espère que nous en avons tous eue à une occasion ou une autre. Donc, va acheter le disque. Malheur de vivre : n'a pas le pouvoir des mots pour se débrouiller dans le magasin comme un musicophile averti, ou simplement un client désinvolte. Triomphe : la marchande rêveuse l'écoute avec lui, et le lui offre. À force d'écouter le disque, il faudra bien qu'il aille entendre ledit concerto en concert. Mais quelle histoire ! Il (croit qu') il lui faut acquérir un costume neuf, chemise, chaussures et cravate. Au prix de quels sacrifices, à quel prix et comment s'y prendre ? À force de se prendre les pieds dans le tapis, le nez dans les portes tournantes, et le cœur au sourire de la vendeuse (enfin, le cœur... pas chanceux en amour non plus, disons qu'un rien l'excite), le voilà équipé. Malheurs innombrables, angoisses suantes et rougissantes devant les caissiers, les tickets les essayages. Le triomphe est à là hauteur, puisque dans la cabine la jolie vendeuse lui tombe dans les bras, comme une fleur. Mais n'a-t-il pas, à force d'échanges, assemblé dans ses sacs un attirail de clown ?
Bien sûr, un clown, y compris le nœud de cravate. Le roman de Christian Gailly est construit exactement comme un numéro de cirque (et je n'oublie pas à quel point son premier livre m'avait fait penser à un texte de – très bon – music-hall). Un clown qui trébuche, mord le tapis, mange la sciure, tombe et se redresse comme un culbuto, tout à coup joue un air céleste sut son petit violon ridicule, et s'en va enlevant l'écuyère.
L'air céleste c'est (ici, finie la gaucherie attendrissante, L’auteur s'envole), c'est l'explication (“ ...le fait d'apprendre plus tard qu'il s'agissait de la dernière œuvre achevée par le compositeur me l'a rendue encore plus belle, comme c'est lâche de s'arrêter à de pareils détails... ”), le commentaire du fameux concerto. Merveille d'émotion et d'intelligence, jamais je ne pourrai plus l'entendre autrement. Irracontable, irrésumable, il débute ainsi : “ Allegro. C'est le crépuscule, WAM, de retour d'un long voyage, d'une longue vie de travail, trente ans tout de même d'une tache épuisante, pénètre dans la forêt bleue et se présente devant ses juges, les grands arbres, qui l'accueillent, d'une manière fermement aimable, sèchement affable, une certaine froideur sévère. Ils l'interrogent sur son œuvre... ” Il y en a six pages, de 87 à 42, – vous pouvez feuilleter très vite en librairie ; si vous le faites, je crois que vous emportez le volume.
Et l'écuyère ? Ce monde n'est pas parfait, à mon avis, elle boite. Cette aventure avec une aveugle aux yeux clairs rencontrée au concert, très belle et qui sent très bon (L’auteur ne précise pas ce dernier point ;mais quand on habite dans l'lle-Saint-Louis un somptueux appartement donnant sur la Seine, on ne se parfume pas à la lavande de Prisunic), ce fantasme michèlemorganesque (c'était quel film, l'aveugle ? La Lumière qui s'éteint ?) me laisse aussi froide que la beauté de notre blondeur nationale. On dit “ fantasme ”, on dit méchamment : bon, il gamberge qu'il se séduit une infirme de la haute, on a tort, on pourrait blesser. On se rappelle trop bien le dessin de Thurber où un énorme lapin dit à son psychiatre que, parfois, il a l'impression d'être un lapin ; et que la vérité, en ses baroques recoins, peut recouper les pires excès de la romance. N'importe, j'aurais préféré m'arrêter à la musique. »
Du même auteur
- Dit-il, 1987
- K. 622, 1989
- L’Air, 1991
- Dring, 1992
- Les Fleurs, 1993
- Be-Bop, 1995
- L'Incident, 1996
- Les Évadés, 1997
- La Passion de Martin Fissel-Brandt, 1998
- Nuage rouge, 2000
- Un soir au club, 2002
- Dernier amour, 2004
- Les Oubliés, 2007
- Lily et Braine, 2010
- La Roue et autres nouvelles, 2012
Poche « Double »
- Be-Bop , 2002
- Un soir au club , 2004
- Nuage rouge , 2007
- L'Incident , 2009
- Les Évadés , 2010
- K.622 , 2011
- Les Fleurs, 2012
- Dernier amour, 2013
- Lily et Braine, 2023
Livres numériques
- Be-Bop
- Dernier amour
- La Roue et autres nouvelles
- Les Fleurs
- Be-Bop
- Dernier amour
- K. 622
- K.622
- L'Incident
- L’Air
- La Passion de Martin Fissel-Brandt
- Les Évadés
- Les Oubliés
- Nuage rouge
- Un soir au club
- Dit-il
- Lily et Braine
