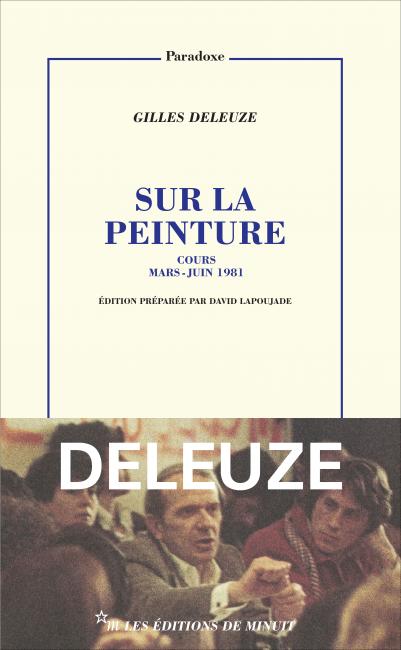
Gilles Deleuze
Sur la peinture
Édition préparée par David Lapoujade
2023
352 pages
ISBN : 9782707349156
26.00 €
De 1970 à 1987, Gilles Deleuze a donné un cours hebdomadaire à l’université expérimentale de Vincennes, puis de Saint-Denis à partir de 1980. Les huit séances de 1981 retranscrites et annotées dans le présent volume sont entièrement consacrées à la question de la peinture.
Quel rapport la peinture entretient-elle avec la catastrophe, avec le chaos ? Comment conjurer la grisaille et aborder la couleur ? Qu’est-ce qu’une ligne sans contour ? Qu’est-ce qu’un plan, un espace optique pur, un régime de couleur ?...
Cézanne, Van Gogh, Michel-Ange, Turner, Klee, Pollock, Mondrian, Bacon, Delacroix, Gauguin ou le Caravage sont pour Deleuze l’occasion de convoquer des concepts philosophiques importants : diagramme, code, digital et analogique, modulation. Avec ses étudiants, il renouvelle ces concepts qui bouleversent notre compréhension de l’activité créatrice des peintres. Concrète et joyeuse, la pensée de Deleuze est ici saisie au plus près de son mouvement propre.
Appel : Toute personne disposant ou ayant connaissance d'enregistrements de cours de Gilles Deleuze à Vincennes qui seraient antérieurs à 1980 est invitée à nous écrire à l'adresse suivante :
coursdeleuze@leseditionsdeminuit.fr
ISBN
PDF : 9782707349170
ePub : 9782707349163
Prix : 18.00 €
En savoir plus
Olivier Rachet, Mediapart, 29 novembre 2023
Deleuze et la peinture
Les cours sur la peinture donnés par Deleuze de mars à juin 1981 à l'université de Saint-Denis sont retranscrits aujourd’hui par les Éditions de Minuit et constituent un document exceptionnel sur la pensée rhizomatique du philosophe, saisie ici en plein mouvement.
Qu'est-ce que la philosophie a à dire de la peinture ? Bien plus sans doute que les historiens et les critiques d'art réunis, si l’on en juge par la pensée que déploie Deleuze dans ces cours inédits de 1981 prononcés à l'université de Saint-Denis. Le philosophe s'exerce ici à penser la peinture à partir de concepts qui valent autant pour la peinture que pour la philosophie : "diagramme", "catastrophe-germe", "modulation". Autant de concepts opératoires qui permettent de saisir l’histoire de l'art, et plus singulièrement celle des avant-gardes du début du XXème siècle, à travers des distinctions d'une grande justesse entre la gestuelle de l'Action painting et la codification de l'art abstrait ; deux aventures picturales dans lesquelles le geste de peindre se détache peu ou prou de l'oeil.
Peindre, explique d'abord Deleuze, c'est affronter la catastrophe. Pas seulement en termes de représentation, mais en tant que l'acte de peindre "se met comme dans la situation d'une création du monde ou d'un commencement du monde". L'acte se confronte au "chaos-catastrophe", c'est-à-dire à l'origine peut-être du mouvement et du cœur atomique de la matière. Il est une physique de la peinture, et des peintres par là-même, à côté de laquelle les historiens et les critiques d'art passent bien souvent, aveuglés par leur souci d'établir des chronologies, là où le peintre, précise Deleuze, "peint toujours un espace. Il peint un espace-temps, mais un espace." Sans dénigrer la peinture figurative ou la peinture d'Histoire, Deleuze porte son attention sur des peintres tels que Turner, Bacon, Cézanne, Pollock ou de Staël, dont la pratique s'appuie donc sur ce que Bacon définit par le terme de "diagramme", c'est-à-dire un vide moteur, une "instance opératrice" dit le philosophe, à partir de quoi l'univers plastique se construit ou se compose.
Supprimer la narration et l'illustration, ça serait ça, le rôle du diagramme et du chaos-catastrophe. Supprimer toutes les données figuratives car les figurations et les narrations sont données. Faire passer les données figuratives et narratives par le chaos-catastrophe, par la catastrophe-germe, pour qu'en sorte quelque chose de tout à fait autre, à savoir le fait.
L'auteur de Logique de la sensation, publiée la même année que ces cours se tiennent, revient largement sur la figure de Francis Bacon dont il montre qu'il crée moins des formes qu'il ne rend visibles des forces invisibles. Prolongeant la définition de Paul Klee selon laquelle "l'art ne reproduit pas le visible, il rend visible", Deleuze place la peinture sous la coupe des intensités émotives.
L'acte de la peinture, le fait pictural, c'est lorsque la forme est mise en rapport avec une force. Or les forces, ce n'est pas visible. Peindre des forces, c'est ça, le fait. (...) La catastrophe, c'est le lieu des forces. Évidemment, ce n'est pas n'importe quelles forces. Le fait pictural, c'est la forme déformée. Qu'est-ce qu'une forme déformée ? La déformation, ça, c'est un concept cézannien. Il ne s'agit pas de transformer. Les peintres ne transforment pas, ils déforment. La déformation comme concept pictural, c'est la forme en tant que s'exerce sur elle une force.
Où l'on perçoit qu'après Duchamp, Deleuze règle, à sa façon, son compte à la peinture rétinienne, toujours dotée d'un fort coefficient d'intentionnalité, pour lui opposer une peinture gestuelle plus en phase avec les lois de la physique et du cosmos.
Quel est le caractère de ce chaos-germe ? Je dirais, en second lieu, qu'il a pour caractère d'être essentiellement, fondamentalement, manuel. Seule une main déchaînée peut le tracer. (...) Tant que la main suit l'oeil, je peux dire qu'elle est enchaînée. La main déchaînée, c'est la main qui se libère de sa subordination aux coordonnées visuelles.
De là, Deleuze distingue, dans une clarté éblouissante, les lois de l'expressionnisme abstrait qui aurait l'audace d'affronter le "chaos-germe" et celles de l'abstraction géométrique d'un Mondrian ou d'un Kandinsky limitant justement le chaos "pour faire surgir un ordre moderne qui serait un code de l'avenir".
La catastrophe que frôle l'expressionnisme, c'est la chute dans le chaos pur et simple. La catastrophe que frôle la peinture abstraite, c'est l'application d'un code extrinsèque.
Tout le génie de ce cours, en avance sur son temps, est d'arriver à esquisser une distinction entre ce que serait d'un côté un langage analogique en lutte avec le chaos et, d'un autre côté, un langage digital qui en ferait abstraction. Tout l'art de Deleuze est de procéder ici de façon rhizomatique, n'hésitant pas à exhiber les impasses de sa pensée toujours en mouvement, laquelle est en permanence relancée par des étudiants qui le poussent souvent dans ses derniers retranchements. Anticipant sans le savoir sur l'émergence des IA et leur perpétuation d'une peinture rétinienne asservie désormais aux règles des technologies numériques, Deleuze avance le concept de "modulation", qu'il emprunte à Cézanne, pour tenter de définir une peinture qui en finirait avec tout impératif mimétique.
En d'autres termes, le diagramme est un modulateur. Voyez que ça répond bien à mes exigences : le diagramme et le langage analogique sont définis indépendamment de toute référence à la similitude. Il ne faudra pas que l'on réintroduise les données de similitude dans la modulation. Le langage analogique, c'est de la modulation. Le langage digital, ou de code, c'est de l'articulation.
Et d'appuyer son intuition par un détour par l'Essai sur l'origine des langues de Rousseau dont l'idée fondamentale, et fondamentalement poétique, était que le langage n'avait pas pour origine l'articulation, mais la musique.
L'articulation ne peut être que comme une seconde étape du langage. J'exagère : tout langage est articulé pour Rousseau, mais l’articulation ne peut être qu'une seconde étape de la voix. Avant le langage articulé, il y a la voix mélodique, dit Rousseau.
Il s'ensuit tout un développement sur le lyrisme de la peinture et l'importance des couleurs dont il montre, en s'appuyant notamment sur le Caravage et les écrits de Goethe, comment celles-ci commencent à se détacher d'un fond sombre ou à surgir, comme dans la peinture sublime d'un Nicolas de Staël - et nous aimerions ajouter d'un Ahmed Cherkaoui -, d'un faisceau de formes laissant entrapercevoir la lumière.
Il va faire surgir les couleurs éclatantes, et évidemment la tâche principale du peintre va commencer à être la dégradation. Ilva dégrader ces couleurs vives vers les ombres - c'est un tout autre régime de la couleur - et ça va être un des pôles de la naissance du luminisme, ces lumières éclatantes qui jaillissent d'un fond sombre.
Nul doute que la lecture de ces cours achevée, l'envie d'aller voir de la peinture ne vous saisisse à la gorge !
Christian Rosset, Diacritik, 18 octobre 2023
Après la parole d’un peintre conscient de sa difficulté à s’exprimer autrement qu’avec les moyens de son art et pourtant constamment « inspiré », celle d’un philosophe improvisant, certes après bien des répétitions (comme au théâtre, dit-il), sur la peinture, puisque tel est l’intitulé des cours de Gilles Deleuze en mars-juin 1981 à l’université de Paris VIII Vincennes-Saint Denis. Bien qu’étant intimidé, puisque je ne suis pas plus philosophe que Philip Guston, je lis avec plaisir ces cours qui me font entrer en dialogue avec leur auteur, comme partageant un amour commun de la peinture, même si l’amateur un peu praticien que je suis trouve parfois de quoi sauter au plafond, mais sans jamais décrocher… Car une intuition formidable relance toujours l’attention. Il faut dire que la retranscription effectuée par David Lapoujade pour les Éditions de Minuit est impeccable. On entend une voix, que l’on a déjà mémorisée (mais ce n’est pas seulement pour cela qu’on l’entend) : une voix à partir de laquelle peuvent se développer quelques polyphonies, probablement peu « philosophiques » si j’entremêle ma voix à la sienne, mais certainement musicales, et peut-être par là-même éclairantes.
Parcourons donc Sur la peinture en peintre tant imaginaire que réel : simultanément, en jeune homme qui a longtemps tenu un crayon ou un pinceau et en homme âgé qui a remisé les outils au profit de la machine de traitement de texte sans pour autant avoir changé… Travaillé par les agencements de mots, tout en étant fasciné par ce « significatif silence qu’il n’est pas moins beau de composer que les vers » (Mallarmé, à propos de la peinture). Donc : lire Deleuze, par pur plaisir, en parfait ignorant, c’est-à-dire sans maître ni marteau. Sur la peinture commence à peu près ainsi : « Aujourd’hui, toute ma recherche est tendue sur cette notion […] de catastrophe. Cela suppose évidemment que la peinture ait avec la catastrophe un rapport très particulier et ça, je n’essayerai pas de le fonder théoriquement d’abord. C’est comme une impression. » Ça commence sur les chapeaux de roue, avec un sens prodigieux de l’entrainement qui fait qu’on ne décroche jamais. Une telle richesse nous conduit à ne pouvoir relever que deux trois choses. Par exemple, que Deleuze dit de Cézanne « qu’il comprend mieux [Kant] qu’un philosophe » – qu’il n’y a pour lui aucun doute que Cézanne ait pu dire à Gasquet : « Je voudrais […] peindre l’espace et le temps pour qu’ils deviennent les formes de la sensibilité des couleurs, car j’imagine parfois des couleurs comme de grandes entités nouménales, des idées vivantes, des êtres de raison pure. »
On remarque, sans en être étonné, que Deleuze part très souvent d’écrits et propos de peintres et qu’il a plus de mal avec ceux qui ne savent pas se servir des mots – on ne trouvera pas le nom de Bram van Velde. Et pas davantage ceux des artistes les plus porteurs d’avenir de l’après Cézanne, à savoir Matisse et Picasso – pourtant excellents parleurs. Ou encore Simon Hantaï, peintre hanté par la philosophie, brièvement évoqué dans Le Pli en 1988. Cette absence radicale interroge d’autant plus que l’on tombe régulièrement sur des peintres assez ennuyeux que Deleuze qualifie parfois de « souffrant d’excès de don », ce qui semble démontrer qu’il n’est pas dupe. On sourit un peu du fait qu’il se montre généreux envers ces peintres à partir du moment où ils auraient fabriqué « des toiles qui sont tellement joyeuses ». Et quand il se plante radicalement, comme quand il évoque Erased de Kooning Drawing de Robert Rauschenberg qu’il voit comme « une provocation », il retombe toujours sur ses pattes. Ou quand il s’intéresse de près à Pollock, reprenant à son sujet le terme contestable d’Action painting (qui agaçait tant Guston ou Feldman), il en profite pour amorcer une réflexion sur « le caractère manuel de cette peinture », réfutant avec justesse l’idée émise par Greenberg de « l’instauration d’un monde optique pur » : « J’ai – dit-il – l’impression exactement contraire. » Avec les drippings, « c’est la première fois qu’une ligne manuelle est absolument détachée de toute subordination aux données optiques. […] Je crois que c’est simplement un malentendu, mais c’est effectivement moi qui ai raison » – (rires) ne suit pas, mais on l’entend.
Encore une fois, ces lignes n’ont d’autre but que de faire passer quelque chose comme un avant-goût incitant à la découverte de Sur la peinture, et non d’édicter des sentences critiques, laudatives – ou non. Reprenons le montage : « Aujourd’hui il faudrait, non pas finir, plutôt indiquer des directions de recherche. » Sur quel sujets ? La couleur – ou plutôt « des régimes de la couleur ». Ça ne donne pas du Wittgenstein (essentiel à méditer sur ce sujet), mais du pur Deleuze. Le « contour » (même si on est en droit de réfuter l’idée que Morris Louis fait du « tachisme »). Ou les frontières entre abstraction et figuration (dommage qu’il ne se soit pas intéressé à Guston qui fut, à égalité, un grand abstrait et un grand figuratif). Et on gardera éternellement en tête cette géniale réfutation de l’idée de la page blanche : « lieu commun d’une bêtise effroyable. C’est bête, mais bête à pleurer. [Et] c’est aussi bête de croire que la toile est une surface blanche, je crois que les peintres le savent bien. Avant qu’ils ne commencent, la toile est déjà remplie. […] Si bien que, dans l’acte de peindre, il y aura, comme dans l’acte d’écrire, une série de soustractions, de gommages. »
Bref, c’est comme pour Francis Bacon Logique de la sensation, livre de 1981, lu malgré une certaine réserve envers ce peintre : une fois commencé, puis achevé, on ne peut s’empêcher d’y revenir. Pourquoi ? Hasardons une hypothèse : plus qu’un cours sur la peinture, il s’agit d’une promenade en huit étapes avec Gilles Deleuze. Presque un autoportrait (?) Ou un miroir tendu à au devenir-peintre de tout un chacun (?) Accrochons nos interrogations sur quelque patère du théâtre de la mémoire, on y reviendra certainement un jour ou l’autre.
Le Book Club, France Culture, Marie Richeux, 17 octobre 2023
David Zerbib, Le Monde, 13 octobre 2023

Paul Bernard-Nouraud, En attendant Nadeau, 4 octobre 2023
Libération, 4 octobre 2023





Page des libraires, Lyonel Sasso (librairie Dialogues à Morlaix)
Il faut d'abord souligner le tour de force éditorial. Car il est difficile de retranscrire une parole sans la trahir, à un moment ou à un autre. Équilibre fragile donc. Un grand merci à David Lapoujade qui a su orchestrer l'ensemble de ces "poteries saoules", comme le disait Huysmans de la peinture de Cézanne. D'emblée, Gilles Deleuze déstabilise en prônant que c'est la peinture qui a quelque chose à apporter à la philosophie. Et de poursuivre sur la notion de "catastrophe". Pour illustrer ce thème, il prend pour exemple les tempêtes de Turner. Vibre dans l'explication de Deleuze, la pulsion du chaos qui engendre parfois la forme, l'idée. Et vogue, ensuite, sur une nef des fous qui prend à son bord Michel-Ange, Paul Klee, Vangogh ou encore Delacroix. À noter encore ses mordantes considérations sur la couleur qui lui fait dégager deux totems : la couleur-structure et la couleur-poids. On retrouve là la géniale improvisation deleuzienne qui surgissait au fil de cette belle voix à bout de souffle. C'est une lecture qui nous fait tout à fait entendre que "l'oeil écoute", comme le disait justement Paul Claudel.
La vie des idées, Camille Chamois, 23 février 2024
Les combats de l'oeil et de la main
Les cours de Deleuze sur la peinture envisagent non pas le tableau achevé, mais l’ensemble des conditions psycho-physiologiques qui président à l’acte de création.
Gilles Deleuze (1925-1995) a dispensé au Centre Universitaire Expérimental de Vincennes une série de cours, dont la plupart sont disponibles en version sonore (notamment grâce aux enregistrements de Richard Pinhas). Les Éditions de Minuit font paraître le cours de 1981 consacré à la peinture. Le remarquable travail éditorial de David Lapoujade permet de suivre aisément le développement de l’argumentation (notamment grâce à l'introduction de « sommaires » pour chaque séance ou de nombreuses notes de bas de page qui renvoient aux livres dont le cours suit manifestement de près le développement) sans pour autant perdre la tonalité orale de l'exposé. L'intérêt est de pouvoir suivre le déploiement progressif d’une pensée dont les livres publiés fournissent généralement la version finale et condensée dans des formules à la fois saisissantes et en même parfois difficiles à comprendre pour celui qui n’est pas familier du corpus deleuzien.
L’expérience de la « catastrophe »
L’ambition de ce cours est de donner une définition générale de « la peinture » : non pas des caractéristiques de tel ou tel courant en particulier (I ‘impressionnisme, l'expressionnisme, etc.), mais de la peinture en tant que telle, entendue comme une activité ou comme une pratique artistique. En effet, Deleuze n’aborde pas la peinture à partir de son résultat final (à savoir, le tableau entendu comme une œuvre finie), mais se place au niveau de l'acte de peindre lui-même : le but du cours est donc de décrire l'ensemble des conditions qui président à l’acte de création. Plus spécifiquement, l’enjeu est de comprendre comment on passe du monde sensible environnant, avec ses caractéristiques en termes de couleurs et de formes, à une œuvre qui ne se contente pas de « représenter » ledit monde sensible, mais en produit plutôt une transfiguration qu’il s’agit justement d’analyser. Or, selon Deleuze, les conditions fondamentales de l‘acte créatif doivent être recherchées très tôt dans le processus, dès l’'expérience vécue du peintre lui-même, lorsqu’il perçoit le paysage ou l’objet à peindre. Pour cela, il s'appuie notamment sur un témoignage de Cézanne qui rapporte que, pour peindre un paysage, il s’y expose d’abord longuement, souvent en plein soleil, de sorte que, lorsqu’il en revient, « les yeux [lui] sortent de la tête, sont injectés de sang ». Selon Deleuze, ce genre d’expérience n’a rien d’anecdotique et constitue au contraire une des conditions psycho-physiologiques premières de la création picturale. Le peintre doit en passer par un moment d’« effondrement des coordonnées visuelles’ » (p. 101) qui consiste à déstabiliser nos habitudes perceptives, et que Deleuze nomme la « catastrophe » (p. 18).
Ces « coordonnées visuelles » désignent l'ensemble des schémas ou des patterns qui organisent inconsciemment notre expérience perceptive et que Deleuze appelle des « clichés » visuels (p. 42-43). Ainsi, la notion de « cliché » ne désigne pas seulement un type de production artistique — au sens d’une image banale et stéréotypée ; elle désigne également le dispositif de cadrage perceptif qui conduit à interpréter (ou à réagir a) une scène quelconque de manière banale et stéréotypée. Pour pouvoir créer une image qui ne soit pas une simple représentation d’une structure sensible préexistante, il faut donc en passer par une étape de destruction de ces structures organisationnelles — étape que Deleuze situe essentiellement dans le face-à-face qui oppose le peintre à son objet et qu’il décrit comme un brouillage (voire un chaos) des coordonnées visuelles standard.
Les combats de l’œil et de la main Ces coordonnées désignent des caractéristiques diverses qui renvoient tantôt à la vision à distance (qui permet d’appréhender une scène dans sa totalité), tantôt à la perception d’objets parfaitement individués (qui permet de les identifier avec précision), etc. Habituellement, cet ordre optique dicte au peintre le modèle qu’il doit reproduire sur le tableau — de sorte que la main est subordonnée à l’œil, selon une métaphore qui parcourt 'ensemble de l’ouvrage. Mais la catastrophe vécue par le peintre, en détruisant cet ordre optique, libère également la main de son rapport de subordination : la main ainsi autonomisée produit une série de lignes ou de traits (qui virent éventuellement au gribouillage) dont la logique est d’abord cinétique avant d’être optique. Deleuze suit ici les analyses de Wilhelm Worringer qui évoque ces moments où le peintre est animé d’une « forte impulsion intérieure », pulsion qui prend le pas sur la volonté de reproduire fidèlement un paysage ou un objet perçu *. Ces développements permettent de préciser la théorie deleuzienne de l'image qui est notamment présentée dans les deux tomes consacrés au cinéma (L'image-mouvement et L'image-temps). D'une part, l’image renvoie à une théorie sensori-motrice de la perception qui stipule que ce que nous percevons dépend de nos capacités d’action. D’autre part, au sein de ce paradigme général, la création picturale commence lorsque l’artiste laisse ses arcs sensori-moteurs habituels être parasités par certaines impulsions qui en brouillent la cohérence. Le cours Sur la peinture multiplie à cet égard les oppositions entre l’optique, et son économie visuelle globale, d’une part, et le manuel, ou l’« haptique », qui ne renvoie pas tant aux mouvements du poignet qu’aux soubresauts du « système nerveux » qui les commande (p. 252). Toute l’histoire de l’art est alors interprétée comme l’histoire du combat de la main et de l’œil. À un extrême, la main suit l’ordre visuel qui s’impose à elle ; à l’autre extrême, la main impose à l’oeil une torsion qui lui permet de percevoir ce qu’il ne percevait pas initialement : « Au lieu que la main suivre l’œil, la main, comme une gifle, va s'imposer à l’œil. Elle va lui faire violence. L’œil aura du mal à suivre le diagramme. [...] Est-ce que l'œil est capable de voir ce que fait la main libérée de l’œil ? C’est compliqué. C’est une véritable torsion du rapport de deux organes » (p. 101). C’est cette torsion qui justifie la mobilisation du cadre sensorimoteur chez Deleuze et justifie qu’il reprenne à son compte la formule de Klee selon laquelle le rôle de l’art est de « rendre sensible » (p. 75) ce qui ne l’est pas encore.
Une nouvelle histoire de l’art pictural
Les clichés correspondent à un certain usage collaboratif et stabilisé des facultés (notamment la subordination du tactile au visuel, mais pas seulement) ; la traversée de la catastrophe conduit à l’élaboration de nouveaux rapports que le philosophe de l’art doit identifier et que Deleuze nomme des « diagrammes » (p. 97). Le diagramme désigne le dispositif grâce auquel le peintre capte des forces invisibles et parvient à les transcrire dans la toile (les rendant, par ce fait même, visibles). Par exemple, le génie de Bacon serait de peindre la sensation du corps qui nous échappe (p. 88), c’est-à-dire l'impression de n’être plus maître et possesseur de son propre corps. Or, pour ce faire, il ne s’agit pas simplement de représenter un exemple de corps qui échappe à la volonté de la personne (un toc, un vomissement, etc.) ; il faut également utiliser une série de dispositifs (de contours allongés, de couleurs délavées, etc.) qui expriment le sentiment de dépossession au niveau pictural.
Parmi les dispositifs étudiés, le cours propose notamment une histoire du dégagement progressif de la ligne de son statut de simple « contour », c’est-à-dire de son indépendance progressive vis-à-vis de toute « figure » préalable, pour devenir un être à part entière. Pour ce faire, Deleuze s'appuie notamment sur les travaux d’Aloïs Riegl, de Heinrich Wölfflin et de Worringer : ces auteurs lui permettent d’identifier différents courants picturaux en fonction des coefficients de déformation du sensible qui prédominent dans telle ou telle manière de peindre. Deleuze en distingue essentiellement trois (p. 142 et suivantes). D’abord, des cas de libération totale de la main par rapport à l’œil, qui correspond schématiquement à l’expressionnisme ; ensuite, des exemples où la maîtrise de la couleur et de la ligne se traduit en un véritable code indépendant, qui correspond plutôt à l’abstraction ; enfin, un cas intermédiaire où les formes sont conservées, mais déformées, et qu’il nomme art « figural ». Cette problématique ne prétend probablement pas rendre compte de l'ensemble des spécificités posées par l’histoire de la peinture ; néanmoins, elle a le mérite de reposer à nouveaux frais un certain nombre d’évidences. Ainsi, Deleuze affirme que le problème de la « perspective » spatiale (le fait de devoir donner l’illusion de la tridimensionnalité et de la profondeur à partir d’un support en deux dimensions) n’est qu’un problème mineur de la peinture, indûment élevé au rang de problème cardinal par certains artistes et théoriciens (p. 115).
De l’éducation de l’œil aux sensibilités environnementales
À cet égard, Sur la peinture pointe dans deux directions que l’ouvrage ne fait qu’indiquer. D’une part, une théorie de l’esthétique de la réception, qui étudierait l'effet de la perception d’un tableau sur la perception générale du spectateur. Si le cours est en effet centré sur l’expérience du peintre, Deleuze avance également l’idée selon laquelle « la peinture fait peut-être naître un œil dans l’œil » (p. 251), de sorte qu’elle produirait une « seconde genèse de l’œil » (p.31), ou aboutirait à la constitution d’un « troisième œil » (p. 109). Ce faisant, Deleuze suit en réalité la thèse bergsonienne selon laquelle le rôle de l’artiste est « de voir et de nous faire voir ce que nous n’apercevons pas naturellement* ».
Mais pour suivre cette ligne argumentative, il faudrait alors ouvrir la théorie de l'expérience de la « catastrophe » (qui, en l’état, s'applique au rapport du peintre à l’environnement et précède la création artistique) sur une théorie de la « catastrophe seconde » : celle-ci s’appliquerait plutôt au rapport du spectateur à son environnement, à travers la création artistique (entendue cette fois-ci non plus comme le « processus » de création, mais comme son résultat final, à savoir le tableau). Il resterait alors à comprendre comment se produit effectivement la lutte contre les clichés — et donc quelle est la portée spécifiquement sociale de l’art au sein d’une telle tension.
D’autre part, et symétriquement, le cours de Deleuze pointe vers une théorie de la production esthétique, qui étudierait les effets de la consommation d’œuvres artistiques. En effet, si les analyses deleuziennes portent spécifiquement sur l’art comme création picturale, c’est-a-dire comme lutte contre les clichés visuels, il n’en reste pas moins que l’art, entendu comme champ social ou domaine socio-historique, est lui-même producteur des clichés visuels que les artistes cherchent à détruire. Or, cette thèse ne doit pas être trivialisée. On s’est en effet habitué, sous l’influence d’Ernst Gombrich ou d’Erwin Panofsky, à considérer qu’il existe une réelle « éducation de l’oeil » et que l’art joue un rôle décisif dans cette éducation. Or, à l’heure de la crise climatique et de l’effondrement de la biodiversité, la question de l’éducation de l’'œil et de la perception de l'environnement retrouve une actualité brûlante. C’est notamment la thèse défendue par Philippe Descola dans Les Formes du visible. Selon lui, le rapport que nous entretenons à notre environnement ne dépend pas ultimement de l’émergence des sciences modernes, comme on le dit habituellement, car ces sciences dépendent elles-mêmes d’une certaine manière de « voir » et de « regarder » le monde qui a été produite par les peintres de la Renaissance:
« Ce n’est pas seulement la géométrie projective du XVII siècle qui est [...] un produit de l’atelier d’artiste, c’est plus probablement la totalité de la reconfiguration épistémique dont témoignent les œuvres de Galilée, de Bacon ou de Descartes qui peut être envisagée comme le résultat d’une nouvelle façon de regarder et de dépeindre les hommes et les choses apparues deux siècles plus tôt ».
Cette articulation entre nos manières de voir et d’exploiter la nature, entre nos clichés visuels et la nature sur laquelle ils portent, constitue une des actualisations possibles du cours Sur la peinture, à la croisée de la phénoménologie de l’expérience artistique et de l’histoire des « sensibilités environnementales ».


Du même auteur
- Présentation de Sacher-Masoch, 1967
- Logique du sens, 1969
- Spinoza et le problème de l’expression, 1969
- Capitalisme et schizophrénie 1 : L’Anti-Œdipe, 1972
- Kafka, 1975
- Superpositions, 1979
- Capitalisme et schizophrénie 2 : Mille plateaux, 1980
- L’Image-mouvement. Cinéma 1, 1983
- L’Image-temps. Cinéma 2, 1985
- Le Pli, 1988
- Périclès et Verdi, 1988
- Critique et clinique, 1993
- L’Ile déserte et autres textes (1953-1974), 2002
- Deux régimes de fous, 2003
- Lettres et autres textes, 2015
- Sur la peinture, 2023
- Sur Spinoza, 2024
- Sur l'appareil d'État et la machine de guerre, 2025
- Sur les lignes de vie, 2025
Poche « Reprise »
- Pourparlers (1972-1990) , 2003
- Spinoza Philosophie pratique , 2003
- Foucault , 2004
- Qu'est-ce que la philosophie ?, 2005
- Présentation de Sacher-Masoch , 2007
Livres numériques
- Foucault
- Présentation de Sacher-Masoch
- Capitalisme et schizophrénie 1 : L’Anti-Œdipe
- Capitalisme et schizophrénie 2 : Mille plateaux
- Kafka
- Qu'est-ce que la philosophie ?
- Critique et clinique
- Deux régimes de fous
- L’Ile déserte et autres textes (1953-1974)
- L’Image-mouvement. Cinéma 1
- L’Image-temps. Cinéma 2
- Le Pli
- Logique du sens
- Pourparlers (1972-1990)
- Présentation de Sacher-Masoch
- Spinoza et le problème de l’expression
- Spinoza Philosophie pratique
- Lettres et autres textes
- Périclès et Verdi
- Sur la peinture
- Sur Spinoza
- Sur l'appareil d'État et la machine de guerre
- Sur les lignes de vie
