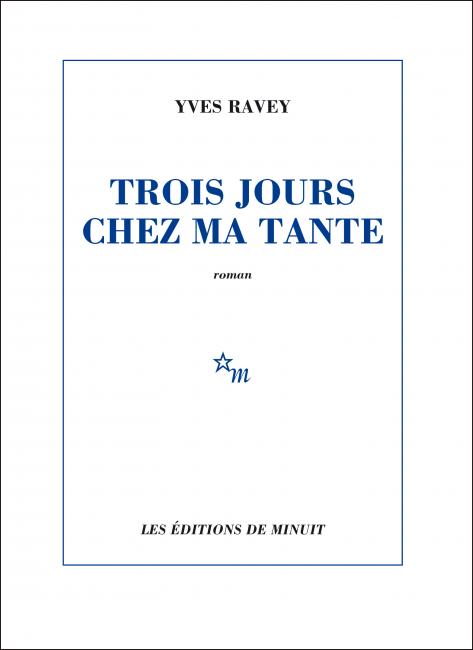
Yves Ravey
Trois jours chez ma tante
2017
192 pages
ISBN : 9782707343598
15.00 €
30 exemplaires numéotés sur Vergé des papeteries de Vizille
Après vingt ans d’absence, Marcello Martini est convoqué par sa tante, une vieille dame fortunée qui finit ses jours dans une maison de retraite médicalisée, en ayant gardé toute sa tête.
Elle lui fait savoir qu’elle met fin à son virement mensuel et envisage de le déshériter.
Une discussion s’engage entre eux et ça démarre très fort.
ISBN
PDF : 9782707345509
ePub : 9782707345493
Prix : 7.99 €
En savoir plus
Patrick Kéchichian, La Croix, jeudi 7 septembre 2017
À nouveau, le romancier cerne au plus près de l’action qu’il raconte et s’interdit toute évasion ou interprétation
Quand on lit un roman d’Yves Ravey, on voudrait entrer, par effraction, pour un instant, dans la tête de l’auteur. Cela afin de mesurer ses intentions, ses sentiments surtout, d’évaluer quelles pensées le guident, quelle idée préside à l’invention de l’histoire qu’il est en train de nous conter. Comme si le résultat, c’est-à-dire le roman construit, écrit, publié, avec son intrigue bien délimitée, avec ses personnages, leurs noms, leurs actions, etc., ne suffisait pas et qu’un lourd mystère planait, que la lecture ne dissipe pas – bien au contraire… Et pourtant, au départ comme à l’arrivée, tout semble limpide : pas de complications psychologiques, pas de narration emberlificotée, à plusieurs niveaux, pas de troubles étalés, disséqués, de la conscience des personnages. Dans le précédent roman, Sans état d’âme (Minuit, 2015), les ressorts de l’intrigue étaient actionnés avec une certaine subtilité : il y avait comme un tremblement. Ici, ces mêmes ressorts sont visibles, la ligne narrative est volontairement épurée… Et cependant, le mystère demeure. Et même exposé à la pleine lumière, il n’est pas levé à la fin du livre.
Un homme, Marcello, débarque à Lyon (même si la ville n’est pas nommée) pour trois jours. Il vient du « Liberia, comté de Grand Bassa », où il s’occupe – pas dans une parfaite transparence à ce qu’il paraît – d’une organisation humanitaire dédiée aux enfants et à la pédagogie. Il vient voir – pour trois jours, comme le titre et l’unité de temps du récit l’indiquent – sa tante, Vicky, pensionnaire dans une confortable résidence pour personnes âgées. Elle est riche, à la tête d’une fondation, soucieuse de son héritage. D’ailleurs, elle a le projet d’en priver son neveu, dont la parfaite honnêteté n’est pas avérée… D’autres personnages gravitent autour de ces deux protagonistes. Certains sont présents et interviennent : comme Lydia, l’ancienne épouse de Marcello, ou Paméla et Corinne, employées de l’institution, et aux petits soins pour Vicky. Un autre fait une apparition muette de quelques minutes : Rébecca, la fille de Lydia qui croise pour la première fois son père, Marcello. D’autres figures, et pas des moindres, demeurent dans les coulisses. Ainsi Walter, un complice grugé de Marcello.
Inutile d’aller plus loin dans la description de l’intrigue, de ses complications, à la fois inattendues et scrupuleusement circonscrites. Comme dans un roman policier, on reste suspendu à l’action, dans l’attente de son dénouement. C’est bien le destin des protagonistes qui est en jeu, leur avenir, leur vie et leur mort. Simplement, cette action, si minutieusement décrite fût-elle, sans échappée ni digression, donne au lecteur un sentiment de forte (mais indéterminée) inquiétude. Chef d’orchestre, Yves Ravey ne cherche à imposer aucun point de vue – même si un lointain arrière-fond de préoccupations politiques et sociales, morales aussi, est présent. Finalement, le charme très singulier de son art est concentré dans la diffusion et l’organisation de cette inquiétude. Peut-être, à un moment, l’auteur devrait-il nous aider à la résoudre, ou à l’apaiser ?
Jean-Baptiste Harang, Le Magazine littéraire, septembre 2017
Règlement de comptes
Un certain Marcello, ayant refait sa vie au Liberia, est rattrapé par des magouilles passées et convoqué par sa tante qui met fin à sa rente mensuelle. Un roman écrit au bistouri, qui tranche là où ça fait mal, jusqu’à couper le souffle.
A l’automne 2005 l’Académie Goncourt couronna un beau livre de François Weyergans, intitulé Trois jours chez ma mère, c’était un bon titre. Dans peu de semaines, si ces jurés, tenus pour raisonnables, ont un peu de suite dans les idées, ils vont immanquablement choisir ce Trois jours chez ma tante, Yves Ravey ne l’aura pas volé, tant son roman vaut bien plus qu’il ne coûte. Et, comme on dit à la Française des jeux, tous les gagnants auront tenté leur chance. Si l’opération réussit, sachez que les titres, Trois jours chez mon naturopathe et quelques autres du même tonneau ont été déposés.
Yves Ravey ne mange pas de ce pain-là, il tombe des nues lorsqu’on le taquine avec cette mauvaise blague : son roman s’appelle Trois jours chez ma tante pour la seule et bonne raison que son héros et narrateur vient de Buchanan (comté de Grand Bassa, Liberia) passer trois jours chez sa tante (à Lyon, probablement, mais le nom de la ville n’est pas cité), et que ça va barder. Ne comptez pas sur Yves Ravey pour faire la moindre concession à l’optimisme en vogue, et assurez-vous : comme dans la bonne quinzaine de romans qui ont précédé celui-ci, tout finira mal.
Tout finira mal, et le mal ne finira jamais. L’essentiel de l’œuvre d’Yves Ravey est là : donner à voir le mal qui est en l’homme, un mal inéluctable et inhérent à la condition humaine, et le dire sans le moindre jugement moral, le dire come un fait inavouable. L’homme est un petit monsieur, tordu, compliqué, mesquin, inconscient de sa propre turpitude, hâbleur. Les autres ne sont que des victimes, des obstacles à l’éclosion de sa médiocrité. Grand bien leur fasse.
La médiocrité du mal absolu
Revenons à notre neveu, les seules lignes écrites à la troisième personne le présentent sur le dos du livre, on peut les croire, elles sont de l’éditeur : « Après vingt ans d’absence, Marcello Martini est convoqué par sa tante, une vieille dame fortunée qui finit ses jours dans une maison de retraite médicalisée, en ayant gardé toute sa tête. Elle lui fait savoir qu’elle met fin à son virement mensuel et envisage de le déshériter. Une discussion s’engage entre eux et ça démarre très fort. » Le roman, lui est écrit à la première personne du singulier, c’est Marcello qui raconte, un type effectivement assez singulier, il demande à être cru, on le croit un peu, beaucoup, patiemment, puis pas du tout. Le tour de force d’Yves Ravey est là : donner la parole au personnage le plus louche, le plus douteux de l’histoire, et à lui seul. Il n’est pas sans charme, il embobine le lecteur comme il tente de baratiner tous ses interlocuteurs. Nous ne sommes pas dupés longtemps, mais assez pour nous attacher à un homme peu recommandable qui court à sa perte pendant deux cents pages, qui l’a bien mérité et que pourtant on plaint un peu, au moins par indulgence envers soi-même, de n’avoir pas vu assez vite à qui nous avions affaire. Ou par une sorte de pitié que l’on devrait à la médiocrité du mal absolu.
Voyons les faits : Marcello Martini, malgré cette double initiale supposée lui porter chance, est pris dans l’étau de ce que l’on pourrait, certes sans élégance, appeler la loi de l’emmerdement maximal, avec la circonstance aggravante qu’il ne peut s’en prendre qu’à lui-même. Ce que l’on va dire ne dévoile rien de ce qui se met en place dès le début du livre, l’enjeu n’étant pas l’engrenage des rebondissements mais de suivre le narrateur prisonnier de son sombre destin, où es chances de s’en sortir s’amenuisent de page en page. On apprend vite que Marcello a quitté précipitamment la France voici vingt ans, avec de faux papiers, pour ne pas être mêlé à un transfert clandestin vers la Suisse de fonds appartenant à sa tante. Le convoyeur, un certain Walter, s’est fait arrêter et condamner sur dénonciation. Marcello a passé ces eux dernières décennies au Liberia, à la tête d’une école censée recueillir de jeunes migrants, survivants de génocides, aux frais d’institutions internationales et de sa tante fortunée. On comprendra bientôt que ce n’est pas si simple mais bien pis. Il est à la fois convoqué par sa tante à Lyon pour être déshérité, à Monrovia pour finir en prison, et par sa femme qu’il n’a pas vue depuis ce temps et qui veut lui présenter une fille qui n’est pas forcément la sienne. Et pourquoi pas celle de ce fameux Walter ? Voilà en tout cas un bon mobile pour avoir dénoncé Walter. Nous verrions bien.
C’est tout vu. La tante de Marcello s’appelle Vicky, premières retrouvailles, page 19. « J’ai poursuivi : Je croyais que cette affaire Walter était enterrée, alors, de quoi s’agit-il, s’il te plaît, Vicky… ? Silence de sa part. J’ai repris (ça avait le don de me hérisser, son histoire) : … Ton directeur financier, Walter, s’est fait arrêter il y a vingt ans à la frontière suisse, une mallette contenant des liasses de billets dans le coffre de sa voiture. Il les transférait, sans les déclarer, évidemment, pour les placer dans un coffre, le sien, et pas le tien… Que veux-tu que j’y fasse ? On l’a inculpé quelques jours plus tard d’extorsion de fonds et de blanchiment d’argent. Alors, j’aimerais bien savoir où est le problème ? Eh bien, figure-toi Marcello, qu’il y a du nouveau… » le nouveau ? On a retrouvé la lettre de dénonciation.
Roulette russe
À mesure que l’on accorde de moins en moins de crédit à ce que raconte Marcello Martini, on s’accroche, car Yves Ravey, lui, on le croit sur parole. Il donne des détails pour que l’effet de réel soit atteint au plus vite, les petits gestes de la vie quotidienne, justes, vécus, indéniables, comme on le dit de l’oreille, il a l’œil absolu. Pas de fioritures, il écrit simple, court, nerveux, sec, sévère, modeste, il écrit au bistouri, tranche là où ça fait mal. Il donne l’impression de sauter des phrases, pour gagner du temps, mais aucune ne manque, pour couper le souffle du lecteur, il pousse le texte vers son destin, vers sa chute, vers sa fin. Ce n’est pas un thriller, un page-turner, comme ils disent, en français, non, il n’y a pas d’autre suspense que la sensation fébrile de lire avec un colt sur la tempe. Allez jusqu’au bout, vous verrez bien comment on peut jouer à la roulette russe avec une cartouche d’encre violette.
L’œuvre d’Yves Ravey, essais, pièces de théâtre e romans, deux bonnes douzaines de titres depuis presque trente ans, et malgré une apparente diversité, semble fouiller une même interrogation : De quoi sommes-nous coupables ? De quel mal sommes-nous capables ? Sommes-nous tous coupables du mal de quelques-uns qui nous ressemblent ? Saurons-nous faire le départ entre le bien et le mal ? Sommes-nous du même sang, de la même eau, du même genre humain que nos bourreaux ? Ses livres sont des fables extrêmement concrètes et désespérantes, elles tournent autour de ce centre, le frôlent, le pénètrent parfois, de façon explicite (Alerte, en 1996, une parabole sur l’univers concentrationnaire) ou autobiographique (La Table aux singes, 1989, Le Drap, 2003), où l’on reconnait le parcours de sa famille, exemplaire et ébréchée par l’histoire, une mère autrichienne et un père franc-comtois, prisonnier de guerre, qui retourne après guerre épouser la fille des fermiers qui le gardaient. Pas un livre sans qu’une page ne le relie à ces temps : ici, page 49 et 50, la déportation de tante Vicky, la spoliation de ses biens, et le marchand de chaussures délateur. Par-delà le bien et le mal, Yves Ravey cherche, si elle existe , la place de l’innocence au monde.
Jérôme Garcin, L’Obs, 28 septembre 2017
Angoissant Ravey
Marcello Martini revient en France comme il l’avait quittée, en catimini, en courbant l’échine et en longeant les murs. Vingt ans plus tôt, il avait été poussé dans un avion à destination de l’Afrique afin d’échapper à la justice et à la vengeance d’un filou dénoncé par lettre anonyme. Il s’était installé au Liberia, où il se targuait de venir en aide aux enfants déshérités - on découvrira pus tard qu’il les exploitait. Marcello Martini est l’un des personnages les moins fréquentables de cette rentrée littéraire. Il est veule, lâche, obséquieux, délateur, cupide, fripon et fanfaron. Mais on met un certain temps à découvrir sa vraie nature. C’est lui, en effet, qui raconte, à la première personne, avec un talent certain pour la dissimulation, l’histoire qu’on est en train de lire. Au début, on serait même enclin à le plaindre. Car il est revenu à Lyon pour se voir signifier, par sa tante âgée et richissime, Vicky Novak, sa disgrâce définitive. Non seulement cette ancienne déportée, qui fut spoliée de ses biens, met un terme à ses mensualités, mais aussi elle le déshérite. Comment, sans cet argent, Marcello va-t-il pouvoir poursuivre, au Liberia, son action prétendument humanitaire et pédagogique ? Et pourquoi Mme Novak, qui gère, depuis une résidence médicalisée, une fortune considérable et une fondation d’art, refuse-t-elle soudain son aide à ce neveu en exil ? Marcello a trois jours pour tenter, sinon de la faire revenir sur sa décision, du moins de repartir avec un gros chèque, le dernier. Lors de cette délicate entreprise de reconquête, il va devoir avaler pas mal de couleuvres, composer avec son ex-femme, qui veille au grain, accepter de rencontrer sa fille, dont il nie être le père, et semer l’ancien directeur financier de la fondation, qui avait été arrêté sur dénonciation, la mallette pleine de fric, à la frontière suisse, il y a vingt ans. Mais que croire vraiment dans cette affaire trouble et poisseuse dont Marcello est l’unique narrateur et dont Yves Ravey tire les fils avec un doigté d’ensorceleur ? Le romancier simenonien de « Sans état d’âme » est ici au meilleur de sa forme et de sa perversité. Il déroule le plus simplement du monde une intrigue très complexe, fait monter l’angoisse sous un ciel de plus en plus bas, ne s’embarrasse d’aucune psychologie, ajoute à chaque page des soupçons aux menaces et des ellipses aux règlements de comptes, jusqu’à un épilogue aussi drolatique qu’énigmatique. Yves Ravey est au polar ce que les pointillistes sont à la peinture, avec une couleur unique, le gris, dont il décline avec laconisme les cinquante nuances. Et ça donne, allez comprendre, un roman étincelant.
Christophe Kantcheff, Politis, 5 octobre 2017
Réduire les mots, épaissir le sens
Dans Trois jours chez ma tante, Yve Ravey met en scène un petit escroc rattrapé par son passé. Un roman à l’écriture épurée et propice au mystère. Rencontre.
« J’ai une écriture qui n’est pas forcément celle qu’on attend. » Quand Yves Ravey prononce cette phrase, vous regardant avec ses yeux bleus d’une clarté lumineuse, c’est sans forfanterie aucune. Il s’en faudrait même de peu qu’il s’en excuse. Mais c’est comme ça. Il peut aussi s’en inquiéter. C’est pourquoi sa sélection sur la première liste du Goncourt – événement inédit pour lui après quinze romans publiés – lui a « fait plaisir ». Tout de même, il pense que dans la littérature, il y a du « convenu ». Comment lui donner tort ?
Quand on l’interroge sur les caractéristiques qui singularisent son écriture, il n’hésite pas : le traitement de la psychologie. Certains commentateurs ont dit que ses personnages en étaient dénués. Erreur. La psychologie est présente, mais jamais mise au premier plan, toujours suggérée. « Je ne crois pas nécessaire de céder aux stéréotypes selon lesquels un individu doit être décrit comme « inquiet », « heureux » ou « perplexe », explique-t-il. Je préfère exprimer un sentiment à travers un geste, une mimique, le choix d’un vêtement, sans que cela soit trop appuyé non plus. Dans la vie aussi on se perçoit les uns les autres sur des choses infimes, et rapidement. » On aura compris que le contrat avec le lecteur a ses exigences. Point de passivité, mais une grande attention requise pour décoder, imaginer.
Le personnage principal de Trois jours chez ma tante rejoint une cohorte d’autres déjà rencontrés chez Yves Ravey : un genre d’escroc, à l’intelligence modérée. Celui-ci a pris la poudre d’escampette vingt ans auparavant parce qu’il trempait dans des histoires louches, et s’est installé dans un pays africain où il ne se conduit pas mieux. Il y vit toujours quand s’ouvre le roman. Mais Marcello Martini – c’est son nom, pas très sérieux… - se voit obligé de renter en France pour quelques jours car sa très vieille tante, qui jusque-là lui assurait un virement mensuel, l’a convoqué chez le notaire en même temps qu’elle a décidé de lui couper les vivres.
La scène des retrouvailles est représentative de la manière dont Yves Ravey esquisse les profils psychologiques. Il commente : « Après avoir subi les premières questions de sa tante, qui requiert des éclaircissements sur sa conduite, Marcello n’a qu’une envie, celle de s’allumer une cigarette, devant elle de surcroît. C’est une réaction adolescente, irrespectueuse. D’emblée, je décris un être dépendant psychologiquement vis-à-vis de sa tante. »
Traduire une psychologie à travers un comportement : tel est le behaviorisme. En littérature, Dashiell Hammett l’a porté à son paroxysme. Une référence qui lorgne vers le polar, genre qui est souvent cité à propos d’Yves Ravey, d’autant que certains de ses titres y incitent : Enlèvement avec rançon, en 2010, Sans état d’âme, en 2014… Mais la piste n’est pas sûre. Yves Ravey se sert du roman policier et de ses caractéristiques – une tension narrative, des ambiances particulières comme celles que l’on retrouve dans la province de Simenon… - plus qu’il ne s’y soumet.
Dans Trois jours chez ma tante, Marcelo est rattrapé par son passé : sa tante se doute désormais qu’il a dénoncé par lettre anonyme son directeur financier ; son ex-femme prétend qu’il est le père de sa fille, qu’il n’a pas reconnue ni jamais rencontrée… Il doit déjouer tous ces soupçons en même temps que récupérer de l’argent auprès de sa tante. Il se montre sans scrupule, faisant appel des sentiments de compassion envers les enfants africains dont il prétend s’occuper, mais dont on va comprendre qu’il les exploite.
Pour un romancier, quel est donc le plaisir d’avoir un personnage principal immoral ? « Comme Marcello ne répond à aucune valeur, aucun idéal, la narration avance à sa guise. Toutes les possibilités sont permises. » Cela induit un certain humour aussi, le malfrat tirant davantage vers le pied nickelé que le bandit de haut vol.
Mais rien n’est simple. D’abord parce que Marcello est le narrateur, et, vu le personnage, il n’est pas interdit de s’en méfier. En outre, parce que certains indices suggèrent que les sentiments de la tante et du neveu ne se résument pas à de la suspicion pour l’une, et à de l’intérêt pour l’autre. Ainsi cette phrase étonnante, et détonante, alors que Marcello se souvient qu’enfant il regardait sa tante prenant garde à sa tenue vestimentaire devant un miroir : « J’aurais pu à ce moment, debout dans sa chambre de la résidence, décrire une à une, et de mémoire, ses robes d’été. » « Il y a une relation affective entre eux deux, même masquée », confirme Yves Ravey. C’est peut-être même le sujet ultime et clandestin de ce livre. Enfin, la jolie pirouette conclusive, dont on ne dira évidemment rien, tend vers la fable et produit une « moralité de l’histoire » drôle et paradoxale.
Trois jours chez ma tante n’a donc rien d’un roman transparent. Au contraire, son mystère se concentre, s’épaissit, tout en restant impalpable. Yves Ravey travaille sa langue de cette manière. Une langue sans aspérité apparente, dégraissée, réduite, come on dit en cuisine, pour en obtenir le suc. « J’évite l’abondance de mots. Je fais attention au rythme, au son, à la pesanteur de la phrase. Je ne retranche pas les mots pour le plaisir de retrancher. Ceux que j’enlève viennent charger de leur poids celui qui reste. Il a ainsi plus d’impact. Reste à maintenir le sens, ses nuances, sa profondeur. » Autant dire qu’Yves Ravey exclut tout approximation dans l’usage des mots.
Cette rigueur lexicale est ancrée dans sa biographie. Le romancier s’exprime non seulement avec un petit accent franc-comtois – il vit à Besançon – mais on y décèle aussi quelques tonalités germaniques : sa mère était autrichienne. « Ma mère me parlait non en allemand, mais dans ce dialecte qu’est l’autrichien de la province de Styrie. Son vocabulaire était très réduit, et les mots étaient plutôt crachés. » Dans un très beau texte, Ce qui manque au lexique ne peut être compté, reproduit dans un livre récent assemblant les actes d’un colloque qui lui a été consacré, Yves Ravey s’adresse à sa mère pour lui dire combien ses « silences » l’ont conduit à apprendre « la rigueur de [s]a langue maternelle ». « Prouver que je peux décrire précisément les choses, dit-il aujourd’hui, est une façon de lui rendre hommage. » Comme si le fils offrait en retour à sa mère la langue qu’elle n’a jamais possédée.
Mais ces silences, ceux de sa famille, de sa grand-mère « humaniste », précise Yves Ravey, ont aussi recouvert une réalité historique qui n’a de cesse de le hanter : la Shoah. Hormis dans certains romans de ses débuts, cette préoccupation –ou obsession – n’apparaît pas directement. Ici, elle ressurgit à travers une brève information donnée au sujet de la tante : ses biens furent spoliés. Son neveu a sur ce sujet cette phrase radicale : « Dans notre famille […], on évite d’évoquer cette période de l’Occupation. Ça remplit des feuilles de papier, mais ça ne produit pas d’oubli, ça ne console pas. »
« Je me heurte en permanence à des résurgences, des gens qui sont encore vivants, explique le romancier. On dit que ce sont les derniers des derniers. Mais non. En surgissent d’autres qui étaient adolescents à l’époque, mais déjà des tueurs. » Ce silence familial a fini par soulever en lui une inquiétude fondamentale vis-à-vis de l’histoire. « L’écriture est le seul moyen que j’ai trouvé face au mensonge général. » Trois jours chez ma tante, comme toute l’œuvre d’Yves Ravey, se lit avec félicité autant qu’il se fonde sur une exigence gigantesque.
Du même auteur
- Bureau des illettrés, 1992
- Le Cours classique, 1995
- Alerte, 1996
- Moteur, 1996
- Monparnasse reçoit, 1997
- La Concession Pilgrim, 1999
- Le Drap, 2003
- Dieu est un steward de bonne composition, 2005
- Pris au piège, 2005
- L'Épave, 2006
- Bambi Bar, 2008
- Cutter, 2009
- Enlèvement avec rançon, 2010
- Un notaire peu ordinaire, 2013
- La Fille de mon meilleur ami, 2014
- Sans état d'âme, 2015
- Trois jours chez ma tante, 2017
- Pas dupe, 2019
- Adultère, 2021
- Taormine, 2022
- Que du vent, 2024
Poche « Double »
- Enlèvement avec rançon, 2013
- Un notaire peu ordinaire, 2014
- La Fille de mon meilleur ami, 2015
- Trois jours chez ma tante, 2019
- Pas dupe, 2021
- Le Drap, 2022
- Adultère, 2023
- Taormine, 2024
- Que du vent, 2026
Livres numériques
- Alerte
- Bambi Bar
- Bureau des illettrés
- Cutter
- Dieu est un steward de bonne composition
- Enlèvement avec rançon
- L'Épave
- La Concession Pilgrim
- Le Cours classique
- Monparnasse reçoit
- Moteur
- Pris au piège
- Un notaire peu ordinaire
- La Fille de mon meilleur ami
- Sans état d'âme
- Pas dupe
- Trois jours chez ma tante
- Adultère
- Pas dupe
- Le Drap
- Adultère
- Que du vent
- Taormine
- Que du vent
