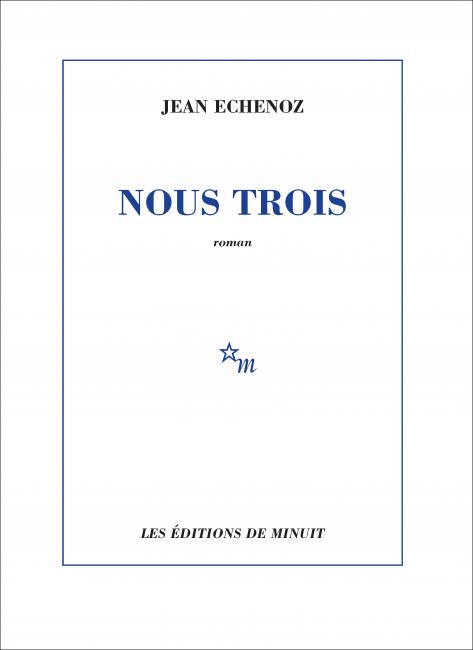
Jean Echenoz
Nous trois
1992
224 pages
ISBN : 9782707314284
25.00 €
99 exemplaires numérotés sur Vergé des papeteries de Vizille* Réédition dans la collection de poche double n°66
Nous sommes, Meyer et moi, des agents de l'astronautique. Hélicoptères, avions, fusées, tout est bon pour nous élever l'esprit. Même les ascenseurs et les grues. Nous aimons tout ce qui est vertical. Nous sommes aussi des hommes à femmes. Nous connaissons par cœur leurs numéros de téléphone et leurs parfums, nous gardons leurs photos, leurs affaires oubliées chez nous. Nous ne les séduisons pas toujours avec le même bonheur. Elle est sans doute une femme inaccessible mais nous la voulons, nous l'aurons. Nous la suivrons partout. Nous trois parcourrons des millions de kilomètres pour découvrir que, si l'espace n'est que routine, la Terre ne manque pas d'affreux imprévus.
ISBN
PDF : 9782707324894
ePub : 9782707324887
Prix : 6.49 €
En savoir plus
Jean-Baptiste Harang (Libération, 27 août 1992)
Echenoz et nous
Tous les romans d’Echenoz sont des romans d’amour. Des amours incertaines, ou tues, souvent inavouées, dans les marges des livres, à l’insu du lecteur.
Echenoz n'est pas né de la dernière pluie. On trouve son nom dans des dictionnaires plus que centenaires. Ce cours d’eau baigne en vain le village d'Echenoz-le-Sec, puis gambadant d'une rive à l’autre de la nationale 57, il traverse Echenoz-la-Méline, à trois kilomètres au sud de Vesoul, avant de se jeter dans le lit de la Colombine. Leurs eaux mêlées. coulées dans de plus gros fleuves. roulent jusqu'à la mer. Puis. en 1914, sous les traits d'un explorateur (“ le célèbre voyageur Echenoz qui lors d'une expédition africaine remontant à sa prime jeunesse était allé jusqu'à Tombouctou ”), Echenoz entre en littérature sous la plume enviable de Raymond Roussel. Il est à l'origine du “ Fédéral ” dans le jardin de Locus Solus. Mais après que son nom aura été cité sept fois par Roussel, Echenoz disparaît à la quinzième page du livre (“ Or Echenoz était mort depuis peu, léguant le Fédéral à son ami... ” etc.. etc.)
Jean Echenoz réapparaît vers le milieu des années 80 de notre siècle au quatrième et dernier étage d’un immeuble parisien de Belleville dont la cage d’escalier supporterait volontiers l'installation d’un ascenseur si l’on voulait bien s’en donner la peine. Sur le palier, une bibliothèque de quelques étagères offre à la discrétion du voisinage l’éventaire des livres qui n’ont pas trouvé leur place à l'intérieur de l’appartement. En 1988, pour participer à une compilation d'autobiographies d’écrivains, il laisse écrire : “ Jean Echenoz, né le 4 août 1946 à Valenciennes. Études de chimie organique à Lille. Études de contrebasse à Metz. Assez bon nageur ”, voir Libération du 12 janvier 1989.
Jean Echenoz, de son vrai nom Jean Echenoz. Est né en 1947 à Orange dans le Vaucluse, son père était médecin, il fit des études de sociologie, probablement à Aix-en-Provence, la vocation d'écrivain le toucha dès l'enfance peut-être après avoir lu à sept ans Ubu Roi et il publia en 1979 un premier roman où l'on peut lire page 220 : “ Il dévida tout un écheveau d'explications ou d'arguments d'où il était impossible de démêler le vrai du faux, en supposant ces catégories susceptibles à elles seules de partager strictement son discours en deux, sans qu'il subsiste un reste. ” (Notons tout de même que personne ne met en doute les qualités narratoires du jeune écrivain et que l'un de ses personnages, le professeur Belsunce, travaille courageusement dans Lac à l'invention d'une nouvelle nage cousine de l'indienne, et que Georges Chave, à la fin de Cherokee, trompe l’ennui et la peur en épuisant une contrebasse : “ Vêtu d'un slip et d'un paire de lunettes noires, il jouait interminablement dans le soleil de la fenêtre, ... collé au sarcophage bourdonnant comme contre une femme. ”) Difficile d'en savoir plus, surtout que six pages plus haut on vient de lire : “ On ne s'expose pas sans risque aux confidences comme à certaines radiations. ” Le livre s'appelle Le Méridien de Greenwich, publié, ainsi que ceux qui le suivront, aux Éditions de Minuit il s'en vendra la première année 400 exemplaires comme autant de petits pains.
Demain les libraires présenteront à leurs chalands des piles de Nous trois, le dernier roman d'Echenoz, qui se vendra par dizaines de milliers. Jean Echenoz aime à penser que Nous trois est une manière de premier roman, comme si les quatre autres représentaient ses gammes, des livres de genre, ces “ chefs-d’œuvre ” que les compagnons de jadis réalisaient d'excellence pour pouvoir regarder leurs maîtres dans les yeux. Le Méridien de Greenwich serait alors un hommage aux premiers romans, Cherokee au roman policier, L’Équipée malaise au livre d'aventures et Lac au roman d'espionnage. Et les maîtres sont nombreux, au moment de la rédaction de Lac, Echenoz en déroula une liste au débotté : Roussel, James, Racine, Ambler, Conrad, Brecht, Manchette, Wolfson, Stevenson, Nabokov, Segalen, Littell, Robbe-Grillet, Chesterton, Audiberti, Tutuola, Stark, Sachs, Schwob. En lisant par-dessus son épaule le dos des livres dans l'appartement sans ascenseur on pourrait allonger la liste de quelques mètres de rayonnages, Queneau, Giraudoux, Vian.
Ainsi Nous trois marquerait les débuts de notre “ assez bon nageur ” dans le grand bain de la littérature. Oui et non, comme toujours. Et heureusement. Oui parce qu'Echenoz s'éloigne de ce qui semblait être sa manière, son côté “ Samuel Beckett contre Docteur No ”, prend le virage nécessaire qui permet de ne pas toujours faire le même livre. Non puisque l'écriture est la même, le seul fond de sauce de l'écrivain, et il affine ici ce ton tristement amusé et sa vision cinétique du récit qui forcent notre appétit à lire. Non, car les thèmes enfouis dans les précédents. romans, sous couvert de “ livres de genre ”, tendent encore plus violemment celui-ci. Echenoz était prévenu : “ Lorsque j'ai fini Lac j'ai pris une feuille de papier en réfléchissant au prochain et j'ai écrit : cette fois plus d'histoire de type abandonné, finie la séquence séduction/abandon. ” Voyons plutôt.
Le premier mot de Nous trois est “ Je ”. L'abonné est surpris. Jean Echenoz a bien écrit deux nouvelles à la première personne ( J'arrive , 1988, dans Le Serpent à plumes n°3, et Ayez des amis , 1991, dans Semaine de Suzanne, Éditions de Minuit) mais ses romans sont tous d'un narrateur, une troisième personne anonyme et omniprésente qui connaît la suite des choses et les restitue pourtant dans un désordre narquois. Ici “ je ” est un homme, il possède cent chemises et vit avec Titov, un animal d'indifférente compagnie et d'espèce incertaine. Il porte un nom italien avec une majuscule en plein milieu, et encore, il ne se présentera qu'au chapitre 23 après avoir à peu près disparu. Car, dès le chapitre deux, L'abonné croit retrouver ses marques, “ je ” a disparu, laissant place à “ il ” qui a l'air de bien connaître Louis Meyer que nous ne quitterons guère avant de refermer le livre, “ Louis Meyer, homme astigmate et polytechnicien, quarante-neuf ans jeudi dernier. Homme infidèle et divorcé d'une femme, née Victoria Salvador le jour de L'invention du poste à transistor. Homme seul et surmené qui va se payer, pour son anniversaire, une petite semaine à la mer ”, page 14 (tous les malpolis qui s'intéressent à l'âge des femmes savent que le transistor a été inventé en 1948). La mer est à Marseille, Louis Meyer suit l'autoroute du Sud dans une automobile de marque indifférente jusqu'à ce qu'il embarque une femme aux cheveux rouges dont la Mercedes jaune vient de brûler. La jeune femme se tait jusqu'à Marseille, “ d'accord, appelons-la Mercedes et n'en parlons plus ” se dit Meyer page 30 du même élan que l'ingénieur Carl Benz (1844-1929) honora sa firme automobile du prénom de sa fille.
Tous les romans d'Echenoz sont des romans d'amour. Des amours incertaines, ou lointaines, ou tues, souvent inavouées, dans les marges des livres, parfois à l'insu du lecteur, L'un des deux toujours vient d'être quitté et s'en remet rarement avant que l'autre ne succombe. Ici l'amour n'est même pas dit puisque l'amante est mutique et anonyme. Et le sentiment d'absence est d'autant plus pesant que le “ je ” narrateur a disparu, la tête au fond du livre, ne refaisant surface, pour respirer un air étranger à l'histoire que l'on suit, qu'aux chapitres 7, 12 et 18, avant de s'installer chapitre 23 au poste de copilote pour le dernier quart du voyage. Entre deux chapitres à la première personne, Echenoz épice le jeu en lâchant de temps à autre un “ regardez-moi ” (page 51), un “ je suppose ” (page 63), un “ souvenez-vous ” (page 67) ou une série de trois “ nous ” (page 94). Confier le rôle du narrateur à un personnage bien placé pour ne rien voir est une invention littéraire redoutable, elle place le lecteur (à qui l'on raconte pourtant tout ce que le narrateur ignore) dans la situation d'un personnage, et non pas de l'auteur : il se sent impuissant à comprendre ce qu'il voit, conscient que ce qu'il voit n'est qu'une partie des choses.
Et pourtant ce qu'on voit n'est pas rien : un tremblement de terre de magnitude 7,9 sur l'échelle de Richter qui détruit Marseille, puis un voyage en orbite à trois cents kilomètres de la terre, cinq passagers dont un élu local vomissant. Le séisme est décrit avec une minutie d'entomologiste rythmée d'élans baroques et de réflexions drolatiques : “ Il était d'un bleu vif, le ciel qui est absolument blanc maintenant, d'un blanc mat mais plus aveuglant que le soleil disparu, lividité striée d'éclairs, de longues déchirures vif-argent, zébrées, rageuses, au-dessus du sol qui se déchire en même temps, se fend de mille crevasses comme si deux miroirs explosaient face à face. ”, page 65 et, quelques pages plus loin : “ On se bouscule sans méthode vers le port, on a tous à peu près le même regard mais on n'est pas tous entièrement habillé, certains serrent contre eux quelque objet sauvé de justesse, imprévisible objet qui est leur passeport autant que leur fox-terrier. Qui, peut-être une sacoche, un plateau, une ombrelle dans une couverture, un listing d'ordinateur, l'édition de poche d'un roman d'Annabel Buffet ”, ou encore : “ Si quelques-unes de ces crevasses, pas plus larges qu'un fossé, vont demeurer béantes après la catastrophe, d'autres beaucoup plus vastes se sont aussitôt refermées, engloutissant les hommes avec les animaux, les serrant à l'état de futurs fossiles qu'on s'arrachera, dans cinq mille ans, pour des sommes inespérées de leur vivant. ” Ces trois niveaux d'observation et nos héros indemnes éloignent le lecteur de la douleur et le laisse distant devant le désastre un peu comme on regarde une catastrophe filmée sans le son.
Le voyage en orbite autour de la terre est d'une autre encre, les mystères et les amours s'y dénouent, la force d'Echenoz à dédramatiser les exploits rapproche “ L'orbiteur ” de Nous trois de la fusée d'Hergé et lorsque notre narrateur enfin nommé (il s'appelle DeMilo comme la Vénus) voit son jus de fraise en apesanteur au bout de sa paille se former en “ une sphère de liquide tremblotant, rose bonbon, format ping-pong et parcourue d'ondes minuscules ” (page 191), on se souvient que le capitaine Haddock nous a déjà fait le coup. Une certaine Lucie fait partie du voyage (“ c'est calme, c'est très calme, ce n'est guère plus compliqué ou risqué qu'un voyage à, mettons, Thonon ”), Lucy in the sky avec ou sans diamants.
Ils sont cinq dans le vaisseau spatial, Nous trois, pourquoi Nous trois ? “ Peut-être le ciel, la terre et moi, dit Echenoz avec un sourire trop modeste pour que cela soit vrai, pour une fois il y a un je : il autorise le nous , nous trois, je, lui et elle. ” Sauf que tout le temps de l'écriture, le livre s'est appelé Le Mal des transports, Echenoz trouvait ça un peu prétentieux, et ne trouvait rien d'autre, du jazz, un pianiste qu'il aime tournait sur la platine, Phineas Newborn, en trio, il suffisait de retourner la pochette : We three. C'est toujours comme ça avec Jean Echenoz, ses yeux butinent, il fait son miel avec tout ce qu’il voit. Les manuscrits de la première version de ses livres, des cahiers cartonnés exotiques et grand format recèlent des trésors d'étiquettes collées, des tickets, des bouts de notes, des coupures de journaux.
Celui de Nous trois, feuilleté trop vite, contient même le plan à main levée de l'orbiteur avec la couchette de chacun et les parcours qu'il saura faire. Prenez le très gros fourgon, détail infime qui masque le coupé jaune aux yeux de Meyer page 103, “ Transports Sylvain Honhon, Lagny (S&M) ”, eh bien il existe et Jean Echenoz aurait pu tout aussi bien vous donner l'adresse complète et le numéro de téléphone, 64 30 56 07, 8 rue Edouard-Branly.
Mais ce n'est pas tout de noter des blagues, ensuite Echenoz passe le texte au laminoir de quatre réécritures successives et complètes. Travail de style et travail de montage. Sa technique cinématographique utilise tantôt le montage “ cut ”, où la moindre ponctuation peut faire changer l'action d'hémisphère, tantôt le fondu enchaîné où la phrase qui ouvre un chapitre reprend les termes qui ferment le précédent. Travelling en plongée sur des parfois deux, trois mille kilomètres, comme au début du deuxième chapitre le simoun en une page traverse le Sahara pour nous conduire d'un coup d'aile chez Meyer, impasse du Maroc dans le XlXe arrondissement de Paris (“ Le simoun, vent très chaud, se lève par bourrasques au sud du Maroc saharien. Il y produit des tourbillons compacts, brûlants, coupants, assourdissants, qui masquent le soleil et gercent le Bédouin. Le simoun reconstruit le désert, exproprie les dunes, rhabille les oasis, le sable éparpillé va s'introduire profondément partout jusque sous l'ongle du Bédouin, dans le turban du Touareg et l'anus de son dromadaire ”, page 13). Des ralentis, retours en arrière où l'on décrypte une conversation téléphonique juste avant que la sonnerie ne retentisse. Arrêt sur image, une phrase s'immobilise en vol dans un discours indirect, puisqu'on connaît la suite.
Jean Echenoz a ses mots, des mots qu'il aime, d'autres qu'il fabrique, réhabilite. Nous trois contient moins de ces extravagants adverbes construits sur tout adjectif passant à portée de main, ces immobilement, tauromachiquement, désordonnément qui, dans L’Équipée malaise, laissaient espérer un mélanodermiquement ou pourquoi pas un radiopariment. On y rencontre plutôt de surprenants et bienvenus dérivés de substantifs inconnus des petits dictionnaires (page 67), la politesse est promiscue (page 82), le corps malade est sparadrapé et page 141, le coup d'œil de Meyer est ressentimental. Et l'on retrouve le fameux mangrove qu'Echenoz ne manque jamais, ici il signifie “ marais ”, en anglais “ palétuvier ”, il vient de Malaisie et, forcément, a poussé comme du chiendent dans L’Équipée malaise.
Dans Le Méridien de Greenwich Jean Echenoz écrivait : “ Les choses qu'on ne peut pas atteindre, on se dédommage en les nommant ”, mais il ne le pensait pas, c'était une tirade de ce salopard de Gutman, lui, Jean Echenoz, il crée en nommant, dès 1979 il coulait dans de précieux métaux des formules aériennes, il disait de Lafont, deux mètres et quelques, qu'“ il portait toujours son immense costume gris qui le faisait ressembler à un chapiteau de cirque triste, comme il y en a au purgatoire ”. En fonderie, un “ écheno ” est un petit bassin d'argile qui reçoit le métal en fusion lorsque l'on coule des statues. “ Echenoz ” n'est pas son pluriel, c'est un nom franc-comtois qui convient aux familles dont les ancêtres vivaient à l'ombre des chênes, comme certain ruisseau de Haute-Saône.
Pierre Lepape (Le Monde, 28 août 1992)
Une esthétique du malaise
Pour dire un monde qui vacille sur ses bases, Jean Echenoz soumet la littérature à un séisme. Avec une infinie légèreté.
Nous ne savons plus rien. Les dieux sont tombés sur la tête, les vieilles certitudes se sont effondrées avec fracas et celles qu'on voudrait nous présenter comme nouvelles ne sont que d'anciens cadavres maquillés. Voilà notre époque incertaine même de son incertitude. Les écrivains disent depuis longtemps cela, dans l'étonnement, dans la fureur, dans la dénonciation ou dans le désespoir. Mais, le disant, ils se raccrochent encore à une certitude, celle d'une écriture encore assez sûre d'elle-même et de ses pouvoirs pour dominer l'océan du doute, mettre de l'ordre dans le chaos général et donner un sens, fût-il ambigu, au désordre des idées et des histoires.
Jean Echenoz s'attaque à cette dernière poche de résistance, à ce dernier noyau d'illusion, à ce dernier pieux mensonge. Avec lui, L'écriture perd ses facultés de dramatiser, d'émouvoir, de convaincre, d'influencer même de manière souterraine et retorse. D'où le sentiment qu'a le lecteur de Nous trois de flotter à la surface du livre, dans un état à la fois délicieux et nauséeux d'apesanteur. Rien ne pèse en effet ici, rien n'est grave, au double sens, moral et physique du terme. Le travail de l'écriture, chez Echenoz, ne consiste pas à doubler la réalité par les mots ou au contraire à la nier – opposition classique autour de laquelle s'organise grosso modo le roman depuis Flaubert, – mais à établir entre la réalité et le livre une distance que l'écrivain s'ingénie à faire varier, selon des rythmes imprévisibles et aléatoires. Un roulis et un tangage qui donneront le mal de mer aux lecteurs les mieux aguerris et les plus intrépides.
Cette esthétique du trouble, du malaise, du déréglement systématique de toutes les bases, Echenoz l'avait mise en œuvre dès son premier roman, Le Méridien de Greenwich (1979), et développée ensuite, avec une obstination discrète et souriante, dans ces variations sur des thèmes romanesques que furent Cherokee (1983), L’Équipée malaise (1986), et Lac (1989). Avec Nous trois, sous des dehors de nonchalance et de désinvolture, elle prend des allures plus manifestes, plus affirmées – ce qui n'est pas sans paradoxe pour une littérature qui se méfie de l'affirmation, comme de la négation.
Affirmation d'abord des capacités de l'écriture à tout exprimer : L'écrivain à qui l'on aurait pu reprocher de prendre par facilité des sujets étroits ou pittoresques – une aventure policière, un thème d'espionnage, un scénario exotique – a choisi ici, non sans malignité, de jouer sur toute la gamme des espaces. Cela va du sable qu'une bourrasque soulève au sud du Maroc saharien et qui, “ faisant frémir au passage le titane des Bœing ”, va poudrer Paris et, notamment, L'impasse du Maroc où réside le héros de l'histoire, jusqu'au voyage dans l'espace qu'accomplit ledit héros, en compagnie d'un des narrateurs. Entre-temps, dans ce monde qui vacille sur ses bases, nous aurons assisté à un tremblement de terre qui dévaste Marseille.
De Lac à Nous trois, nous sommes donc passés du microscopique au macrocosmique. Sans trouver davantage de stabilité et de certitude dans un infini que dans l'autre ; partout le vertige. Mais si l'écriture possède effectivement des pouvoirs descriptifs illimités, si les écrivains les mieux doués peuvent réussir ce qu'on nommera des “ morceaux de bravoure ” – la scène de l'incendie d'une Mercedes sur l'autoroute du soleil en est un, tout à la fois impressionnant et irrésistiblement drôle, – tout cela est sans pouvoir efficace sur les esprits de notre temps. Ce ne sont que des images ajoutées à d'autres images, des spectacles ajoutés à d'autres spectacles : une manière de plus de s'éloigner du monde et de la réalité.
Il y a dans Nous trois une mise en évidence, tranquille, souriante, mais d'autant plus précise, de ce qu'on a nommé “ la société du spectacle ”. Les personnages du roman – le héros, la femme et l'autre – vivent des aventures extraordinaires. Ils sont pris dans le tremblement de terre et dans le raz-de-marée qui détruit Marseille, ils participent à un voyage spatial, mais tout se passe comme si cela arrivait à d'autres, comme s'ils étaient les spectateurs de leur propre histoire, comme si, dans un monde tellement regardé qu'il n'est plus fait que d'images, tout, y compris sa propre vie, y compris ce qui reste d'émotion, de sentiments, de désirs, de pensée, n'était plus que représentations, mollement rythmées par les pulsions de l'instant, sans mémoire et sans projet.
Chez Echenoz, on ne cherche pas à donner un sens à quelque chose, mais à trouver l'angle de vue, la focalisation adéquate qui permettront à cette chose d'être, un instant, spectaculaire, d'occuper le devant de la scène, le bruissement des conversations, quelques minutes de journal télévisé, avant de sombrer définitivement dans l'indifférence et dans l'oubli. Sentons-nous encore ? Pensons-nous encore ? Peut-être, mais plus beaucoup : “ Les gens sur le trottoir d'en face allaient et venaient avec leurs idées, leur petit sac gélatineux de pensées frémissant comme une fleur translucide au-dessus de leur tête, ballottant au rythme de leurs pas. ”
Pour dire ce monde sans mémoire et sans conviction avec quelque chance de dire juste, il ne sert à rien d'employer de grandes phrases définitives. Il faut savoir mettre en scène l'écriture, varier à l'infini les éclairages et les couleurs, surprendre et dérouter par des angles imprévus et, surtout ? demeurer léger, léger... Echenoz confirme ici ses dons de virtuose de la langue, de slalomeur surdoué de la conjugaison, de jongleur un peu pitre de la grammaire. Il fait tant et si bien dans le jeu stylistique, dans la farce rhétorique pince-sans-rire, dans le scenic railway narratif qu'on pourra prendre Nous trois pour ce qu'il n'est pas : un superbe divertissement. Mais Echenoz, malin comme il est, a sans doute inscrit l'éventualité de ce contresens dans la trame déroutante, déstabilisante de Nous trois dont le titre peut aussi se lire : L'auteur, le livre et le lecteur.
Pascale Casanova (Art Press, décembre 1992)
Nous trois et quelques autres
Le roman de la fin
Nous Trois peut être lu comme une entreprise de désacralisation généralisée ; Echenoz réserve le même sort aux genres littéraires qui engendrent la croyance et la piété – comme le roman policier ou le récit de science fiction – qu'à la croyance religieuse. Il amorce une grande opération de détournement de genres dits mineurs et du grand texte mythique de L'Apocalypse.
Quoi de commun entre un tremblement de terre, un raz de marée, les trois personnes d'une très humaine trinité, des pluies de sable et de sang et un satellite qui supervise tout, du plus haut des cieux ? Ce sont simplement les signes canoniques d'une fin du monde annoncée ; un roman en forme de palimpseste de l'Apocalypse selon Saint Jean : “ Et ma vision se poursuivit. Lorsqu'il ouvrit le sixième sceau, alors il se fit un violent tremblement de terre et le soleil devint aussi noir qu'une étoffe de crin, et la lune devint tout entière comme du sang... Et lorsque l'Agneau ouvrit le septième sceau, il se fit un silence dans le ciel environ une demi-heure... Ce furent alors de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre... Et le deuxième ange sonna... Alors une énorme masse embrasée, comme une montagne, fut projetée dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang... Et le troisième ange sonna... Alors tomba du ciel un grand astre, comme un globe de feu... ”
Echenoz ne raconte que cela, mais sur le mode de la banalité, à l'envers de la rhétorique prophétique : la fin d'un monde sans Dieu, sans trompettes du Jugement dernier ; les cosmonautes ont pris la place des anges ou de leurs semblables, et les fusées lancent des satellites omniscients qui voient tout du ciel, comme jusque là Dieu était censé le faire du plus haut des cieux...
Là où Cecil B. de Mille eût fait, en technicolor et cinémascope, du grand spectacle avec effets spéciaux et frissons d'effroi, Echenoz travaille plutôt dans l'esthétique “ nouvelle vague ”, petit budget, grande intelligence des dialogues et extérieurs nuit sans décors de studios. C'est pour cela que ça n’a l'air de rien. Tout le dispositif interdit la grandeur, la grandiloquence et les roulements de tambour pour exhiber une virtuosité littéraire. Des éclairs dans la nuit, par exemple, eussent pu lui fournir matière à de grandes tirades sur les signes prémonitoires de gigantesques catastrophes ou sur la beauté des ténèbres. Mais non, dans Nous Trois cela donne : “ Au-dessus de la mer une vague velléité de clarté, premier accroc de l'obscurité, maille filée dans la trame du ciel noir... ”. Ce prosaïsme apparent, cette désacralisation constante qu'il opère (on voit, lors du tremblement de terre de Marseille, “ la basilique (qui) se décapsule, sa coupole expulsée s'éparpillant sur la Sécurité sociale... ”) permet de déplacer le regard du centre de l'image vers la périphérie. C'est souvent le hors-champ, ou le détail flou en bas à droite du plan, ou la bande-son confuse qui permet de raconter, comme de biais, L'histoire qui n’est jamais tout à fait celle qu'on croit. Celle de la trinité par exemple. Il y a deux hommes. L'un dit “ je ”, et l'autre “ il ”, et une femme qui ne parle pas ou presque pas, et à qui les deux autres s'adressent pour la séduire : “ Pourquoi vous ne me, pourquoi vous faites comme si je ne, comme si on se ? ”. Trois, comme les trois personnes, comme la trinité, comme les pronoms personnels, comme Nous Trois ; L'histoire de Dieu peut-être, ou d'un nouvel homme dieu, capable d'aller au ciel et d'en revenir, de séduire des femmes en forme de “ corps célestes ” ou de “ satellites artificiels ”, d'aimer Lucie, la lumière, de connaître le ciel et d'en lire les signes – pluies de sable ou de sang – et quand il le faut, d'y monter pour mettre en orbite quelques satellites espions. Rien que de très banal en somme. L'histoire d'un monde peuplé de curieux monstres indécidables, ni chats, ni chiens, ni rats, répugnants et pourtant familiers (“ C'est que ça aime bien les genoux, ces petites bêtes là ”), autre façon de désamorcer et le fantastique animalier facile et le bestiaire tératologique de L'Apocalypse selon saint Jean version saint Sulpice. L'histoire d'un homme qui aime une femme qui en aime un autre.
C'est peut-être comme ça que s'écrit un formidable livre de désintoxication, un de ceux qui apprennent l'impertinence à l'égard des choses les mieux respectées au monde, croyances dans le sérieux littéraire ou la piété eschatologique, dans les grandiloquences prophétiques de tous bords. Il y a tant d'écrivains aujourd'hui qui se prennent pour des prophètes de malheur, qu'il vaut mieux lire ceux qui vous apprennent que les choses les plus simples sont aussi les plus difficiles.
Michèle Gazier (Télérama, 26 août 1992)
Le voyage fantastique
Un satellite mis sur orbite réunit, le temps d'une valse dans l'apesanteur, les protagonistes d'une étrange histoire.
Jean Echenoz, c'est d'abord un ton, une note bleue, le friselis d'un sourire qui parcourt des pages d'une rigueur flaubertienne et d'une souplesse toute musicale. Il est de ces auteurs qui peuvent vous raconter n'importe quelle histoire. du banal au fantastique. avec une égale légèreté et une inépuisable malice. Voyez plutôt. Dans le Paris des Grands Boulevards, sous un ciel blanc, un narrateur fait ses mondanités-civilités du jour : vernissage. conférence, serrements de mains et sourires. Son univers ? Le ciel, l'espace, celui des fusée et des satellites.
Dans ce même Paris, côté rue de Tanger et place du Maroc, un nuage de sable arraché au désert saharien vient de s'abattre au milieu de la nuit. Un certain Meyer doit essuyer son pare-brise avant de partir rejoindre le Sud, où il se rend pour de courtes vacances chez son amie Nicole. C'est lui. Meyer, homme anxieux, s'occupant comme le narrateur d'engins spatiaux, que nous allons suivre le long de l'autoroute du Sud, où il rencontre une étrange jeune femme devant une Mercedes prête a exploser.
Des lors, I’itinéraire banal du vacancier se trouble. et ce ne sont pas les événements qui l'attendent à Marseille qui vont apaiser ses angoisses sentimentales et existentielles. ni éclairer ses incertitudes. Car, soudain. Marseille se réveille d'un sommeil millénaire, ses entrailles bougent, la terre se soulève, la mer déferle. Apocalypse now ! Nous nageons en plein drame.
Au milieu de la ville dévastée. Meyer retrouve la jeune femme de la Mercedes. Retour commun et silencieux à Paris. Puis vers de nouvelles aventures qui nous conduiront jusque dans l'espace, où est mis sur orbite un satellite qui réunit. le temps d'une valse dans l'apesanteur, les trois protagonistes de cette étrange histoire.
Tout autre romancier que Jean Echenoz (mais qui pourrait oser une telle acrobatie narrative ?) aurait construit sur cette base une épopée tumultueuse, un récit tourmenté, quelque chose comme un opéra baroque, un drame sanglant, voire une BD. Echenoz, lui, n'est pas porté sur le tragique. Aux éclats et aux pleurs, il préfère la rigueur du regard qui épouse les contours et les formes. Aux sombres percussions, il préfère le tempo léger, un rien moqueur, d'un saxophone à la voix quasi humaine.
Avec lui, le roman quitte les rives de l'intimisme forcené, de la vérité à tous crins, voire de la vraisemblance, pour aborder sur d'autres rivages autrement plus fertiles. Avec lui, le roman peut tout dire : les drames de la solitude, les angoisses de l'homme vieillissant, les petites bassesses du corps et du cœur, les jalousies amoureuses. les mensonges du quotidien, mais aussi les bouleversements cosmiques, la qualité d'un ciel, les révolutions autour de la terre et les petites ironies de la vie.
Pour Jean Echenoz, toute lorgnette littéraire a deux bouts : un petit, pour observer les failles de ses personnages ; un grand, pour débusquer plus loin. dans l'immensité du monde qui nous est à la fois offert et caché, ces fractures et ces catastrophes qui sont les fondements de toute création.
Tous les livres de Jean Echenoz ressemblent à des traversées de l'horizon, à des dérives mélodiques sur tous ces mondes familiers ou étranges qui composent notre univers ; Nous trois, plus encore que Lac, aux allures volontiers policières, échappe à tous les genres et à tous les qualificatifs. Il emporte le lecteur, l'entortille dans les volutes d'une langue classique et l'entraîne. tel un cosmonaute débutant, dans un voyage où il sera secoué, déphasé, parfois un peu perdu, si loin de ses habitudes tranquilles, mais assurément ravi d'avoir ainsi enfreint, le temps de ces quelque deux cents pages, les lois rigides de la pesanteur romanesque. Émerveillé d'avoir gravité dans le bonheur des mots et de découvrir là le roman le plus inventif de cette rentrée.
Du même auteur
- Le Méridien de Greenwich, 1979
- Cherokee, 1983
- L’Équipée malaise, 1987
- L’Occupation des sols, 1988
- Lac, 1989
- Nous trois, 1992
- Les Grandes blondes, 1995
- Un an, 1997
- Je m'en vais, 1999
- Jérôme Lindon, 2001
- Au piano, 2003
- Ravel, 2006
- Courir, 2008
- Des éclairs, 2010
- 14, 2012
- Caprice de la reine, 2014
- Envoyée spéciale, 2016
- Vie de Gérard Fulmard, 2020
- Les éclairs, Opéra, 2021
- Bristol, 2025
Poche « Double »
- L’Équipée malaise , 1999
- Je m'en vais , 2001
- Cherokee , 2003
- Les Grandes blondes , 2006
- Lac, 2008
- Nous trois , 2010
- Un an, 2014
- Au piano, 2018
- Envoyée spéciale, 2020
- Vie de Gérard Fulmard, 2022
- 14, 2024
Livres numériques
- Cherokee
- Courir
- Des éclairs
- Je m'en vais
- Jérôme Lindon
- L’Équipée malaise
- L’Occupation des sols
- Lac
- Le Méridien de Greenwich
- Les Grandes blondes
- Nous trois
- Ravel
- Caprice de la reine
- Un an
- Au piano
- Envoyée spéciale
- Vie de Gérard Fulmard
- Les éclairs, Opéra
- Vie de Gérard Fulmard
- 14
- Bristol