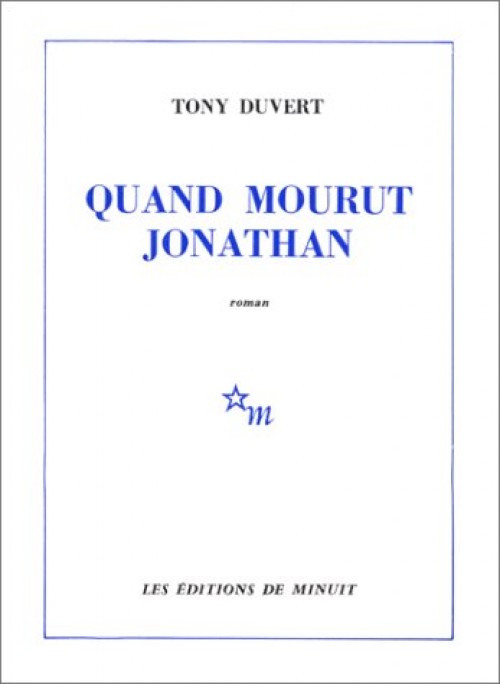
Quand mourut Jonathan raconte l’histoire de deux garçons, un enfant, Serge et un homme, Jonathan.
L’histoire d’une amitié sans phrases et sans interdits. Leurs intimités physiques les plus audacieuses sont sans doute ce qu’elle a de plus ingénu.
Le bonheur n’a pas d’histoire dit-on. Ce serait vrai si personne ne s’en mêlait. Mais Serge a bien sûr, des parents. Très libres et très modernes, d’ailleurs. Ils ignorent seulement que leur fils a besoin d’une liberté moins mensongère que la leur.
Quelle liberté ? Celle de vivre et d’aimer loin, très loin de la famille et de l’école. Sans doute parce que Serge est trop civilisé pour le monde où on l’a fait naître ; pour les “ structures ” qui l’attendent ; pour la barbarie angoissante qu’on enseigne sous le nom d’ordre des choses.
Jonathan, lui, n’a pas de leçons à donner à ce petit garçon entier et fort : il est là pour apprendre, au contraire. Réapprendre l’humanité, l’amour, la vie même. Aux risques et périls de l’élève et du maître.
Bertrand Poirot-Delpech (Le Monde, 14 avril 1978)
Rien de piteux, je trouve, comme ces parents qui se demandent en catimini si leurs gosses se touchent ou couchent, avec qui, comment, plus voracement qu’eux au même âge, ou moins, pas question de se renseigner directement, alors par qui, un prêtre ? Madame Dolto ? Si encore cette liberté qu’eux n’ont pas eue rendait les gamins heureux, mais regardez-les, bougons, terreux, quelle époque !...
Au lieu de barboter ainsi dans l’angoisse feinte et l’idée reçue, les parents feraient mieux de se documenter aux sources, c’est-à-dire en lisant non des traités de psychosocio mais des témoignages directs de la nouvelle génération.
Tony Duvert a la réputation, lui, de confondre liberté et licence. On le dit carrément porno, et il est bien vrai que dans Paysage de fantaisie (prix Médicis 1973) ou Journal d’un innocent (1976), son goût des très jeunes garçons s’étalait avec autant de détails que de frénésie. Mais on peut aussi trouver que ce naturel comporte plus de ferveur vraie que les mièvreries où de tels goûts se sont longtemps dissimulés, jusque dans les publications enfantines réputées prudes et rudes.
Quand mourut Jonathan est une histoire d’amour entre un peintre d’âge mûr et Serge, petit garçon de huit ans. Un amour qui ne se refuse aucune caresse, et y puise son aliment. Mais Duvert s’y attarde moins qu’à l’habitude ; pas plus, en tout cas, que sur les menus gestes domestiques dans le cours desquels le plaisir s’inscrit tout naturellement.
Cette fusion n’est possible qu’en raison du cadre ou se déroule le roman. Nous sommes à la campagne, Pas dans une fermette à moquette : à même le sol et la crotte. La vie se passe dans les odeurs de lard brûlé et les trottinements de souris. Les objets prennent l’usure que le plastique de la ville et le ciment ne tolèrent plus, cette patine qu’on ne voit plus guère qu’au secret des poulaillers et des nIds.
L’amour entre l’homme et l’enfant prend l’aspect et le rythme d’une association biologique. On dirait des bêtes s’épouillant, ou des plantes éliminant mutuellement les poisons nuisibles à l’autre.
La société s’est toujours sentie menacée par de telles connivences avec les règnes et les genres de vie réputés subalternes.
Elle s’exprime ici à travers les parents du petit Serge. À travers est le mot, car on ne peut imaginer un ménage plus étourdi et égoïste. Il ne s’agit pas, pour eux, de rétablir on ne sais quelle règle à laquelle ils ne croient pas, mais d’avoir la paix, Le bon usage sert d’alibi à leur confort mou. C’est souvent ainsi, depuis Roméo et Juliette ou La Dame aux camélias.
Après une séparation forcée le couple traqué se reforme. Mais l’enfant est devenu quelqu’un d’autre. il a suffi de ces quelques mois, qu’a si bien décrits Montherlant, où apparaissent des duvets et des influences imprévisibles, étrangers. L’enfant a appris à nommer ce qu’il sentait intensément hors de tout vocable, et changé la chose pour le mot ; triste troc. Son corps se sent de trop, objet rapporté. Ses étreintes n’ont plus leur place dans la suite des plaisirs et des jours.
Il ne reste à l’adulte qu’à se laisser mourir un peu à la manière de Phèdre : non parce que la chair trop fraîche lui est proscrite, mais parce que l’anti-nature lui conteste une place au soleil. Le suicide n’existe pas. On est toujours tué par quelqu’un. Ici. c’est la norme qui frappe. Le coup du lapin au sortir du clapier bien fumant : schlac !
Ce sixième roman tient d’autant mieux la promesse des autres qu’il se dispense de leurs provocations.
Un univers est donné. et l’écriture qui va avec. Il y rode la bonne dose de perceptions insolites et de souvenirs indéniables, des teintes de ruisseau, des souffles de printemps triste, des odeurs d’enfance démunie.
On y apprend que l’amour meurt de se vouloir social et vit de plonger dans l’animalité. Loin des contrats et des contraintes, le bonheur y retrouve son innocence de bêtes au gîte, son violent goût de ferme.
Stéphane Deligeorges (Les Nouvelles littéraires, 1978)
On comprend alors que l’innocence, ça n’est pas cette pureté niaise que l’on suppose aux enfants, pas plus qu’une perversité anxieuse. C’est un état qui se trouve retranché, à l’écart absolu des gens et des projections des grands. Le Journal d’un innocent avait marqué un tournant d’écriture. Dans ce roman, se retrouve cette même phrase claire, lisse, dominée, adaptée absolument au ton.
Antoine Orezza (La Quinzaine littéraire, 1978)
On retrouve encore ici cet univers religieux, presque militant, des œuvres et des destinées pédophiliques, où l’objet d’amour – le jeune garçon – est fascinant, irrésistible, dépossède l’amant de sa liberté, de son self-control, parce qu’il est la beauté, certes, mais bien plus : son propre paradis perdu, le vrai monde, la vraie vie.
Du même auteur
- Récidive, 1967
- Portrait d’homme couteau, 1969
- Le Voyageur, 1970
- Paysage de fantaisie, 1973
- Le Bon sexe illustré, 1974
- Journal d’un innocent, 1976
- Quand mourut Jonathan, 1978
- L’Enfant au masculin, 1980
- Un anneau d’argent à l’oreille, 1982
- Abécédaire malveillant, 1989
