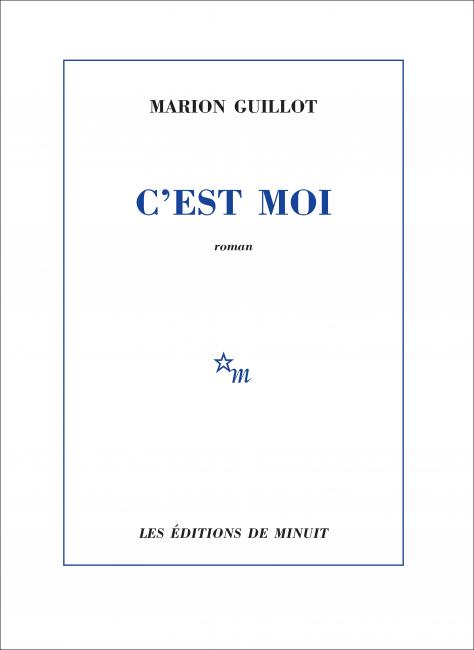
Marion Guillot
C'est moi
2018
112 pages
ISBN : 9782707343987
12.00 €
20 exemplaires numérotés sur Vergé des papeteries de Vizille
Depuis son licenciement, Tristan et moi on vivait côte à côte plus qu'ensemble. Les jours se suivaient et se ressemblaient, les livres s’entassaient par terre et le canapé, qui fait office de lit, à quoi bon le replier ?
On n'avait pas besoin d'une photographie – ni de Charlin, pour couronner le tout.
ISBN
PDF : 9782707344014
ePub : 9782707344007
Prix : 8.49 €
En savoir plus
Jean-Claude Lebrun, L’Humanité, 4 janvier 2018
Marion Guillot
Mortelle révolte
En 2015, son premier roman, Changer d’air, évoquait de chirurgicale façon la sortie de route d’un professeur un jour de rentrée. Une vie d’apparence d’abord normale, puis une insensibilité et une impassibilité croissantes débouchaient sur un tournant radical. Une facette du mal-être contemporain se trouvait restituée de saisissante manière par la romancière née en 1986.
Son deuxième livre va plus loin encore. Dans le TER qui la reconduit vers Paris avec son compagnon Tristan, de retour des obsèques de Charlin, ami et ancien condisciple de celui-ci retrouvé pendu dans son appartement, une narratrice quadragénaire se remémore les derniers mois d’une vie commune « côte à côte plus qu’ensemble ». Depuis son licenciement, Tristan, qui « cherchait vaguement du travail », végétait dans leur logement en désordre, au milieu des livres empilés par terre, tandis que le canapé-lit n’était plus replié. Très régulièrement Charlin débarquait chez eux, s’installait pour la nuit. Pour l’anniversaire de sa compagne, Tristan lui avait offert une photo en noir et blanc « assez réussie », de la hauteur de la pièce, réalisée par lui-même. Les visiteurs éventuels et les voisins d’en face pouvaient l’y voir nue sur une plage portugaise. Ce qui n’avait pas manqué d’inspirer un commentaire à l’écornifleur. Marion Guillot déroule implacablement le récit d’existences gagnées par le désenchantement, au fil de journées qui « se suivaient et se ressemblaient ». Son court récit est à l’image du dessèchement devenu la marque d’un temps sans perspective. Une sorte de Bonjour tristesse pour quadras new age. Et même davantage : Beckett (En attendant Godot) se trouve ici cité en exergue. Pour la narratrice, l’intrus achevant de défaire le lien avec Tristan y tient sa part. En elle bouillonne une révolte dont son compagnon n’envisage pas la possibilité. Si nulle part son nom n’est indiqué, il ne fait pas de doute qu’elle existe encore en tant que personne, quand Tristan paraît s’être vidé de sa substance. La suite du récit, qui emprunte magistralement au roman noir, se présente comme la seule tentative possible d’émancipation à ses propres yeux. Comme si, depuis Changer d’air, il n’y avait plus de recours possible qu’en une radicalité pour garder la main sur sa destinée. Ce qu’assume la narratrice. Marion Guillot confirme en l’espèce la puissance accusatrice de son écriture. Dans son roman, la révolte s’engage sur une voie singulière, noire mais éclairante.
R.L., Le Monde, 5 janvier 2018
Ce qu’il leur aurait fallu, c’es peut-être un philtre d’amour, pour arrêter de vivre « côte à côte plutôt qu’ensemble (…), laissant fadement couler les jours ». En dépit de son nom chevaleresque, Tristan n’a pas su voir ce besoin, ni l’exaspération de sa compagne, la narratrice ; trop occupé à plus ou moins chercher du travail et à passer ses soirées avec Charlin, son vieux copain de lycée, qui s’impose chez le couple plusieurs soirs par semaine, installé dans le salon qui se trouve être aussi la chambre à coucher. Charlin, on le sait dès la première page, est mort. Celle qui l’a tué s’annonce dès le titre : C’est moi. Comme dans Changer d’air (Minuit, 2015), son premier roman, où un homme plaquait sa vie sans raison, Marion Guillot ne s’appesantit pas sur les motivations psychologiques de sa narratrice. Elle excelle en revanche à décrire le quotidien et sa pesanteur. Et, par là, à installer une tension vaguement ironique, mais réelle, à ce deuxième livre traversé d’élans de tendresse qui l’empêchent de n’être qu’un brillant exercice de style.
Christophe Kantcheff, Politis, 8 février 2018
La simplicité même
Dans C’est moi, la narratrice imaginée par Marion Guillot est une héroïne de roman noir autant qu’une femme banale.
« Dans le fond, Charlin devait être quelqu’un de sympathique. » De la part de la narratrice, dont on verra qu’elle ne porte pas ce Charlin dans son cœur, l’incipit de C’est moi est intrigant. Ou ironique. D’une ironie tragique.
Charlin vient d’être retrouvé mort chez lui, une corde autour du cou. Le défunt était un ami de Tristan, le compagnon de la narratrice. Il avait pris pour fâcheuse habitude de débarquer chez eux à l’heure du dîner, les mains vides. Or, à cette période, entre Tristan et elle, à la quarantaine passée, ce n’était plus vraiment ça. Ils vivaient « côte à côte plus qu’ensemble ». La présence récurrente de Charlin n’en était, pour elle, que plus importune. En outre, Tristan, peut-être par désœuvrement – il est au chômage –, a eu l’idée de placer dans leur appartement, avec l’aide de Charlin, prompt à se rincer l’œil, une grande photo d’elle nue, prise l’été précédent. La honte…
Qui est cette femme, cette narratrice qui n’a pas de nom ? « C’est moi », répond le titre que Marion Guillot, dont c’est le second et très réussi roman, n’a évidemment pas laissé au hasard. « C’est moi » peut être entendu comme le fait d’assumer un acte grave : c’est moi qui suis capable de cela. La narratrice a pris ce qu’elle a tant attendu, en vain, de la part de Tristan : une « initiative ». « La seule chose […] qui m’importait, c’est la perspective, même vague, que quelque chose change, bouge ou disparaisse. » L’idée de commettre ce geste s’insinue en elle. Elle s’y abandonne sans difficulté. Tuer Tristan lui a même traversé l’esprit. Elle n’en a rien fait. Mais il lui suffit de débrider son imagination et de mettre en œuvre ce qu’elle a « vu » pour régler son problème. Aussi terribles soient ses projections mentales…
Cela fait-il de la narratrice un personnage effrayant ? C’est que Marion Guillot ne le traite pas ainsi, tout en ne pénétrant jamais sa psychologie. Cette femme a avant tout besoin d’amour, de liberté et de reconnaissance – comme vous et… « moi ». Tout au plus lui accord-t-elle des idées bizarres, en l’occurrence anodines – mais qui n’en a pas ? Ainsi, à propos de la dernière conquête de Charlin, qui « s’appelait certainement Véronique, comme toutes les filles faciles ».
La narratrice, assistante de direction, a des pointes d’érudition. Elle sait que le prénom Charles-Valentin, que Charlin avait contracté, était aussi celui du musicien Alkan, mort sous le poids de sa bibliothèque, qui s’est renversée alors qu’il attrapait le Talmud. Elle connaît aussi cette lubie de Kurosawa de peindre en rouge les pétales des camélias, même dans ses films tournés en noir et blanc.
Ces caractéristiques, à la fois singulières et banales, sont délivrées dans les interstices d’un récit qui vire au roman noir. Tout comme le chapitre, a priori inutile à l’économie du récit, où la narratrice se promène dans les rues, le soir entre chien et loup, et où ses pensées flânent elles aussi. Hors son acte barbare, la narratrice, finalement, ne se distingue pas tant du lecteur, qui lui aussi a ses particularités. « C’est moi »… et ça fait peur.
Jérôme Garcin, L’Obs, 22 février 2018
Sous la couverture blanche, une nouvelle série noire ? Et derrière le 7 rue Bernard Palissy, une annexe secrète du 36 quai des Orfèvres ? On se le demande. On mène l’enquête. Avec une redoutable et délectable constance, mais aussi une discrétion qui est la marque de la maison de Beckett et de Sarraute, Irène Lindon, la patronne des Editions de Minuit, publie en effet des romans dont la prose impeccable et le style en verre fumé dissimulent un nombre impressionnant de cadavres encore chauds. Quand on les retrouve. Car beaucoup disparaissent sans laisser de traces. Après « Article 353 du code pénal » de Tanguy Viel, « Trois jours chez ma tante », d’Yves Ravey, ou encore « Faire mouche », de Vincent Almendros, autant de romans qui scellent l’union clandestine de Chabrol et de Robbe-Grillet, de Melville et de Butor, voici un nouveau diamant noir : « C’est moi », titre qui claque comme un aveu de garde à vue, de Marion Guillot. Tout commence par un drame. Charlin s’est tué. On l’a retrouvé chez lui, les yeux exorbités et une corde autour du cou. Charles-Valentin, alias Charlin, était le meilleur ami et l’ancien condisciple de Tristan. Charlin était aussi très collant. Il ne manquait jamais une occasion de débarquer chez Tristan et sa compagne, qui est la narratrice exaspérée de ce roman faussement laconique. Il vidait les bouteilles et s’installait pour une nuit, ou plus. Tristan, chômeur accro aux puzzles de tableaux de maître, s’accommodait de cet encombrant squatteur, qui divertissait le couple en capilotade. Sa copine, beaucoup moins, surtout lorsqu’elle rentrait du boulot, après avoir traversé « le noir incomplet de la ville ». C’est une photo grand format d’elle à poil, sur une plage, qui allait dérégler l’horloge de ce huis clos. Tristan, croyant lui faire plaisir, alors qu’elle éprouvait le sentiment d’être trahie, la lui avait offerte pour son anniversaire et l’avait exposée, tel un trophée, dans le salon. « Bon sang, avait lancé Charlin avec une élégance de sagouin, qu’est-ce que t’étais bien foutue ! » On n’en dira pas plus. Aussi méthodique qu’ironique, Marion Guillot, ou plutôt sa narratrice, déroule son bref et implacable polar blanc jusqu’au point de non-retour. Elle a choisi de placer, en épigraphe, une phrase d’un auteur de la maison, Samuel Beckett : « Fais-moi penser d’apporter une corde demain. » Chez Minuit – l’heure du crime -, Tanguy Viel et Yves Ravey doivent désormais compter avec une petite sœur aussi douée qu’eux, et pas moins machiavélique.
