
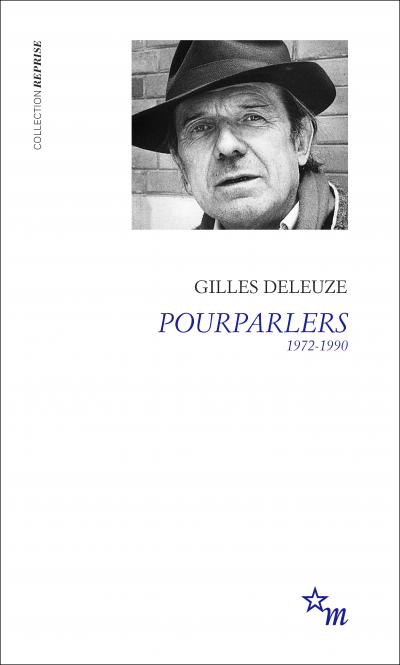
Gilles Deleuze
Pourparlers (1972-1990)
2003
collection de poche Reprise n°6
256 pages
ISBN : 9782707318428
12.50 €
* Première publication aux Éditions de Minuit en 1990.
« Pourquoi réunir des textes d’entretiens qui s’étendent presque sur vingt ans ? Il arrive que des pourparlers durent si longtemps qu’on ne sait plus s’ils font encore partie de la guerre ou déjà de la paix. Il est vrai que la philosophie ne se sépare pas d’une colère contre l’époque, mais aussi d’une sérénité qu’elle nous assure. La philosophie cependant n’est pas une Puissance. Les religions, les États, le capitalisme, la science, le droit, l’opinion, la télévision sont des puissances, mais pas la philosophie. La philosophie peut avoir de grandes batailles intérieures (idéalisme-réalisme, etc.), mais ce sont des batailles pour rire. N’étant pas une puissance, la philosophie ne peut pas engager de bataille avec les puissances, elle mène en revanche une guerre sans bataille, une guérilla contre elles. Et elle ne peut pas parler avec elles, elle n’a rien à leur dire, rien à communiquer, et mène seulement des pourparlers. Comme les puissances ne se contentent pas d’être extérieures, mais aussi passent en chacun de nous, c’est chacun de nous qui se trouve sans cesse en pourparlers et en guérilla avec lui-même, grâce à la philosophie. »
Gilles Deleuze
‑‑‑‑‑ Table des matières ‑‑‑‑‑
I. De L’Anti-Œdipe à Mille plateaux : 1. Lettre à un critique sévère – 2. Entretien sur L’Anti-Œdipe (avec Félix Guattari) – 3. Entretien sur Mille plateaux
II. Cinéma : 4. Trois questions sur Six fois deux (Godard) – 5. Sur L’Image-mouvement – 7. Doute sur l’imaginaire – 8. Lettre à Serge Daney : Optimisme, pessimisme et voyage
III. Michel Foucault : 9. Fendre les choses, fendre les mots – 10. La vie comme œuvre d’art. 11. Un portrait de Foucault
IV. Philosophie : 12. Les intercesseurs – 13. Sur la philosophie. 14. Sur Leibniz – 15. Lettre à Réda Bensmaïa, sur Spinoza
V. Politique : 16. Contrôle et devenir – 17. Post-scriptum sur les sociétés de contrôle.
Roger-Pol Droit (Le Monde, 14 septembre 1990)
Lettre ouverte à Gilles Deleuze
« Vous qui œuvrez à “ la guerre des joies contre les tristesses ”, comment vous remercier ? C’est toute une histoire. Vous savez bien, vous le dites, qu’une telle histoire échappe pour une part à ce qui est historique. J’aimerais vous en dire quelques mots. Il n’est pas mauvais qu’ils soient, pour une fois, personnels et publics tout ensemble.
Pourparlers n’est pas une bonne victime pour un compte rendu. Il m’a fait songer que “ rendre compte ” d’un livre est une affreuse formule. Elle évoque le rapport de police ou d’autopsie, l’assurance des juges ou celle des arpenteurs qui jaugent. Tout cela est bien utile, comme bon nombre de choses affreuses. Mais peut-être est-ce trop utile, ou utilitaire, pour rendre réellement service à qui que ce soit.
Qu’indiquerait un compte rendu ? D’abord que ce volume rassemble des textes publiés dans des journaux et diverses revues entre 1972 et 1990. Il préciserait qu’il s’agit d’entretiens, de lettres, d’articles, où il est question de vos itinéraires, depuis L’Anti-Œdipe et Mille Plateaux jusqu’à L’Image-mouvement et à votre livre sur Foucault – l’ami, le complice, le frère. Il ne manquerait pas de gloser sur vos lectures de Bergson, de Leibniz ou de Spinoza, et sur vos positions concernant philosophie et politique. Mais ce serait somme toute sans importance. Il y a autre chose à tenter : dire ce qui se produit quand on vous lit.
Car c’est cela qui seul vous importe, et vous rend à présent si singulier. Vous rappelez que les discours ne se limitent pas à des objets purement théoriques, qu’ils sont tout entiers traversés d’expérimentations, d’événements, d’aventures du corps, de souffles, de flux. Comme des retours de voyages impossibles qui pourtant ont lieu ou comme d’étranges véhicules pour de nouveaux mouvements de cerveau. Voilà, me semble-t-il, comment il convient de vous lire : en acrobate, en danseur, en gymnaste. Se dire : cette posture de pensée-là, l’ai-je déjà prise ? Puis-je la trouver, la tenir ? Quels circuits emprunte-t-elle ? Est-ce une entrave, ou une aide ?
Vous parlez souvent de respiration. Idée folle : pratiqueriez-vous une sorte de yoga à votre mode ? Je le crois. Dans vos derniers textes (ceux de Pourparlers, mais aussi Foucault ou Le Pli) revient la question de l’irrespirable, du vide où l’on ne respire plus. Peut-être ne cessez-vous de demander à la pensée des voies nouvelles pour le souffle, écartant celles qui le coupent ou l’étouffent, privilégiant celles qui peuvent le ramifier, le faire circuler, l’aider à emprunter des circuits encore à frayer. Sans doute est-ce une interprétation inhabituelle. Mais elle ne paraît pas vous être tout à fait infidèle.
Derrière tout cela, une seule chose : des mouvements. Peu importe, finalement, les contextes. Ils multiplieront indéfiniment les cas de figure.
Votre démarche consiste toujours à permettre des mouvements, à tenter de les penser, prenant ainsi le beau risque d’accompagner leur cours. Démarche politique : “ Si les oppressions sont si terribles, écrivez-vous, c’est parce qu’elles empêchent les mouvements et non parce qu’elles offensent l’éternel. ” Démarche théorique : à un antique amour de la vérité, essence immuable et figée, vous substituez l’attention multiple aux métamorphoses inouïes des langues, des corps, des peuples.
En cela évidemment vous êtes fidèle à Nietzsche. Le premier, il déchira la “ déplorable croyance en la vérité ”. Ou bien, comme vous dites : “ Pas d’idées justes, juste des idées. ” Mais sans doute êtes-vous à présent plus loin, ou plus net, que Nietzsche. Car vous éclairez ce qu’il a seulement suggéré. Par exemple ceci : l’histoire n’est pas le lieu des mutations décisives. Mieux : l’histoire serait seulement le nom des obstacles qu’il convient d’écarter pour qu’advienne quelque nouveauté effective. “ L’histoire, dites-vous, désigne seulement l’ensemble des conditions, si récentes soient-elles, dont on se détourne pour « devenir », c’est-à-dire pour créer quelque chose de nouveau. ”
Cette nouveauté est celle des expériences de pensée. L’histoire en est comme le lieu d’émergence, ou la condition d’apparition. Elle n’en est ni moteur ni cause : “ L’expérimentation n’est pas historique, elle est philosophique. ” En cela vous n’êtes pas seulement fidèle à Nietzsche, mais aussi à Bergson. Après que le Bergsonisme et Cinéma I et II l’eurent mis en lumière, ces Pourparlers disent à leur tour quelle rupture radicale Bergson a, selon vous, introduite dans la pensée.
Et tout va vite, dans cette vingtaine de textes. Ils sont très simples, souvent familiers. Le sel de l’improvisation les parsème et crépite. Leurs lecteurs peuvent être aussi divers que ceux des journaux. Mais moins distraits. Car ce sont des textes difficiles. Pas à cause de leur vocabulaire : il est courant, et sans technicité. À cause de la pensée, et de ses postures. Les mouvements, là encore. Ce que vous appelez ainsi, il faut de la subtilité pour l’entrevoir. Ce serait une erreur de croire qu’ils nécessitent un déplacement, une agitation ou même quelque transport spatial. À vous suivre, les plus bouleversants ont lieu sans que rien, apparemment, bouge. Ainsi procèdent les inventions de souffle, les créations de syntaxe et les révolutions de la pensée. Cela a-t-il dit pourquoi il convient de vous remercier ? Pas encore. J’y viens.
Des pourparlers, ce sont des discours entre guerre et paix. Telle est, pour vous, la place de la philosophie. Elle “ ne se sépare pas d’une colère contre l’époque, mais aussi d’une sérénité qu’elle nous assure ”. Elle ne peut livrer bataille contre ces puissances que sont “ les religions, les États, le capitalisme, la science, le droit, l’opinion, la télévision ”. Elle ne peut que les harceler en menant “ une guerre sans bataille, une guérilla contre elles ”. Mais de tels mouvements de résistance ne mobilisent pas des groupes. La “ guérilla ” que mène la philosophie n’oppose pas les penseurs aux pouvoirs, les marginaux aux tenants de l’ordre ou les créateurs aux gardiens de tous les statu quo. “ Comme les puissances ne se contentent pas d’être extérieures, mais passent aussi en chacun de nous, c’est chacun de nous qui se trouve sans cesse en pourparlers et en guérilla avec lui-même, grâce à la philosophie. ”
Guerre de chacun contre soi : belle définition de la philosophie. Les formes de cette guerre : le style (“ les grands philosophes sont aussi de grands stylistes ”). Ses armes : des concepts qui ne diraient pas l’essence, mais l’événement. Son but : la vie, c’est-à-dire une vie plus grande (“ dans l’acte d’écrire, il y a la tentative de faire de la vie quelque chose de plus que personnel, de libérer la vie de ce qui l’emprisonne ”). Ses ennemis : les puissances ? Oui, mais sous les formes qu’elles prennent au sein de nous-mêmes. Exemple : les pesanteurs de la langue, qui engendrent les lourdeurs de la bêtise et le faux sérieux des conformismes. Parmi de tels ennemis, ne pas oublier le moi (“ on n’écrit pas avec son moi, sa mémoire et ses maladies ”) ni les évidences trompeuses de ce qu’on croit comprendre (“ on parle du fond de ce qu’on ne sait pas ”).
Sans doute savez-vous à présent pourquoi je veux vous dire merci. Parce que vous êtes le seul aujourd’hui à dire si bien que la philosophie est affaire de création plutôt que d’histoire des textes. Parce que vous lui attribuez sans vergogne son rôle impérissable : construire des systèmes et forger toujours de nouveaux concepts. Parce que vous soulignez sans cesse que ce travail a lieu sur fond d’obscurité (“ la pensée n’est pas affaire de théorie ”). Parce que dans une époque effectivement sèche, réactive, manipulatrice, où l’inflation des discours préfabriqués lamine les cerveaux, vous incitez chacun à oser suivre ses voies secrètes.
Je vous remercie en mon nom, et au nom de tous ceux à qui vos livres ont montré ou montreront un jour ce qu’est la force des solitudes. L’Université a fait semblant de ne pas savoir que vous êtes l’un des plus grands. Les pouvoirs feignent toujours de l’ignorer. C’est bien : je vous vois mal encombré d’honneurs. Ils vous iraient mal, parce qu’à vous lire on se sent bien moins craintif, et nullement contraint à la veulerie. Voilà qui est rare, et vital pour tous. Ai-je dit qu’avec vous le rire de la philosophie éclate encore ? Non ? Alors, en un moment si frivolement, si tristement affairé à se prendre au sérieux, il faut célébrer ces joies. Elles nuisent à la bêtise. »
Didier Éribon (Le Nouvel Observateur, 30 août 1990)
Quand Gilles Deleuze prend la parole
Les guérillas de la pensée
Depuis vingt ans, le philosophe a accordé de très nombreux entretiens à la presse. Les voicis enfin réunis.
« Si un chercheur veut un jour étudier les rapports entre la production intellectuelle et les journaux, il devra tenir compte de ce fait : les entretiens qu’y publient les philosophes sont devenus partie intégrante de leur œuvre. C’était déjà vrai pour Sartre, bien sûr, mais encore plus pour Foucault. Et Gilles Deleuze – pourtant peu suspect de complaisance à l’égard de la diffusion journalistique – le soulignait fortement dans l’ouvrage qu’il a consacré à ce dernier.
Deleuze a-t-il pensé qu’il en allait de même dans son propre cas ? A-t-il voulu faire patienter les lecteurs qui attendent le livre qu’il annonce pour l’année prochaine et qui doit s’intituler : Qu’est-ce que la philosophie ? Toujours est-il qu’il publie cette semaine un recueil de ses entretiens parus entre 1972 et 1990, et l’ensemble, il faut le dire d’emblée, constitue un magnifique autoportrait conceptuel, le récit d’une œuvre au miroir des questions qui lui sont adressées, en même temps qu’un étonnant voyage dans vingt années de débats et de controverses, au rythme des transformations profondes qui ont affecté la pensée française.
Les dates disent tout : 1972, c’est L’Anti-Œdipe, écrit par Deleuze avec Guattari. Et L’Anti-Œdipe, pour ceux qui ont oublié, ou qui n’étaient pas nés, ce fut l’un des livres les plus influents de l’après-68. Un flamboiement de 500 pages qui venaient ébranler le règne sans partage de la psychanalyse. On retrouve ici les échos à peine assourdis de cette machine de guerre et de jubilation et l’on comprend aisément le choc qu’elle a pu provoquer. À partir de là, on voit défiler, comme sur un écran, les étapes de la production deleuzienne : Mille plateaux, en 1980, toujours avec Guattari (on regrettera qu’une coquille laisse supposer que l’entretien puisse être daté de 1989, ce qui brouille les lignes pourtant si claires et si importantes de la chronologie). Puis les deux volumes sur le cinéma, L’Image-mouvement et L’Image-temps, avec toutes les interrogations qui pouvaient naître sur les relations entre la philosophie et les différents domaines artistiques ; et le renouveau de l’esthétique qui se dessinait là. Bizarrement d’ailleurs, Deleuze n’a intégré aucun texte concernant son livre sur Francis Bacon et la peinture, Logique de la sensation. II en résulte peut-être un certain déséquilibre quant à la palette réelle de ses préoccupations théoriques. En revanche, Foucault est abondamment commenté : trois longs entretiens. C’est en fait le cœur du livre, dans tous les sens du terme. Car ces pages sont gorgées d’émotion et d’affectivité ; les plus belles littérairement parlant (Deleuze écrit ses entretiens), mais aussi celles où s’exprime le plus intensément sa vision de l’activité philosophique. On aurait envie de tout citer, comme cette formule : “ La logique d’une pensée, c’est l’ensemble des crises qu’elle traverse, ça ressemble plutôt à une chaîne volcanique qu’à un système tranquille et proche de l’équilibre. ” Ou encore : “ Le style, chez un grand écrivain, c’est toujours un style de vie, non pas du tout quelque chose de personnel, mais l’invention d’une possibilité de vie, d’un mode d’existence. ” On reste dans les définitions de la philosophie avec le chapitre sur Leibniz : qu’est-ce que la cohérence d’une pensée ? Qu’est-ce qui passe et s’échange entre la philosophie et ce qui n’est pas elle... ? Là encore, Deleuze nous offre de véritables morceaux d’anthologie. Et le recueil se termine par des textes politiques récents, comme ce dialogue avec Toni Negri, qui date de 1990.
Au fil des pages, et par-delà la variété des sujets abordés, par- delà les évolutions bien normales sur une séquence temporelle aussi longue, on est frappé par l’extraordinaire unité de la pensée deleuzienne, et par la force d’inspiration qui la porte et la pousse vers l’avant, où le vitalisme bergsonien le dispute au gai savoir nietzschéen pour irradier tout ce qu’elle touche. Avec Deleuze, nous assistons peut-être à la réhabilitation du “ système philosophique ” dans la grande tradition classique.
Mais 1972-1990, cela évoque aussi un parcours politique. 1972, c’est l’apogée du gauchisme à la française et Deleuze-le-Vincennois parlait alors une langue qui de nos jours ne se pratique plus guère et dont le lexique ne manquera pas de surprendre plus d’un lecteur. Il est question, par exemple, dans les textes autour de L’AntiŒdipe, du “ fascisme généralisé ”, qui menace l’Europe, des manières d’être révolutionnaire dans cette situation, etc. On doit le dire sans détour : il est parfois bien difficile de se reconnaître dans les considérations qui sont ici reproduites, sauf à pratiquer une gymnastique intellectuelle qui consiste à se replonger dans l’atmosphère de l’époque. Il faut d’ailleurs rendre hommage à l’honnêteté et au courage de Deleuze, qui n’a pas cherché à modifier ou déguiser ses propos. Mais plus profondément, on peut deviner que s’il a procède ainsi, c’est que, sur l’essentiel, il n’a pas tellement changé. Oh, certes, il n’emploie plus, en 1990, le même vocabulaire. Et bien des thèmes ont été abandonnés. Mais on peut toujours entendre cette “ colère contre l’époque ” qui, selon lui, ne se sépare pas de l’activité philosophique. Deleuze n’a rien renié : l’effondrement du communisme dans les pays de l’Est ne confère pas au capitalisme occidental les mérites que certains lui accordent si volontiers, et Deleuze veut rappeler aux apologistes que nous vivons dans des “ sociétés de contrôle ”, ou encore que “ les États qui piétinent les « droits de l’homme » sont de telles excroissances ou dépendances de ceux qui s’en réclament qu’on croirait deux fonctions complémentaires ”.
Deleuze fait front. Il n’essaie pas de louvoyer. Il prend les problèmes à bras-le-corps. Et, au bout du compte, on peut lui savoir gré de maintenir ses positions dans la conjoncture actuelle où tant d’autres ont abdiqué. D’oser encore prononcer des mots (comme “ capitalisme ”) que tout un chacun s’efforce d’éviter, de peur d’apparaître dépassé par le mouvement de l’histoire. La pensée critique n’est pas morte, et la “ politique ” deleuzienne en porte aujourd’hui l’éclatant témoignage. Peut-être faut-il ainsi comprendre le titre du recueil, Pourparlers, qui nous indique que la philosophie n’est jamais loin de l’état de guerre. Une guerre contre les puissances établies, qu’elle mène sans batailles, sans affrontements directs, car elle n’a que peu de moyens, et qui s’apparente plutôt à la guérilla. Mais rien ne vient la décourager. D’autant plus que cette guérilla, Deleuze sait bien qu’il faut la mener aussi contre soi-même, à tout instant, puisqu’il est vrai que les puissances ne se contentent pas d’être extérieures, mais passent en chacun de nous. Penser devient un “ acte périlleux ”, qui éloigne parfois du rivage. Voici donc Pourparlers, qui consigne la chronique de ces risques et périls, et dresse la cartographie des combats. Du passé, du présent et de l’avenir. »
Marc Ragon (Libération, 6 septembre 1990)
Deleuze clandestin
Pourparlers regroupe une quinzaine d’entretiens qui dessine l’espace de la guérilla deleuzienne.
« Pourparlers : le mot ne convient pas seulement pour désigner ce qui est avant tout un ensemble d’entretiens, de dialogues et de lettres. Comme dit Deleuze dans la très brève présentation de ce recueil, la philosophie mène une perpétuelle “ guérilla ” contre “ les religions, les États, le capitalisme, la science, le droit, l’opinion, la télévision ”, et toutes les autres puissances qu’on voudra : cette guérilla demande au minimum une présence sur le terrain, c’est-à-dire une forme d’expression assez claire pour être entendue de l’adversaire. Ce livre, qui rassemble une bonne quinzaine de textes publiés entre 1972 et aujourd’hui, paraît toujours d’actualité : les flèches ont en un sens si bien désigné leurs cibles, qu’elles leur assurent un peu d’éternité.
Cette clarté d’expression, qui donne un sentiment illusoire de facilité, n’est pas la vertu de tous les philosophes. Était-il si facile, en 1972, de “ démolir ” la psychanalyse (même lacanienne !), de jeter avec l’eau du bain le “ signifiant ” et les linguistiques ? L’entretien avec Catherine Backès-Clément (pour L’Arc) nous rappelle à quel point les auteurs de L’Anti-Œdipe voyaient les choses comme des évidences : “ Le signifiant, on n’a rien à en faire ” ; ou bien : “ Nous attaquons la psychanalyse sur les points suivants (... ) : son culte d’Œdipe, sa réduction à la libido et à des investissements familiaux, même sous les formes détournées et généralisées du structuralisme et du symbolisme. ” D’ailleurs, L’Anti-Œdipe était un outil, il devait être éminemment maniable (ce qui fait le succès universel de la Kalachnikov). Issu de Mai 68, il opposait à la psychanalyse un inconscient schizophrénique qui n’était pas seulement une vérité d’école, mais une “ machine de guerre ” : contre le capitalisme et ses codes, ses propres instruments de canalisation des désirs et des conduites individuelles. À l’époque, l’esprit révolutionnaire était dans “ l’air du temps ”.
Ce livre militant a été suivi de Mille Plateaux, présenté comme le deuxième tome d’une entreprise résumée dans le couple “ Capitalisme et schizophrénie ”. Le ton est déjà moins arrogant ou agressif. On est en 1980, on parle de déplacer l’université de Vincennes, signe implicite d’un essoufflement de la ferveur révolutionnaire. Dans une interview accordée à Libération, Deleuze trouve cette fois que “ les concepts (qui sont l’affaire des philosophes) ne sont (justement) pas des généralités dans l’air du, temps ”. Les concepts se créent au contraire comme “ des singularités qui réagissent sur les flux de pensée ordinaires ”. Il s’agit maintenant de créer (des concepts), et non plus de démolir (des systèmes d’ordre). Deleuze n’est plus un stratège, mais un cartographe. Avant, la pensée était claire parce que accessible à tous, maintenant elle l’est parce qu’elle est rigoureuse. Un “ espace ” deleuzien se dessine : celui des devenirs (qui n’ont rien à voir avec l’histoire), des diagonales (qui traversent les disciplines, esquissent des singularités multiples), des événements qui font comme des îles... Toutefois, si on ne parle plus de révolution mais de résistance, c’est par une sorte de repli stratégique : la “ lutte ” continue. “ On est en train de nous fabriquer un espace littéraire, autant qu’un espace judiciaire, un espace économique, politique, complètement réactionnaires, préfabriqués et écrasants. Il y a là une entreprise systématique, que Libération aurait dû analyser. ” Aurait dû. Puis, cette fois en solitaire, Deleuze va “ spécifiquement ” s’intéresser au cinéma. Il préface le livre de Serge Daney, Ciné-journal, parle de Godard dans les Cahiers du cinéma, et surtout il écrit deux livres, L’Image-Mouvement (1985) et L’Image-Temps (1986). Nouveaux entretiens. Deleuze dit et redit que parler du cinéma, pour un philosophe, ce n’est ni une manière d’en faire, ni une manière de parler d’autre chose que du réel. Au contraire, c’est faire entrer par un acte créateur (la conceptualisation) le cinéma dans le réel (où du reste il a toujours été). Dans ce réel cinématographique, on retrouve alors les territorialités, les ordres sociaux, et dans l’ensemble autant de sujets de révolte qu’on voudra. Mais les voilà définis de manière plus précise encore que dans Mille Plateaux, isolés et circonscrits à l’aide de concepts qui prennent l’allure de vrais scalpels. Deleuze a trouvé les mots qui permettent de narrer l’affligeante bêtise d’une télévision, ou au contraire la force de certains cinéastes “ à faire parler ceux qui n’en ont pas le droit, et à rendre aux sons une valeur de lutte contre le pouvoir ”.
Ce n’est déjà plus tout à fait un mot d’ordre. Désormais – l’écoute qui voudra –, la tâche du philosophe est justement de faire en sorte que son langage ne soit pas un “ système de commandement ”, mais de subversion. D’abord la révolution, ensuite la résistance, maintenant la clandestinité. En cela la philosophie est logée à la même enseigne que les arts, cinéma ou littérature : il lui faut “ être dans sa propre langue comme un étranger, tracer pour le langage une sorte de ligne de fuite ”.
À l’espace de ses concepts, Deleuze va donc ajouter un style, cette syntaxe sans laquelle il n’y a pas de création authentique. “ On parle d’un style dans les sports (...) Mac Enroe est un inventeur, c’est-à-dire un styliste, il a introduit dans le tennis des postures égyptiennes (son service) et des réflexes dostoiévskiens (« si tu passes ton temps à te cogner volontairement la tête contre les murs, la vie devient impossible »). ” Le style n’épargne pas l’espace savant : les sciences exactes sont créatrices de nouvelles vérités, en vertu elles aussi de règles stylistiques.
D’ailleurs, on pourrait dire que le philosophe est plus proche du physicien ou du biologiste que du cinéma ou du romancier : sa clandestinité n’est pas solitaire comme celle d’un Godard. Sa subversion fait réseau, Deleuze écrit Foucault. À l’occasion de ce Foucault, de nouveau une série d’entretiens. Deleuze y expose ce que serait un background intellectuel qu’il a fondamentalement et toujours partagé avec Foucault. La philosophie selon Deleuze devient donc une œuvre collective. C’était certainement la tâche la plus délicate que Deleuze eût jamais effectuée : comment entrer en harmonie (au sens musical du terme) avec la pensée de Foucault, sans se présenter du même coup comme un “ foucaldien ”.
Ces Pourparlers sont comme des feuillets échappés de chacun des livres de Deleuze. À cet égard, le livre tout entier a une allure clandestine. Il est, sous les “ pavés ” philosophiques, une plage d’énoncés qui reflètent la pensée en mouvement, les reculs et les avancées de cette audace qui s’appelle penser. Et il illustre à merveille ce qui a été le ton donné par une génération à la philosophie contemporaine. Qui prendra les armes à leur suite ? »
ePub : 9782707330369
Prix : 12.99
© Les Éditions de Minuit