
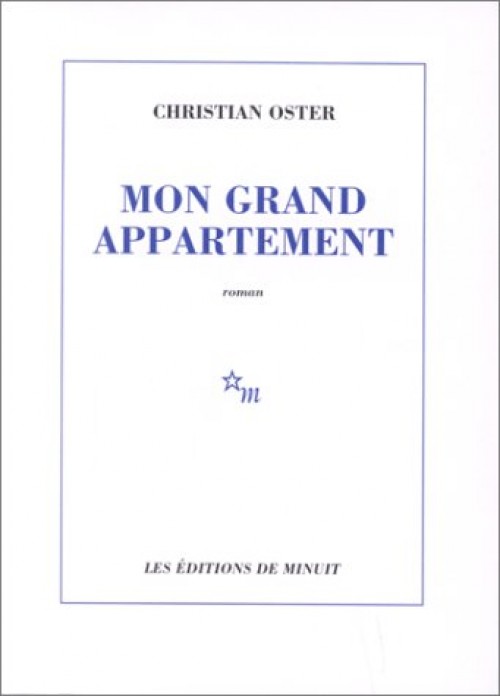
Christian Oster
Mon grand appartement
Prix Médicis 1999.
1999
256 pages
ISBN : 9782707316820
14.70 €
30 exemplaires numérotés sur Vergé des papeteries de Vizille
* Réédition dans la collection de poche double
Je ne retrouvais plus mes clés. Et Anne n’était pas rentrée. J’ai donc dormi à l’hôtel. Pas de message sur mon répondeur, hormis celui de Marge qui me donnait rendez-vous à la piscine. C’est là que j’ai rencontré Flore. Elle attendait un enfant. Ça tombait bien : moi aussi.
Marie-Laure Delorme (Livres Hebdo, 1999)
Portrait de Christian Oster.
« Avant de s’asseoir, il dispose devant lui une pochette de couleur remplie de feuilles de papier : “ Ce sont des notes sur mes livres. Au cas où j’en aurais besoin. Je ne me souviens jamais de ce que j’écris. ” Rencontrer Christian Oster est une épreuve, entre ce que l’on peut répéter (“ ça, vous pouvez l’écrire ”), ce que l’on ne peut pas répéter (“ ça, il ne faut surtout pas l’écrire ”) et ce que l’on peut à la fois répéter et ne pas répéter (“ ça, mieux vaut peut-être ne pas l’écrire... ”). Excusé. Car Christian Oster est un excellent romancier. Par la seule force de son style, il réussit à bâtir des univers à la fois atypiques et quotidiens, singuliers et réalistes. Des univers ouverts à tous les possibles. Il y a, dans chacun de ses livres, une extraordinaire fluidité d’être.
Né en 1949, Christian Oster s’est tourné vers la littérature par nécessité. Vouloir écrire bien ce que l’on dit mal. “ Je me suis lancé par inhibition. Un début, en somme, classique : ce besoin de se confier à la page blanche. ” Il est surveillant dans un lycée puis vendeur dans une librairie avant d’en être licencié. Durant cette période de chômage, à laquelle il mettra fin en devenant correcteur, il écrit des polars pour le Fleuve noir. Est-ce bien sa vocation ? “ J’en avais déjà écrit un pour Libération. Mais ils me l’avaient renvoyé en me disant que c’était, non pas un polar, mais de la science- fiction. ” (…) Il s’apprête à écrire son quatrième policier lorsqu’il découvre Cherokee, de Jean Echenoz, publié aux Éditions de Minuit. Un choc. “ J’ai envoyé mon quatrième polar à Jérôme Lindon. Il me l’a refusé. Pas assez crédible. ” Christian Oster écrit alors l’histoire d’un homme qui veut se remettre au volley-ball. En 1989, Volley-Ball est publié aux Éditions de Minuit. Depuis, Christian Oster a écrit sept romans pour le même éditeur. Sans oublier ses livres pour la jeunesse parus à L’École des loisirs. “ Je suis le rythme des saisons. Je travaille principalement en hiver. C’est alors moins agréable de sortir de chez soi. Et puis, d’autre part, je n’ai pas le coffre nécessaire pour raconter une histoire qui correspondrait à un projet de trois ans. Dans mes livres, on ne part pas en Amazonie : on est comme à la maison. ” Christian Oster élabore des romans à la maîtrise parfaite. Des personnages foncent dans la vie comme sur une porte en verre : comment attraper le réel lorsqu’on ne le voit pas ? (…) Mon grand appartement, son dernier livre, se situe à mi-chemin entre la complexité du Pont d’Arcueil et la simplicité de Loin d’Odile. Comme une synthèse de ses talents. »
Norbert Czarny (La Quinzaine littéraire, 1er septembre 1999)
Perdre et trouver
« “ Gavarine devient père ”. Cette brève proposition pourrait résumer Mon grand appartement, le nouveau roman que publie l'auteur de Loin d'Odile. C'est un résumé, parmi d'autres. On connaît en effet la manière Oster : le fil est tendu au maximum, pour donner à chaque digression, et tout le roman est digression, son ampleur et son rythme. Et pourtant, l'écrivain installe le suspens en sorte que le lecteur sentimental (ou pas) a hâte de savoir si, au terme du roman, Flore acceptera de vivre avec Gavarine.
Gavarine est en effet un homme qui n'a pas beaucoup de chance. La femme qu'il aime et pour qui il a aménagé son grand appartement, ne veut pas vivre avec lui. Cette Anne Lebedel se cloître dans un silence douloureux pour celui qui l'aime. Elle le fait souffrir, rend plus intense encore le sentiment d'échec qu'éprouve Gavarine. Ce héros narrateur n'en finit d'ailleurs pas de perdre : il a perdu son emploi, un porte-monnaie, le fermoir de ses lunettes de natation. Mais surtout, et c'est le point de départ de l'aventure, il perd la serviette renfermant ses clés. Cette serviette lui donnait sa contenance, elle était le moyen pour lui de n'être pas vu mais d'exister aux yeux des autres et à ses propres yeux. Elle ne renfermait jamais rien, sinon, pour l'occasion, ses clés lui permettant de rentrer chez lui.
Se retrouvant seul et sans possibilité de rentrer, Gavarine fait comme tous les héros de conte, forme que Christian Oster apprécie (on a pu le constater dans Le Pique-Nique, Loin d'Odile mais aussi dans les textes pour enfants parus à L'École des loisirs), il part. Une vieille amie lui donne rendez-vous dans une piscine. Il y rencontrera Flore. Tout se passe des le premier regard qui provoque le coup de foudre. Gavarine connaît ce “ quart de seconde ” qui se distingue des autres et lui qui semblait attaché à la terre, collé à son malheur, voit sa vie changer : “ tu es ailleurs, dans ce que te promet cette femme ”, se dit-il.
Flore est enceinte et curieusement, Gavarine découvre qu'elle est “ dans son camp ”, alors que jusque-là les femmes enceintes lui rappelaient les hommes qui les avaient mises enceintes ; “ ça me paraît toujours un peu lâche, cette façon de se livrer puis de porter le fruit de sa faute, comme si de rien n'était, ou avec fierté, je ne sais trop ”. Il l'accompagne en Corrèze où vit la famille de Flore et où elle accouche. Il retrouve un emploi de guide dans une grotte, lieu prédestiné, et retrouve des clés, d'autres clés, qu'il avait oubliées, fermant ainsi un cercle.
Mon grand appartement est un roman sur la paternité, sur la peur et le désir qu'elle suscite. Gavarine a tout pour être père, tout en lui et autour de lui. Lorsqu'il assiste Flore lors de l'accouchement d'un enfant qui n'est pas le sien, il se rappelle ce lieu qu'il a conçu pour une petite fille et sa mère : “ cet enfant, j'en étais, pour faire court, et quoi qu'en pensât sa mère, le père depuis longtemps, et depuis longtemps sa mère était ma femme. Je les attendais, elles étaient là, rien n'était plus normal. J'avais oublié le reste. J'étais chez moi. ” L'attente du père trouve bien sûr une partie de sa réponse dans la naissance de l'enfant, et l'on aura rarement lu une plus belle description d'accouchement dans un roman. Mais la naissance ne suffit pas. Pour que le cercle se referme complètement, il faut que le couple s'accepte. Or Flore n'est pas sûre d'aimer cet homme rencontré dans une piscine. Sa réponse à la fin du roman permettra à Gavarine d'échapper à la souffrance qu'il résume dans un aphorisme au début de son récit : “ L'amour c'est ce qui manque le plus à ceux qui aiment ”. La réponse de Flore, il la guette dans ce regard qui l'a bouleversé lors de leur première rencontre, et que les épreuves de la mise au monde, la souffrance physique et la fatigue morale rend incertain : “ La tendresse encombrait son regard. C'était gênant. On voyait mal l'amour, derrière. Qu'on supposait. Qu'on pouvait supposer. ”
On le savait déjà en lisant Loin d'Odile, les héros d'Oster sont souvent “ au bord de ”, près de chuter, de glisser. Cela se perçoit dans ses phrases souvent interrompues, comme menacées de tomber. Gavarine ne déroge pas à cette règle à ceci près qu'il espère “ tomber père ” comme une expression dit que la femme “ tombe enceinte ”.
L'hésitation, le remords dans l'écriture, traduisent le trouble de l'homme, son trouble face à ce qui est nouveau, qui naît, tel le sentiment amoureux ou filial. La chute des chapitres – et le terme stylistique n'est pas fortuit – désoriente le lecteur, ou plutôt l'oriente dans une direction inattendue qui correspond à ce que ressent le héros narrateur.
Rien de gratuit ni de facile non plus dans l'art de la digression. Celle-ci suscite l'attente du lecteur, retarde le moment de savoir, mais elle dit aussi la vérité de l'expérience, qui est toute contenue dans le temps dilaté. S'égarer dans les détails, c'est aussi se trouver et Petit Poucet Oster a définitivement perdu les cailloux qui balisent son chemin.
Mon grand appartement est sans doute un aboutissement dans l'œuvre d'Oster. On y retrouve la qualité d'émotion du Pique-Nique et le sens de l'incongru de Loin d'Odile. Les scènes de la piscine ou de l'apprentissage de la conduite donnent à Gavarine l'allure d'un Buster Keaton pour qui c'est souvent “ la première fois ”. Mais ce roman est aussi et surtout un grand roman sur le sentiment amoureux et son ancrage dans le temps en un temps qui préfère la séduction fugace et stérile. »
Daniel Martin (Magazine littéraire n°379, septembre 1999)
« Chez Oster la littérature tient de l'aventure et du malentendu. Il part de rien, d'un personnage en panne, du vide qui l'entoure. C'est volontaire. Si le vide est aussi grand, pense-t-on, c'est parce qu'il ne veut pas se laisser distraire, parce qu'il veut en finir avec ce personnage qui revient sans cesse sous sa plume, sans céder, sans se livrer tout entier – ce que font habituellement les personnages dans les romans et sans difficultés. II faut dire que ce type-là n'est pas facile, plutôt fuyant : il n'est plus tout jeune, détaché des choses matérielles mais encore suffisamment naïf pour penser que la vie, la vraie réussite passe par un amour immense et partagé, des tas de caresses, une infinie tendresse. Une âme sœur. C'est un idéaliste.
Bonne pâte, Oster lui donne de quoi meubler sa solitude, trois fois rien, un hasard, un petit quelque chose pour l'occuper. L'autre en profite. Il lui échappe. Croit-on. C'est faux ! Car Oster trouve très bien que ce type ne plie pas, garde pour lui ses secrets, ses chagrins, ses rêves... à quoi lui servirait de révéler ses manques, ses misères, ses faiblesses. D'expliquer son présent par son passé... Il lui suffit de le montrer tel qu'il est, inadapté, inadaptable, non conforme. À l'écart, mais avec raison. Il en use de ce personnage comme d'un prétexte pour jeter quelques regards sur notre temps, notre monde tout engoncé dans le raisonnable et le comptable. Des regards attristés. Sans plus. Qu'il traduit en mots, en phrases, en images sonores et drôles, si bien que ses romans se lisent d'abord pour le plaisir de rire, de s'étonner, ensuite pour le plaisir de la distance.
Gavarine vit à Paris où il travaillait aussi jusqu'à ce qu'il soit licencié : cadre il ne se sentait pas de commander les autres. De ce temps très proche, il a gardé quelques signes extérieurs de richesse dont une serviette en similicuir et un appartement assez grand pour contenir une famille, des enfants, tout un bonheur, mais qui est aussi vide que sa serviette dans laquelle il ne range plus que ses clés. Si bien que s'il perdait l'une, il perdrait les autres et se trouverait à la porte de son appartement, comme à la porte de ses rêves, exclu, démuni et seul. C'est ce qui arrive. “ S'attendre au pire, à quelque chose de pis que la chute, tout en chutant, c'était un peu la conception que j'avais de la vie ”, dit-il.
C'est alors qu'Oster lui offre de quoi se rattraper, une brindille, un tout petit message tombé par le plus grand des hasards sur son répondeur téléphonique qu'il peut interroger à distance, par chance. Une vieille, vieille conquête se rappelle à lui avec une soudaine envie de le revoir. Gavarine en frémit d'aise et se rend au rendez-vous. C'est là, dans les eaux bleutées d'une piscine municipale, pendant qu'il attend en vain son ancienne connaissance, qu'il tombe amoureux d'un inconnue qui, comble de bonheur, est enceinte. Elle attend une fille, lui aussi. Il les “ préfère aux petits garçons qui tournent mal en grandissant ”. Tout va très vite, s'enchaîne à merveille... Mais la belle part en province où elle doit accoucher. Plutôt que de se désoler à Paris, Gavarine s'accroche à son sourire et la suit. Attendri et soudain lucide, il se dit : “ Mon grand appartement n'est pas pour moi. J'ai besoin d'une place, d'une petite place sur cette terre, juste de quoi tendre les bras. Vers cette femme ”. Elle ne dit pas non. Car elle aussi est seule.
C'est là que l'incompréhension s'installe : Gavarine croyant approcher du bonheur lâche le fil de son histoire pour entrer dans une autre, celle des autres justement, où il serait déjà un mari, un père, et chargé de responsabilités. Ce qu'il ne veut pas. Trop tard. II fait comme si mais sait bien qu'il a changé d'histoire et quand, à quel moment précis. Il se fait violence : sur l'avant-scène, il fait ce qu'on attend de lui, mais en coulisse, il résiste. Se livre à quelques tours de passe-passe. Tout à la fin, le vide qui l'entourait se trouve sous ses pieds. Il le fait visiter. “ En fait (...) vous avez raison, ce n'est pas une histoire. C'est un feuilleton. Et je ne connais pas la suite. ” »
Jean-Baptiste Harang (Libération, 2 septembre 1999)
Oster déménage
Comment calmer son angoisse en explorant les gouffres ? Réponse dans un Grand appartement fermé à tout sauf à l'humour.
« La dernière fois qu'on vit Christian Oster, rue Lepic, il s'apprêtait à déménager vers un plus grand appartement. Et voilà-t-il pas qu'à peine deux ans plus tard il publie un roman sous ce titre, Mon grand appartement. On se dit que pour une coïncidence, bref, on le lit, et 250 pages plus loin, on n'a toujours pas mis le pied dans l'immeuble, ni lui, ni ses héros, ni ses lecteurs. Personne. Alors là, vraiment, de qui se moque-t-on. Des anecdotes pareilles mériteraient d'être tues. C'est comme dans le livre, on en parle pourtant du grand appartement du narrateur, Gavarine, Luc Gavarine, on l'appelle Gavarine, enfin, on l'appelle peu, mais si quelqu'un devait l'appeler, ce serait probablement Gavarine, Gavarine tout court, on n'invente pas, c'est ce qu'il imagine. Mais personne ne l'appelle, sauf à la fin, bien sûr, Flore, qui lui dit : “ Non, Luc. Je ne parle pas de toi ” (page 219), mais on voit bien qu'elle ne sait pas qu'on l'appelle surtout Gavarine. On parle de son grand appartement, par allusion, par référence, mais on n'en dit rien, sinon qu'il est grand, et de sa serviette vide, pas sa serviette de bain, que d'ailleurs il serre dans un sac de sport, pas dans sa serviette, celle qu'il a perdue avec, justement, les clefs du grand appartement, perdue au point d'en acheter une autre, n'importe laquelle, vide, elle aussi, Gavarine.
Pour l'histoire, il suffit de lire la quatrième de couverture, tout y est : “ Je ne retrouvais plus mes clefs (on l'a dit). Et Anne n'était pas rentrée (elle travaille chez un gros fleuriste qui a une toute petite boutique). J'ai donc dormi à l'hôtel. Pas de message sur mon répondeur, hormis celui de Marge (il ne l'a pas vue depuis dix ans) qui me donnait rendez-vous à la piscine. C'est là que j'ai rencontré Flore (vous la connaissez). Elle attendait un enfant. Ça tombait bien : moi aussi (si l'on peut dire). ” On ajoute “ si l'on peut dire ”, car les hommes et les femmes n'attendent pas les enfants exactement de la même manière, surtout que Flore attend un garçon, qu'elle tient au chaud de son ventre depuis neuf mois, et Gavarine une fille toute théorique puisqu'il vient de rencontrer Flore à la piscine, à deux doigts de la parturition. Ca n'empêche pas Gavarine d'avoir raison, puisque c'est une fille. Maude. Tout y est, donc, sauf l'histoire qui tient tout entière (cette histoire-là et celles de tous les autres livres de Christian Oster) dans cette petite phrase de la page 159 : “ Je n'avais plus besoin de moi. ” Avec ce septième roman aux Éditions de Minuit, Oster insiste, il creuse son sillon (non, pas du tout, ce n'est jamais le même livre, allez-y, vous, creusez-en des sillons, vous verrez bien ce qu'on trouve, des couches successives, des raisons de désespérer, de continuer à creuser, jamais les mêmes choses, du vertige, et cette fois il le creuse jusqu'au gouffre, vous verrez), le même sillon, donc, un type s'efface et raconte le presque vide, le presque rien, le peu qui reste, le peu qu'il sauve, ces quatre grammes d'humanité qui font qu'on ne disparaît pas totalement. Il s'efface, ce n'est pas un mot au hasard, il se gomme, systématiquement, il prend les mots les uns après les autres, se convainc de leur vanité, de leur vacuité, et les biffe, pour qu'il n'en reste rien, mais ce rien pèse, il est consciencieusement exhaustif, imprenable, toujours assez fiévreux pour faire de cette angoisse si légère (aérienne à force d'humour têtu) un livre magnifique. Un livre pour les autres puisque lui, le Gavarine du Grand Appartement, le Louis de Pique-Nique, le Lucien si Loin d'Odile, les autres qui ne se nomment même pas, sauf peut-être Bertin, le premier, celui de Volley-Ball, puisqu'il parlait à la troisième personne, tous pourraient s'excuser du peu par la petite phrase de la page 159 : “ Je n'avais plus besoin de moi. ” Plus besoin d'eux-mêmes, donc libres, disponibles, en réserve de la vie des gens, toujours prêts à remplacer un congénère au pied levé, sans autre ambition que de se rendre utile, même pas utile, tout juste présent, trouver une place, surtout pas la sienne, une place modeste, sans ambition, la place d'un autre où l'on a rien à perdre, essayer d'être un autre, ça ne pourra pas être pire puisque l'on a déjà démontré que de soi on n'a rien su faire. Enfin, c'est ce qu'on croit, Christian Oster, lui, il raconte, avec pour preuve la force de l'évidence, cet art exacerbé d'épuiser les incidentes, de ne rien théoriser, sinon parfois (page 73) le besoin légitime d'aller à la ligne. Même la petite phrase de la page 159, celle qu'on a relevée pour faire le malin, elle n'en demandait pas tant : c'est seulement parce que Gavarine, après avoir assisté et insisté à l'accouchement de Flore, après avoir échoué puis réussi à couper le cordon ombilical, la sage-femme lui dit : “ Allez-vous asseoir, maintenant. Nous n'avons plus besoin de vous dans l'immédiat. ”
“ Moi non plus. Je n'avais plus besoin de moi. Juste d'un siège. Et des autres. ” Voyez, c'est dans le feu de la conversation, il n'y a pas de quoi en faire une affaire. Besoin des autres, oui, comme vous et moi. À la toute fin, Luc Gavarine, mais vous verrez bien, reste quelque part en Corrèze pour faire visiter un gouffre à des Anglais, si on se souvient bien. Voyez, ça commence par une angoisse, la peur du vide, et ça finit par faire visiter des gouffres, c'est comme la vie. C'est ainsi, du moins, que Christian Oster voit les choses, faire rire avec des presque rien, des presque riens limpides et des vrais morceaux de vie à l'intérieur. »
Fabrice Gabriel (Les Inrockuptibles, 1er septembre 1999)
Une affaire de mots
Septième roman de Christian Oster, Mon grand appartement dit l'histoire (drôle) de quelqu'un qui cherche à se raconter. Une partition romanesque contemporaine.
« “ Je m'appelle Gavarine, et je voudrais dire quelque chose. ” Christian Oster a le goût de l'incipit et le sens des titres, qui donne l'envie immédiate d'aller visiter le Grand appartement de son narrateur, alter ego bavard et drôle d'un nouveau roman – le septième, déjà. En fait de visite, on risque d'être un peu déçu : Luc Gavarine – une sorte de Hulot post-beckettien, ou de Plume en plus gris – vient de perdre à la fois son emploi, ses clés et sa compagne. Ou plus exactement : il a égaré sa serviette, qui contenait les clés d'un appartement où aurait dû habiter la femme qui aurait pu l'aimer... Mais voilà : il n'y a plus de clés, plus d'amour, et la nouvelle serviette qu'achète Gavarine restera vide, telle la métaphore d'un récit recelant des riens dans ses drôles de plis souples. Nous ne connaîtrons jamais le grand appartement du titre : Gavarine ira coucher à l'hôtel et se retrouvera, d'une serviette à l'autre, dans une piscine parisienne, où une jeune femme, Flore, changera son destin en l'invitant à suivre son accouchement en province, et lui proposera peut-être de devenir le père de son enfant...
En le résumant ainsi, on n'a rien dit, ou presque, de ce roman étrange mais familier, qui ne* surprendra pas les amateurs d'Oster et ravira ses nouveaux lecteurs. On y retrouve en effet l'espèce de minimalisme Minuit d'une écriture dont les coquetteries pourraient agacer, si ne les sauvait constamment un humour sec et singulier, mêlé d'une sorte de désespoir feutré, sans larmes et tour en style. L’histoire de Gavarine est bien d'abord une affaire de mots : il voudrait “ dire quelque chose ”; et de ce désir naît sa dérive narrative vers l'innommable de l'amour... Ainsi raconte-t-il sa rencontre avec Flore : “ C'est moi qu’elle fixait (... ), qu’elle avait laissé venir à elle, pour lui dire un mot, entre autres choses, pour me laisser le lui dire, et maintenant je m'en faisais une idée, de ce mot, une idée précise, il me restait à la formuler, sans doute, mais j’avais pris confiance, et tout à coup je me lançai, je lui posai une question, la seule qui valût, me semblait-il, en tout cas la seule qui désormais m'importât. je parle de la question du sexe. ” Évidemment, il s'agit du sexe de l'enfant qu'attend la jeune femme : fille ou garçon ? Mais la méprise où nous a malicieusement entraînés Oster résume à la fois le ton et le fond du livre : quel sens juste donner aux mots qui unissent les êtres, à ce mystère qui les sépare et les rapproche ? Sans doute n'est-ce pas un hasard si l'enfant qui fait le lien entre Gavarine et Flore s'appellera Mande, où l'on entend forcément les mots – et les maux – de l'amour à dire.
Mon grand appartement obéit ainsi à une espèce d'esthétique du calembour et du quiproquo, l'auteur ne cessant de jouer des écarts de langage pour signifier les incertitudes de l'identité : le narrateur ne sait plus qui il est, ni ce qu'il fait avec une femme qu'il vient de rencontrer et dont l'enfant à peine né lui échoit comme à un père, presque naturellement. Cet apparent naturel des enchaînements donne au roman ses faux airs de fable absurde : les personnages s'y dépouillent de toute psychologie superflue, sans échapper pour autant aux affres du sentiment. Fidèle en ce sens à la thématique de ses romans précédents, Oster peut s'amuser de la maniaquerie descriptive de son narrateur – transformé en désopilant guide pour touristes d'un gouffre éminemment symbolique – et briller dans des dialogues où se retrouve son obsession du tempo : “ Ça va aller ? demandai-je, Oui, me dit-elle. C'est passé. Mais ça se rapproche, je devais accoucher dans une semaine. Et maintenant ? Maintenant, me dit-elle, ce serait plutôt maintenant. En sortant du train, je veux aller à l’hôpital, dit-elle. Tout de suite. ” Par-delà la drôlerie qui naît ici de la confusion des temps, c'est le souci d'une impossible justesse lexicale qui se révèle, et la griserie qu'il y a à fixer la vitesse des mots, leur incessant mouvement musical entre le vrai et le faux, les choses et les gens.
Superposant aux dissonances d'un couple les variations d'un sens toujours incertain, Oster compose ainsi une partition romanesque, cocasse et contemporaine, dont le rythme enchante autant que les motifs. »
ePub : 9782707331786
Prix : 6.99
© Les Éditions de Minuit